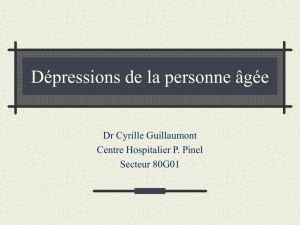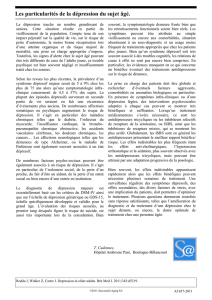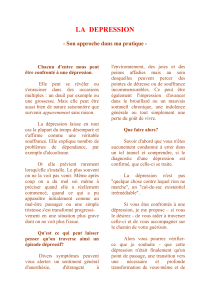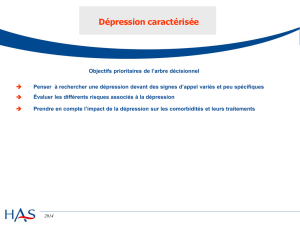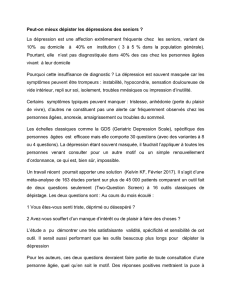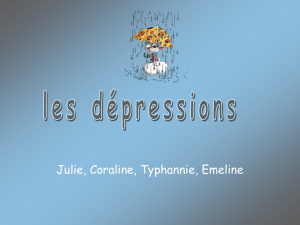INTRODUCTION ASPECTS CLINIQUES DE LA DÉPRESSION Dépressions et âges de la vie

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.
L’auteur n’a pas déclaré de conflits d’intérêt.
Dépressions et âges de la vie
INTRODUCTION
La dépression est le trouble
psychiatrique le plus fréquent
chez la personne âgée. Sa pré-
valence diffère selon la popula-
tion considérée et selon que
l’on compte seulement les cas
d’épisodes dépressifs caractéri-
sés (majeurs) ou également les
cas avec symptômes dépressifs
isolés.
En médecine générale, 15 à
30 % des sujets âgés ont des
symptômes dépressifs. Le taux
de dépression caractérisée est
de 10 à 13 % selon les auteurs
dans la population âgée généra-
le et de 40 % en institution.
Cependant, la dépression chez
la personne âgée est souvent
méconnue ou tardivement re-
connue et insuffisamment trai-
tée.
Enfin, la dépression de l’âgé est
associée à une perte d’autono-
mie, un déclin fonctionnel, une
baisse de la qualité de vie, un
accroissement de la mortalité
lié aux comorbidités et aux sui-
cides, un fardeau pour les ai-
dants et une charge importante
pour les services de santé.
ASPECTS CLINIQUES
DE LA DÉPRESSION
Il peut être difficile de différen-
cier d’authentiques signes dé-
pressifs des modifications cli-
niques liées au vieillissement
physiologique ou des symp-
tômes induits par une affection
somatique (fréquente à cet
âge) ou un médicament.
– La tristesse est un signe de
dépression lorsqu’elle s’accom-
pagne d’une perte d’intérêt et
d’un ralentissement.
– La perte d’intérêt est patho-
logique quand elle est vécue
comme désagréable, dispropor-
tionnée par rapport aux apti-
tudes physiques et intellec-
tuelles du sujet ou brutalement
amplifiée.
– Une perte d’appétit est évo-
catrice de dépression si elle
s’associe à un amaigrissement
et à l’apparition ou l’aggrava-
tion de troubles du sommeil.
Le patient peut souffrir d’un
épisode dépressif majeur ty-
pique selon les critères du
DSM-IV-TR (2) se manifestant
par une tristesse pathologique
avec douleur morale, un ralen-
tissement moteur et une inhibi-
tion intellectuelle, un amaigris-
sement et des troubles du som-
meil, un sentiment d’inutilité
ou de culpabilité, des rumina-
tions suicidaires.
Il faut cependant insister sur la
diversité de l’expression cli-
nique de la dépression chez la
personne âgée.
Formes d’intensité sévère
Dépressions mélancoliques
Elles s’accompagnent de pros-
tration et mutisme, ou au
contraire d’agitation et d’irasci-
bilité, d’une perte de poids et
d’une insomnie prédominant en
fin de nuit.
L’hospitalisation en urgence est
souvent nécessaire du fait du
retentissement somatique rapi-
de et du risque suicidaire.
Épisode dépressif majeur avec
caractéristiques psychotiques
Dans ces formes (classique-
ment appelées mélancolies déli-
rantes), le risque est de porter
le diagnostic de délire chro-
nique et de méconnaître l’as-
pect dépressif.
Hôpital Broca, 75013 Paris
Dépression et vieillissement
A.-S. Rigaud

A.-S. Rigaud L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13
S 10
Dépressions et âges de la vie
Ces dépressions s’accompa-
gnent de signes confusionnels,
d’hallucinations essentielle-
ment auditives à thème de per-
sécution, d’idées délirantes de
culpabilité, d’incurabilité, de
ruine, de dévalorisation.
Le syndrome de Cotard est
une forme particulière qui asso-
cie des idées délirantes de dam-
nation, de négation d’organes,
de nihilisme et d’immortalité.
Formes atypiques
Les signes de la dépression sont
souvent atypiques chez la per-
sonne âgée. En particulier, la
tristesse de l’humeur peut être
remplacée par une indifférence
affective, une impression de va-
cuité affective et corporelle. Le
ralentissement peut se manifes-
ter sous la forme d’une fatigue.
Dépressions et troubles
du comportement
Dans les dépressions dites hos-
tiles, l’irritabilité, les manifesta-
tions agressives et les troubles
caractériels sont au premier
plan.
Les dépressions avec manifes-
tations hystériformes sont ca-
ractérisées par une manipula-
tion et des revendications
vis-à-vis de l’entourage.
Les formes régressives se mani-
festent par un désinvestisse-
ment global avec refus de s’ali-
menter, incontinence, mutisme
évoluant de façon rapide (syn-
drome de glissement). « La
grabatisation », l’anorexie, l’im-
potence, les désordres hydro-
électrolytiques font de ce
tableau une urgence car l’évolu-
tion peut être irréversible.
Le syndrome de Diogène, qui
est un abandon des soins cor-
porels et de l’entretien de la
maison où s’entassent de mul-
tiples détritus au cours du
temps, peut également accom-
pagner certaines dépressions.
Les troubles du comportement
peuvent également prendre
l’aspect d’un alcoolisme ou de
conduites suicidaires.
Dépression et troubles somatiques
Le patient peut avoir des
plaintes somatiques au premier
plan, en particulier des douleurs
à type de céphalées, de glosso-
dynies, de douleurs de la sphère
digestive, de douleurs polyarti-
culaires. D’autres symptômes
sont fréquents tels qu’une
constipation, des troubles de
l’équilibre, un état de fatigue,
un amaigrissement. Néan-
moins, il ne faut pas mécon-
naître une éventuelle affection
organique associée au trouble
psychiatrique.
Dépressions et anxiété
La dépression peut être mas-
quée par une anxiété condui-
sant à la prescription d’anxioly-
tiques seuls. Le sujet peut se
plaindre d’une appréhension,
d’angoisses inexpliquées, d’une
peur de sortir et d’une dépen-
dance croissante à l’entourage.
La comorbidité anxiété-dépres-
sion est fréquente.
Dépression et troubles cognitifs
20 % des dépressions du sujet
âgé s’accompagnent de
troubles cognitifs. Lorsque les
troubles des fonctions intellec-
tuelles sont importants, le pro-
blème est de savoir si la dépres-
sion est seule en cause ou si la
dépression et la démence co-
existent. En effet, il existe des
similitudes entre démence et
dépression au niveau compor-
temental (apragmatisme, ralen-
tissement psychomoteur),
cognitif (difficultés de concen-
tration, troubles de mémoire)
et affectif (troubles émotion-
nels, désinvestissement des ac-
tivités habituelles, perte des in-
térêts) qui rendent difficile le
diagnostic différentiel entre les
deux maladies.
DIAGNOSTIC
DE LA DÉPRESSION
Dans ces formes atypiques, la
présence de certains éléments
cliniques tels que l’existence
d’antécédents personnels ou
familiaux de trouble thymique
ou la notion d’un événement
déclenchant peut aider au dia-
gnostic de dépression. Par
ailleurs, il faut rechercher des
signes évocateurs de dépres-
sion tels qu’un changement ré-
cent du comportement, des
signes physiques tels une amé-
lioration vespérale des troubles,
une anorexie, des réveils mati-
naux précoces ou des signes
psychologiques à type d’idéa-
tion suicidaire, d’anxiété impor-
tante, de pessimisme croissant
vis-à-vis de l’avenir.
Une évaluation globale soma-
tique, fonctionnelle et sociale
est essentielle chez la personne
âgée. La liste des médicaments
pris par le patient doit être
connue. Les examens complé-
mentaires sont parfois néces-
saires en particulier pour élimi-
ner une affection organique
Différentes échelles permet-
tent d’évaluer l’intensité de la
dépression, telles que l’échelle
d’hétéro-évaluation de Mont-
gomery et Asberg (Montgome-

ry et Asberg Depression Rating
Scale) ou l’auto-questionnaire
de Yesavage et Brink (The Ge-
riatric Depression Scale) qui a
été élaboré pour la personne
âgée.
LES FACTEURS DE RISQUE
Différents facteurs de risque de
dépression ont été identifiés.
Les facteurs psycho-sociaux
tels que la solitude, les change-
ments de contexte de vie (mise
en retraite, déménagement,
entrée en institution), le deuil
en particulier le veuvage jouent
un rôle important.
L’apparition de symptômes dé-
pressifs peut être induite par la
prise de médicaments (neuro-
leptiques, corticoïdes, antihy-
pertenseurs, antituberculeux,
LDopa, antihistaminiques, anti-
mitotiques, antiépileptiques) ou
par des toxiques comme l’al-
cool.
La dépression est fréquente au
cours de la maladie cérébrovas-
culaire qu’il s’agisse de dépres-
sions vasculaires, d’accidents
vasculaires cérébraux, de dé-
mences vasculaires. La dépres-
sion peut être secondaire à dif-
férentes affections par exemple
une maladie de Parkinson, une
maladie d’Alzheimer ou une
démence à corps de Lewy, ou
encore une affection endocri-
nienne (hypothyroïdie), cancé-
reuse, des apnées du sommeil.
Inversement, la dépression
peut constituer un facteur de
vulnérabilité à différentes af-
fections somatiques.
La dépression peut être secon-
daire à des affections psychia-
triques : troubles de la person-
nalité, anxieux, psychotiques.
Elle peut également entrer
L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13 Dépression et vieillissement
S 11
Dépressions et âges de la vie
dans le cadre d’une maladie dé-
pressive unipolaire ou bipolaire.
ÉVOLUTION
La dépression du sujet âgé a un
mauvais pronostic du fait du
risque suicidaire dans la phase
aiguë de la maladie et du risque
de désinsertion familiale et so-
ciale à plus long terme.
Le suicide
La France a un taux de suicide
des personnes âgées parmi les
plus élevés en Europe de
l’Ouest. Le taux de suicide
chez les personnes âgées est le
double de celui de la population
générale. Le suicide prédomine
chez les hommes. Être veuf ou
divorcé, vivre seul, avoir un
soutien social faible, souffrir
d’une maladie somatique et/ou
psychiatrique sont des condi-
tions qui augmentent le risque
de suicide.
Le risque suicidaire doit tou-
jours être évalué. Il peut être
méconnu chez la personne
âgée car les plaintes alléguées
ne sont pas des idées suici-
daires mais un état de fatigue
ou une anxiété.
Les dépressions chroniques,
les rechutes, les récurrences
Une dépression d’évolution
chronique est notée chez 18 à
40 % des patients. D’une part
l’efficacité des antidépresseurs
chez la personne âgée est infé-
rieure à celle observée chez le
sujet jeune, d’autre part le
manque d’alliance thérapeu-
tique joue certainement un rôle
important. En effet, 70 % des
patients ne suivraient pas leur
prescription de façon correcte.
Les rechutes dépressives sont
observées d’autant plus fré-
quemment qu’il existe des épi-
sodes dépressifs antérieurs, que
la dépression est sévère et
qu’elle s’associe à une dysthy-
mie. La survenue d’événe-
ments de vie marqués par des
pertes et la coexistence d’une
maladie somatique, en particu-
lier si celle-ci est chronique,
sont également des facteurs fa-
vorisant les rechutes.
Les récurrences sont fré-
quentes : 40 % des patients
présentent de nouveaux épi-
sodes dépressifs ultérieurs
(dans un délai de 12 mois après
le premier épisode). Les dé-
pressions psychotiques ont un
risque plus important de réci-
dives que les dépressions non
psychotiques.
Certaines dépressions pour-
raient évoluer vers une démen-
ce. Il est donc important de ré-
évaluer les fonctions cognitives
du patient à distance.
TRAITEMENT
L’alliance thérapeutique avec le
patient et si possible son aidant
principal joue un rôle considé-
rable dans le succès du traite-
ment.
Après l’information indispen-
sable sur la maladie et ses traite-
ments, des soins et un accom-
pagnement global doivent être
proposés au malade et à son ai-
dant principal. En particulier, il
est toujours nécessaire de pallier
les déficits sensoriels (auditifs,
visuels) du patient et de traiter
les affections somatiques asso-
ciées aux troubles psychiques.
La mise en place d’un support
social adapté résulte de l’éva-

luation non seulement de l’état
de santé mais également de
l’autonomie, de la situation fi-
nancière et sociale et des possi-
bilités et des limites du soutien
de la part de l’entourage du pa-
tient.
L’hospitalisation est indiquée en
cas de risque de suicide, dans
les formes mélancoliques et dé-
lirantes de dépression, en cas
d’anorexie.
Les bases du traitement de la
dépression du sujet âgé ont fait
l’objet de recommandations ré-
centes (3, 4, 5). La Haute Au-
torité de Santé conduit sur la
période 2007-2009 une dé-
marche participative visant à
améliorer la prescription des
psychotropes en particulier les
antidépresseurs.
Bien que les comorbidités so-
matiques entraînent probable-
ment une vulnérabilité crois-
sante aux effets indésirables
chez la personne âgée, les bé-
néfices du traitement antidé-
presseur l’emportent sur les
risques induits par l’absence de
traitement.
Il n’existe pas de critères cli-
niques permettant de prédire
l’efficacité d’un antidépresseur
molécule donnée chez un pa-
tient âgé. En revanche, la né-
cessité de réduire les effets se-
condaires au minimum guide la
prescription. En conséquence,
en première intention, les inhi-
biteurs sélectifs de la recapture
de la sérotonine, les inhibiteurs
de la recapture de la sérotonine
et de la noradrénaline, les
IMAO sélectifs A et les autres
antidépresseurs (miansérine,
mirtazapine, tianeptine) sont
recommandés.
Pour le choix de la molécule, on
pourra se baser sur l’utilisation
thérapeutique d’effets laté-
raux, par exemple recherche
d’anxiolyse ou de stimulation.
La prescription concomitante
d’un anxiolytique ou d’un som-
nifère ne doit pas être systéma-
tique du fait de leurs effets in-
désirables chez la personne
âgée.
Les patients souffrant d’un épi-
sode dépressif majeur avec ca-
ractéristiques psychotiques bé-
néficient de l’association
antidépresseur-antipsychotique
(1).
L’adaptation posologique du
traitement antidépresseur doit
être prudente ; cependant il est
recommandé d’aboutir et de
maintenir la posologie préconi-
sée par le résumé des caracté-
ristiques du produit. Il faut
poursuivre le traitement pen-
dant 4 voire 6 semaines avant
d’observer un réel bénéfice. En
cas de non-réponse, on prescri-
ra une molécule d’une autre
classe.
Il est recommandé de suivre le
patient et de vérifier l’absence
d’effets secondaires, en parti-
culier une hypotension ortho-
statique, des troubles de l’équi-
libre, une hyponatrémie. À
court terme, les antidépres-
seurs n’ont pas seulement un
effet bénéfique sur les troubles
thymiques : ils ont aussi une ac-
tion sur les manifestations co-
gnitives. À long terme, les anti-
dépresseurs n’auraient pas
d’effets néfastes sur les fonc-
tions cognitives.
Le traitement antidépresseur
doit être poursuivi au moins
12 mois. Si le patient a déjà fait
un ou plusieurs épisodes dé-
pressifs antérieurs, un traite-
ment préventif des récidives
doit être instauré au long
terme : soit la poursuite de
l’antidépresseur au long cours
en cas de trouble dépressif ré-
current unipolaire, soit mise en
place d’un traitement thymo-
régulateur en cas de trouble bi-
polaire.
L’électroconvulsivothérapie est
indiquée lorsque le pronostic vi-
tal est mis en jeu (agitation ou
stupeur, délire avec risque suici-
daire, troubles somatiques ma-
jeurs) ou en cas d’effets secon-
daires importants ou de
résistance aux antidépresseurs.
Le maintien au long cours de la
sismothérapie ou le relais par
les antidépresseurs restent à
évaluer.
Plusieurs équipes ont égale-
ment montré le bénéfice de la
stimulation transcrânienne
dans le traitement de la dépres-
sion du sujet âgé.
La luxthérapie est également
efficace en particulier dans les
dépressions saisonnières.
Différentes psychothérapies
(psychothérapie de soutien,
psychothérapie d’inspiration
analytique, thérapie cognitivo-
comportementale) peuvent
être proposées dans le traite-
ment de la dépression du sujet
âgé. Elles sont de réalisation
souvent difficile du fait de l’ab-
sence de thérapeutes formés à
la fois à ces techniques et à la
prise en charge des personnes
âgées.
La réhabilitation psychosociale
(stimulation de la mémoire, ré-
apprentissage de certains sa-
voir-faire comme la cuisine ou
le bricolage, mobilisation du
corps) peut également contri-
buer à réinsérer le patient dé-
primé dans son cadre de vie an-
térieure. Cependant, les
capacités d’accueil des hôpi-
taux et/ou centres de jour sont
insuffisantes par rapport aux
besoins.
A.-S. Rigaud L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13
S 12
Dépressions et âges de la vie

L’Encéphale (2008) Hors-série 2, 9-13 Dépression et vieillissement
S 13
Dépressions et âges de la vie
Par ailleurs, la dépression qui
constitue une charge psycholo-
gique lourde pour l’entourage,
est susceptible de perturber
l’équilibre familial et de provo-
quer des manifestations
d’anxiété et/ou dépressives
chez les proches. L’information
par le biais de réunions en pré-
sence d’un professionnel ou par
des lectures guidées expliquant
la maladie peut réduire ce
stress. Parfois, la détresse d’un
ou plusieurs membres de la fa-
mille nécessite une intervention
psychothérapique spécifique.
Selon les cas, on peut proposer
un soutien psychothérapique
individualisé ou une thérapie fa-
miliale. Ces dernières sont par-
ticulièrement indiquées quand il
existe des conflits familiaux et
dans les situations de crise.
Références
1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé (AFSSAPS). Bon usage des médicaments
antidépresseurs dans le traitement des troubles dé-
pressifs et des troubles anxieux de l’adulte. Recom-
mandations, 2006.
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders fourth edi-
tion, texte revision, 2000.
3. Haute Autorité de Santé (HAS). Améliorer la pres-
cription des psychotropes, octobre 2007.
4. Haute Autorité de Santé (HAS). Prise en charge
des complications évolutives d’un épisode dépressif
caractérisé de l’adulte. Recommandations,
avril 2007.
5. Haute Autorité de Santé (HAS). Recommandations,
avril 2002.
1
/
5
100%