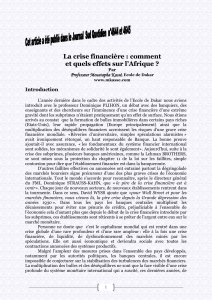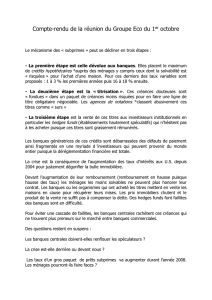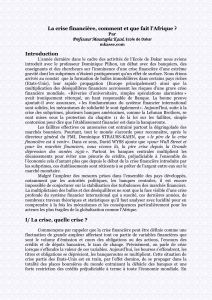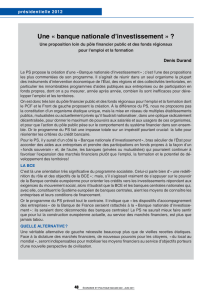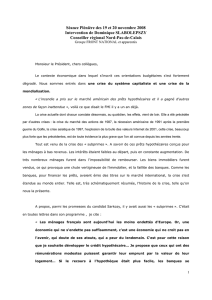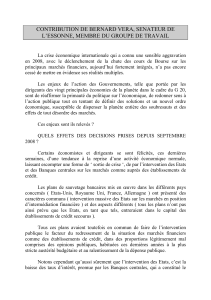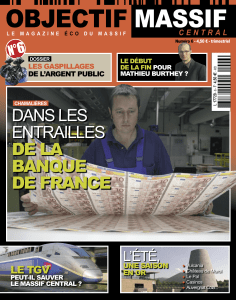L a c

1
L
La
a
c
cr
ri
is
se
e
f
fi
in
na
an
nc
ci
iè
èr
re
e
:
:
c
co
om
mm
me
en
nt
t
e
et
t
q
qu
ue
el
ls
s
e
ef
ff
fe
et
ts
s
s
su
ur
r
l
l’
’A
Af
fr
ri
iq
qu
ue
e
?
?
Par
Professeur Moustapha Kassé
Professeur Moustapha KasséProfesseur Moustapha Kassé
Professeur Moustapha Kassé
,
Ecole de Dakar
www.mkasse.com
Introduction
L’année dernière dans le cadre des activités de l’Ecole de Dakar nous avions
introduit avec le professeur Dominique PLIHON, un débat avec des banquiers, des
enseignants et des chercheurs sur l’imminence d’une crise financière d’une extrême
gravité dont les subprimes n’étaient pratiquement qu’un effet de surface. Nous étions
arrivés au constat que la formation de bulles immobilières dans certains pays riches
(Etats-Unis), leur rapide propagation (Europe principalement) ainsi que la
multiplication des déséquilibres financiers accroissent les risques d'une grave crise
financière mondiale. «Rêveries d’universitaire, simples spéculations alarmistes »
avait ironiquement rétorqué, un haut responsable de Banque. La bonne preuve
ajoutait-il avec assurance, « les fondamentaux du système financier international
sont solides, les mécanismes de solidarité le sont également». Aujourd’hui, suite à la
crise des subprimes, plusieurs banques américaines, comme la Lehman BROTHERS,
se sont mises sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, simple
contorsion pour dire que l'établissement financier est dans la banqueroute.
D’autres faillites effectives ou annoncées ont entrainé partout la dégringolade
des marchés boursiers signe précurseur d’une des plus graves crises de l’économie
internationale. Tout le monde s’accorde pour reconnaître, après
le directeur général
du FMI, Dominique STRAUSS-KAHN, que « le pire de la crise financière est à
venir». Chaque jour de nouveaux secteurs, de nouveaux établissements rentrent dans
la tourmente. Dans ce sens, David WYSS ajoute que «pour Wall Street et pour les
marchés financiers, nous vivons là, la pire crise depuis la Grande dépression des
années 1930 ». Dans tous les pays les banques centrales multiplient les
décaissements pour éviter une pénurie de crédits, préjudiciable à l’ensemble de
l’économie cela d’autant plus que depuis le début de la crise financière introduite par
les subprimes, ces établissements sont réticents à se prêter de l'argent entre eux sur le
marché monétaire.
Personne ne doute que c’est le capitalisme mondial qui est rentré dans une
crise globale d’une rare profondeur et d’une rare ampleur : elle à la fois une crise
financière, de liquidité, de dysfonctionnement des marchés minés par les
spéculations. Elle est aussi économique et deviendra sociale avec toutes les
contractions annoncées des systèmes productifs.
Malgré l’ampleur des mesures prises dans l’ensemble des pays développés,
notamment par les autorités politiques, les banques centrales, il est encore
impossible de conjecturer sur la stabilisation des turbulences des marchés financiers.
La multiplication des bulles et des déséquilibres ne sont que la face visible d’une crise
profonde du système monétaire international qui a suscité, ces dernières années, de

2
nombreux travaux théoriques et statistiques qu’il faut analyser avec lucidité pour en
comprendre à la fois les mécanismes et les conséquences particulièrement pour les
acteurs les plus fragiles de la globalisation comme l’Afrique.
I/ La crise, quelle crise ?
Commençons par rappeler que la crise financière peut être définie comme une
fluctuation de grande ampleur affectant tout ou partie de variables financières que
sont le volume d’émission et cours des obligations ou des actions, l’encours des
crédits et de déports bancaires, le taux de change. Précisément, on parle de crise
lorsque s’effondre la valeur de ces variables. Aujourd’hui, les bourses s’effondrent, les
titres et obligations se déprécient, les banqueroutes se multiplient. Cette situation de
crise partie des Etats-Unis est en train, par l’effet domino, de se propager dans la
totalité des places boursières du monde entrainant la débâcle des banques et une
forte restriction des crédits préjudiciable à terme à toute l’économie mondiale. En
effet, ce resserrement du crédit, dans beaucoup de pays industrialisés va restreindre
la consommation des ménages et les investissements des entreprises ce qui risque
d’entrainer à terme la récession économique.
Les marchés financiers présentent, aujourd’hui, deux caractéristiques qui sont
les principaux germes de la crise : le volume impressionnant des montants concernés
ce qui leur donne un énorme pouvoir et leur contrôle de la sphère réelle. Concernant
la première caractéristique, la finance mondiale (actions, obligations et crédits
bancaires) a un poids démesuré et pèse l’équivalent de quatre fois le Produit Intérieur
Brut Mondial. Cela à été possible grâce à la globalisation provenant de ce que D.
PLIHON appelle les 3D : la désintermédiation, le décloisonnement des marchés et la
déréglementation, trois situations qui ont permis véritablement la formation d’un
quasi marché planétaire unique de l’argent.
D’abord, l’effacement des frontières (décloisonnement) va permettre une libre
circulation des capitaux qui n’obéît qu’à une logique unique de rendement optimal de
l’argent : une transaction peut se produire entre deux entités, dans deux endroits
différents, pour le compte d’un client situé dans un troisième avant d’être conclu
dans un quatrième endroit. Ensuite, les frontières institutionnelles vont également
disparaitre complètement : les institutions financières exercent désormais plusieurs
métiers. Dans ce sens, les banques diversifient leurs activités traditionnelles de crédit
vers des opérations d’intermédiation non prises en compte dans leur bilan. Enfin, les
progrès technologiques vont introduire des innovations et des transformations
majeures qui se traduisent par une importante diversification des produits et des
instruments qui rendent la finance plus entremêlée, plus complexe et plus instable.
Au titre de ces innovations on peut noter les progrès de l’ingénierie financière et des
télécommunications qui permettent l’interconnexion des marchés qui peuvent
fonctionner en instantané, les produits dérivés issus des actifs financiers (créances
primitives, actions, obligations) qui prennent une place importante et circulent entre
les agents financiers. A cela s’ajoute une grande diversification des acteurs financiers
qui deviennent, du reste, de plus en plus imbriqués comme les fonds de retraite et de
pension, les investisseurs institutionnels, les fonds d’investissements collectifs, les
compagnies d’assurance. Ces multiples innovations sont sources d’instabilité du fait
de leurs effets ambivalents.
Pour ce qui est de la seconde caractéristique, elle est relative à la suprématie de
la finance et son contrôle sur tous les acteurs de la production des biens, des services
et des innovations ainsi que ceux de la consommation. Effet, les politiques de
libéralisation et de privatisation ont largement facilité cette forte emprise de la haute

3
finance sur le système productif. Dès lors, ce pouvoir exorbitant de la finance fait que
sa déstabilisation se répercute immédiatement sur le rythme de croissance des
économies, l’emploi et le bien-être des populations.
Le système financier international est particulièrement marqué par une
logique purement spéculative. En effet, « les
marchés financiers sont des « marchés
de promesses »: nul ne sait ce que sera demain le « bon niveau » d'un taux d'intérêt,
d'un taux de change ou du cours d'une action. Cette incertitude engendre une grande
variabilité des paris effectués par les intervenants qui préfèrent généralement suivre
la tendance générale et avoir tort avec les autres plutôt que raison tout seuls ». En
simple, les actifs de crédits se divisent en trois catégories : les actifs à bas risques qui
rapportent peu mais sont très sûrs, ensuite les crédits plus risqués financièrement
assez intéressants et enfin les crédits à très haut risque, dont font partie les
« subprimes ». Ces actifs sont mis en circulation sur les marchés financiers où ils sont
achetés par des banques du monde entier. Dans un système aussi fortement
imbriqué, les difficultés d’un acteur se propagent, par effet de domino, à l’ensemble
des autres acteurs du marché. R.BOYER souligne que les acteurs bancaires et
financiers ont tendance à prendre d’autant plus de risques que la conjoncture est
bonne et d’autant moins lorsque les perspectives sont défavorables.
Au total, le capitalisme financier présente quatre éléments de fragilité qui sont
à la base de la crise qu’il traverse actuellement à savoir :
- L’incapacité de mesurer la quantité et la qualité de moyen de paiements au
niveau mondial du fait de la multiplicité des produits comme les produits dérivés
dont personne ne sait comment les gérer ;
- La difficulté à contrôler les activités des établissements financiers qui sont
trop entrelacés avec des conglomérats qui brassent des ressources financières
astronomiques;
- La montée en puissance des finances illégales provenant de la corruption
des rapines, de la drogue de l‘argent sale qui est à la recherche d‘espace de
blanchiment. Le produit criminel brut est estimé à beaucoup plus de 1000 milliards
de dollars (3 fois la dette africaine) ;
- La montée des risques et des incertitudes qui sont nourris très fortement par
la spéculation. Observons que les fameux 1400 milliards de dollars qui s’échangent
chaque jour sont pour beaucoup dans l’instabilité des taux de change qui encourage à
leur tour la hausse des taux d’intérêt déclenchant alors la spirale spéculative
conduisant directement aux bulles financières.
Cette constellation de faits corrélés et totalement incontrôlés avait conduit le
Prix Nobel d’économie Robert FOGEL à se demander s’il y avait un pilote dans l’avion
mondial. En d’autres termes, les marchés financiers paradoxalement ne sont régis par
aucune règle et son sans aucun encadrement. Cela explique leur fonctionnement dans
l’opacité la plus totale que même les ultra-libéraux dénoncent avec beaucoup de
véhémence. Il n’existe dans pareille situation aucun mécanisme non marchand de
protection des plus faibles et de correction des déséquilibres qui naissent des
rapports de force inégaux.
Que faire? La rapidité de la propagation ainsi que les désastres attendues,
particulièrement, au niveau de l’économie réelle, rendent les recherches de solution
urgente et impérative. En effet, cette crise est d’autant plus grave qu’elle a pris source
aux Etats-Unis, le cœur même du système capitaliste mondial que FUKUYAMA avait
magnifié comme le parachèvement des valeurs libérales au plan économique,
politique et même culturel et qui matérialise en ce 21
ème
siècle «La fin de l’histoire ».
C’est donc bien une crise du modèle capitaliste : il semble que nous ayons

4
heureusement atteint les limites d’un système prédateur reposant sur la captation par
le capital de la valeur ajoutée et sur une dérégulation à outrance, mais rien
aujourd’hui ne permet de croire que l’issue de la crise débouchera sur une remise en
cause profonde du système économique et financier.
II/ Face à la crise, les Etats et les banques centrales montent
des Plans de sauvetage et de recapitalisation aux montants
astronomiques : quelques 2700 milliards.
On peut facilement constater aujourd’hui que la crise financière internationale
entraîne un ensemble de dysfonctionnement du système mondial avec :
- la récession qui pointe et qui, sans nul doute, va entrainer pour sûr un
ralentissement de la croissance économique qui se répercutera négativement sur le
système mondial de la triple dépendance de la production, des échanges, des finances
et des technologies ;
- le chômage et la détérioration du pouvoir d’achat ainsi que la baisse de la
consommation qui en résulterait. Ce fait est la suite de l’aggravation de la crise
latente du fordisme qui se manifeste dans les fortes inégalités des productivités du
travail ;
- des marchés contestables mais où progressivement la concurrence n’est ni
pure ni parfaite avec l’avènement des subventions et des protectionnismes de plus en
plus intelligents et des marchés financiers dominants mais marqués par des
turbulences aux conséquences graves ;
- la multiplication des risques pays défini comme le risque de matérialisation
d‘un sinistre, résultants du contexte économique et politique d’un Etat étranger, dans
lequel une entreprise effectue une partie de ses activités ;
- le retour de la contestation des institutions et des systèmes de gouvernance
de l’ordre mondial qui, une fois encore, vont révéler leur incapacité notoire à réguler
l’ordre économique et financier mondial. L’exigence de leur réforme reviendra
impérativement à l’ordre du jour.
Aujourd’hui, tous ces éléments se conjuguent dans un ensemble où les
marchés financiers ont acquis un pouvoir économique exorbitant tel qu’ils sont à
même de déstabiliser l’ensemble de l’économie mondiale. La globalisation est alors
plongée dans un crash qui n’épargne aucun des acteurs du jeu économique et
financier : les Etats, les entreprises multinationales, les PME/PMI et les citoyens.
Dans cette crise, les solutions s’organisent autour d’une série d’actions
spectaculaires dont les objectifs majeurs se réduisent à ramener la confiance au
niveau des marchés :
- Intervention massive des Etats pour réguler les marchés et conjurer leur
dysfonctionnement ;
- Recapitalisation des banques menacées de faillite ;
- Action des Banques centrales pour accroître la liquidité ;
- Encouragements et incitations pour la reprise des prêts interbancaires.
Après les Etats, les banques centrales montent en première ligne et ont à leur
disposition deux mesures. La première consiste à changer leur taux directeur et la
deuxième à injecter de l’argent dans les établissements en difficulté (nationalisation)
ou aux banques qui rachètent leurs consœurs en faillite. D’ailleurs, ces deux mesures
ne sont pas exclusives. L’objectif visé est d’accroître les liquidités pour pallier un
éventuel risque de pénurie de disponibilités de crédit qui compromettrait la
croissance de la production et la consommation.

5
Toutefois, l’ampleur de la crise actuelle a amené des révisions déchirantes de la
philosophie de l’action de l’ultra libéralisme qui découvre que J.M.KEYNES n’était
pas un bolchévik impénitent et que l’Etat contrairement à toutes les affirmations
précédentes n’est pas le problème mais la solution. Dans la même foulée, on
redécouvre la critique keynésienne du statut de la monnaie internationale ainsi que
sa proposition de création d’un système public de paiement et une monnaie
spécifique pour les règlements internationaux. A y regarder de plus près, les principes
fondateurs de l’ultra libéralisme sont remis en question, entre autres:
- La croyance aux vertus des mécanismes des marchés et à leur capacité à
allouer de façon optimale les ressources. Les tenants des cordons de la
bourse ne louent plus les vertus du marché libres.
- La non intervention de l’Etat dans l’économie pour rétablir les équilibres et
relancer la machine.
- La circulation sans entrave des biens, des capitaux et des services.
Il est vrai que lorsque les résultats sont aussi désastreux, le discours
idéologico-théorique perd complètement de sa crédibilité.
Conscients des dangers énormes qui les guettent les Etats des pays développés
préparent partout des plans de sauvetage qui mutualisent les pertes des sociétés
financières et les renflouent par des mises très fortes : 700 milliards aux Etats-Unis,
1700 milliards d’euros (mobilisés dans le désordre, puis coordonnés) en Europe, plus
de 100 milliards en Asie et au Japon et quelques 200 milliards en Russie. Et ce n’est
pas encore fini car il n’existe aucune assurance que la reprise sera effective : ces
mesures, malgré le volume démesuré des ressources mobilisées couvrent
actuellement les 1400 milliards de dollars de pertes calculées par les experts du FMI.
De plus, l’argent injecté ne produira pas des effets drastiques et immédiats.
Cependant, les interventions massives des banques centrales et des Etats
établissent que la finance internationale sort grand « gagnant » de la crise avec la
socialisation de ses pertes : les perdants seront, pour une fois encore, les pauvres de
la mondialisation qu’ils soient au centre du système ou à sa périphérie, c’est—à-dire
ceux pour qui il n’est prévu ni parachute, ni filet de protection. Comme l’observait
Alan GRENSPAN, « l’exubérance irrationnelle des marchés » et la mauvaise gestion
sont récompensées. En effet, outre les fautes de gestion, leur trop grande
irresponsabilité, les capitalistes financiers ne risque rien dans la catastrophe
mondiale qu’ils ont déclenché : les profits sont privatisés et les pertes socialisées.
III/ Face à la crise, l’Afrique est sans réaction : elle minimise les risques
mais ne prend aucune initiative d’envergure pour le long terme.
Même si c’est faiblement, l’Afrique est tout de même insérée dans le système
mondial bien que de façon assez contrastée. Quatre éléments apparaissent pour
indiquer les secteurs africains exposés à la crise:
- les bourses peuvent être affectées par la crise de liquidité là ou elles
fonctionnent (au Maghreb, en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigéria et en
Afrique de l’Ouest) ;
- l’Aide Publique au Développement malgré la faiblesse des engagements
devrait diminuer (les donateurs ayant d’autres préoccupations),
- les IDE qui avaient commencé à prendre la direction de l’Afrique risquent
d’être freinés ;
- les matières premières et les exportations en direction des pays en crise
peuvent subir des évolutions drastiques.
Que deviendront les opérations d’investissements en cours ? Les marchés des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%