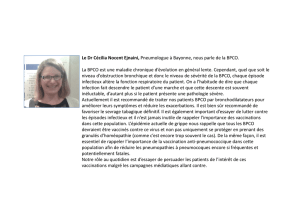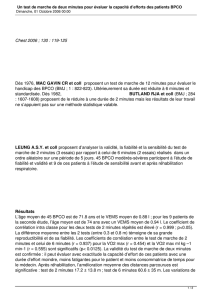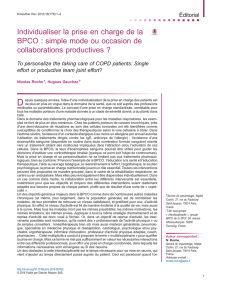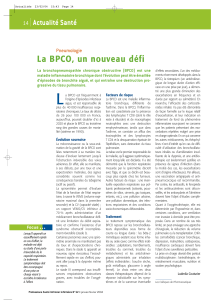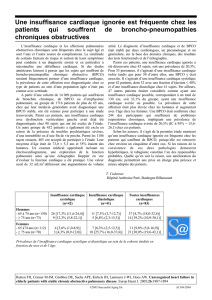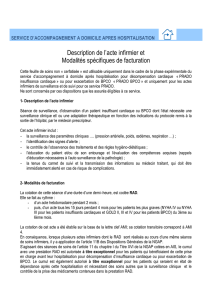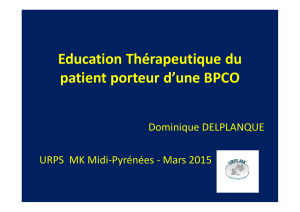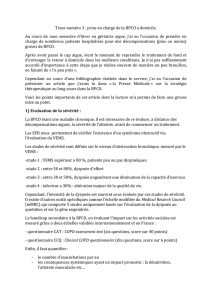E Les naufragés de la BPCO : quelle prise en charge au-delà

112 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
Actualités dans
LA PRISE EN CHARGE
DE LA BPCO
Les naufragés de la BPCO :
quelle prise en charge au-delà
des bou(ff)ées inhalées ?
At the rescue of drowning COPD patients: approaches
beyong the life-vest
B. Aguilaniu*
* Faculté de médecine, université
Joseph-Fourrier, Grenoble ; depart-
ment of physical education, McGill
university, Montréal.
En raison de son acronyme réducteur, la BPCO
(bronchopneumopathie chronique obstruc-
tive) est envisagée essentiellement comme une
maladie bronchique obstructive, parfois accompa-
gnée d’une destruction alvéolaire. En conséquence,
les médecins et les patients considèrent que l’essen-
tiel du traitement de la maladie consiste à adminis-
trer des substances bronchodilatatrices qui soulagent
le symptôme cardinal : la dyspnée (1). Par ailleurs,
plusieurs études convergent pour attribuer à ces
médicaments (relaxant le muscle lisse bronchique
ou inhibant sa contraction) des effets bénéfi ques sur
l’incidence des exacerbations, qui semble réduite de
20 à 30 % lorsque la bronchodilatation est optimisée.
Chez les patients qui présentent plus de 2 exacer-
bations par an, les corticoïdes inhalés semblent
apporter un avantage supplémentaire pour prévenir
la survenue d’une exacerbation infl ammatoire, au
prix d’un risque accru de contracter une pneumo-
pathie infectieuse (2). Enfin, l’oxygéno thérapie
continue concernera les cas les plus sévères, qui
représentent environ 15 % de la population globale.
Ce résumé de la BPCO et de son traitement, s’il
correspond aux données des études observation-
nelles et interventionnelles, ne refl ète pas toute
la réalité des patients vus en consultation externe
ou au cours d’une hospitalisation. En effet, même
si la BPCO est une maladie très courante dont la
défi cience fonctionnelle (le trouble obstructif) est
globalement bien prise en charge, sa gestion inté-
grée n’est en fait pas codifi ée. Car, pour certains
patients, la BPCO est une maladie systémique,
grevée de comorbidités cumulées, et dont le
handicap s’aggrave au fi l du temps, en dépit d’un
traitement inhalé adapté.
Par “systémique”, il faut comprendre que les défi -
ciences anatomiques et fonctionnelles constatées au
niveau des voies aériennes ne sont que les maillons
initiateurs d’une chaîne morbide qui comprendra tôt
ou tard une réduction de la masse et de la fonction
musculaires et une altération des fonctions cognitives
conduisant à une incidence d’anxiété et de dépres-
sion plus de 2 fois supérieure à celle des sujets d’âge
comparable. À ces défi ciences identifi ées s’ajoute
sournoisement, chez environ 20 % des patients, un
état d’infl ammation chronique de bas grade que la
biologie courante actuelle ne sait pas déceler. Ce
silencieux désordre est très probablement un déter-
minant des fréquentes morbidités métaboliques
(diabète, syndrome métabolique) et cardiovasculaires.
Par “handicap”, il faut comprendre l’appauvrissement
des activités de la vie quotidienne et la diminution
drastique du temps consacré à ces activités (appelé
aussi “participation” ou “performance”), dont la plus
commune et la plus affectée est le temps de marche
journalier (1).
Ce sont ces patients, dont le déclin n’est pas unique-
ment ventilatoire, qu’il faut considérer comme des
“naufragés de la BPCO”, car l’optimisation des trai-
tements inhalés ne parvient pas à endiguer la dérive
de leur qualité de vie, de leur état de santé, et du
coût socio-économique liée à la maladie.
On voit que l’ambition de prendre en charge une
patientèle BPCO hétérogène, en prenant en compte
toutes les dimensions de la maladie, est démesurée
pour un pneumologue isolé dans sa consultation
ambulatoire (libérale ou hospitalière), sachant que
le temps consacré au patient, en dehors de la réali-
sation de la fonction respiratoire, est en moyenne
de 15-20 minutes 2 fois par an !

La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013 | 113
Points forts
»
Une médecine holistique de la BPCO commence là où les médicaments ont atteint leur maximum
d’efficacité.
»
Elle est basée sur le partage des savoir-faire, car le pneumologue ne peut pas, à lui seul, résoudre
toutes les facettes de la chronicité.
»L’influence est une posture médicale pour amener le patient à des interactions susceptibles d’initier
le désir de changement.
»
Les savoir-faire informels, l’influence thérapeutique et la coordination des soins sont des domaines
propices à l’évaluation, au même titre que les médicaments.
»
Une consultation web de la BPCO pour mieux gérer toutes les dimensions de la maladie chronique :
www.colibri-bpco.fr
Mots-clés
BPCO
Réhabilitation
Savoir-faire
Handicap
Web BPCO
Highlights
»
Holistic treatment of COPD
starts at the point where drugs
have attained their maximum
effectiveness.
»
This type of treatment is
based on shared competence,
since the respirologist alone
cannot treat all the chronic
manifestations of the disease.
»
Influence is a medical
attitude aiming to incite the
patient to engage in interac-
tions likely to awaken a desire
for change.
»
“Know how”, therapeutic
infl uence and treatment coor-
dination are suitable evaluation
strategies, in the same way as
drugs.
Keywords
COPD
Disease management
Care
Know how
Web COPD
Pour quel patient, pour quel pourcentage de sa
patientèle le pneumologue doit-il être le coor-
donnateur des soins de la BPCO ? Il nous semble
légitime de prendre cette position de coordonna-
teur lorsque la BPCO s’accompagne d’un handicap
signifi catif, d’exacerbations répétées, ou lorsque
l’évolution (jugée avec un recul de 3 ans au moins)
est marquée par un déclin de la fonction respira-
toire ou de la qualité de vie. On peut estimer (en
l’absence de données observationnelles en vraies
vies) que ces conditions concernent environ 30 % des
patients BPCO tout-venant avec une proportion plus
importante de patients en GOLD III et IV, même si
un pourcentage non précisément connu de GOLD II
est concerné par ces critères. Il faut aussi rappeler
que le déclin du VEMS ne concerne en défi nitive que
38 % des patients traités.
En conséquence, le pneumologue devrait être aussi
attentif à détecter une accentuation du handicap
(dont les principaux déterminants ne sont pas respi-
ratoires), qu’à mesurer les variations de la fonction
respiratoire (1, 3).
La thérapeutique non
médicamenteuse de la BPCO
Comme pour toute maladie chronique, la thérapeu-
tique non médicamenteuse de la BPCO se fonde sur
une planifi cation et une gestion des mesures béné-
fi ques pour la santé. Aussi, le médecin doit déter-
miner des objectifs thérapeutiques parmi les 4 cibles
identifi ées pour la BPCO en général (tableau) et
décider lesquels sont nécessaires et possibles pour
chaque patient.
Chacun sait en effet que certains patients très
obstructifs ne présentent pas ou peu de handicap,
tandis que d’autres, atteints de dyspnée légère
ou dont la fonction respiratoire est peu altérée,
réduisent drastiquement leurs activités journalières.
Dès lors, comment prendre en charge le handicap
si la dyspnée n’est pas le déterminant majeur ou si
le traitement bronchodilatateur, en soulageant la
dyspnée, n’empêche pas le déclin de la qualité de
vie ? En d’autres termes, quel est “l’indispensable
soin” qui rend possible la réussite de la prise en
charge et… justifi e que le pneumologue s’occupe
de la BPCO ? S’agit-il de prescrire des médicaments
ou de “prendre soin” au sens développé par la réha-
bilitation ou les théories du “care” ?
Si l’on souhaite “prendre soin” des patients BPCO,
les questions viennent en cascade ; par exemple :
–Dois-je assurer une prise en charge intégrée ou
limiter mon action à l’optimisation du traitement
respiratoire ?
–Comment coordonner avec le médecin référent
le diagnostic et la prise en charge des comorbidi-
tés ? En d’autres termes, qui s’occupe de quoi, et de
quelle manière ?
–Comment détecter les patients dont la qualité de
vie et le handicap ont une propension à se dégrader
et cela est-il utile ?
–Comment évaluer les déterminants du handi-
cap et quelles sont les conséquences pratiques à le
faire ?
–Si je peux évaluer à chaque consultation l’effi -
cacité d’un traitement bronchodilatateur par la
fonction respiratoire et l’interrogatoire, comment
et à quel rythme dois-je évaluer la qualité de vie, le
handicap et les comorbidités ?
La littérature fournit à ces interrogations des
réponses partielles et qui concernent le plus souvent
des populations non représentatives de la patien-
tèle habituelle en pneumologie. On y lit aussi des
évidences telles que “plus on est dénutri ou incapable
de marcher à plus de 3 km.h-1 en 6 minutes, plus on
Tableau. Les 4 objectifs cardinaux de la prise en charge d’un
patient BPCO.
1. Réduire le handicap (selon OMS 2002)
- Soulager les symptômes (dyspnée)
- Améliorer les défi ciences fonctionnelles respiratoires,
musculaires, cardiocirculatoires
- Favoriser la participation aux activités
- Développer les activités
2. Réduire les exacerbations et les hospitalisations
3. Maintenir une qualité de vie satisfaisante
4. Traiter effi cacement les comorbidités métaboliques
etcardiovasculaires
5. Prévenir les comorbidités

114 | La Lettre du Pharmacologue • Vol. 27 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2013
Les naufragés de la BPCO :
quelle prise en charge au-delà des bou(ff)ées inhalées ?
Actualités dans
LA PRISE EN CHARGE
DE LA BPCO
risque d’être hospitalisé ou de mourir”. L’identifi ca-
tion des phénotypes par des méthodes statistiques
sophistiquées permet tout au plus de valider ce que
l’expérience clinique a intuitivement reconnu. La
prise en charge non médicamenteuse doit donc
s’appuyer sur une clinique nouvelle de la BPCO, en
faisant l’effort de considérer que la défi cience venti-
latoire n’est pas forcément le point central de nos
actions, à l’exception des patients en insuffi sance
respiratoire chronique sévère nécessitant une assis-
tance ventilatoire sophistiquée.
Valoriser le savoir-faire (4, 5)
Quatre des 5 objectifs cardinaux (2-4, 6) de la prise
en charge du patient BPCO (tableau, p. 113) corres-
pondent à la définition et aux buts de la réhabi-
litation (6). C’est dire que chaque pneumologue
est obligatoirement impliqué dans un processus
de réhabilitation et y tient même la position
centrale. Comme le chef de cuisine qui maintient
son réseau de fournisseurs et coordonne les actions
de ses collaborateurs pour faire émerger les goûts,
les odeurs et les textures, le chef d’orchestre de
la maladie chronique respiratoire doit déléguer,
animer et évaluer (goûter). L’analogie n’est pas
triviale, car il s’agit dans les 2 cas de faire coexister
expérience intuitive, rigueur, art et créativité. Quel
secret (recette) pour permettre au patient de tolérer
sa dyspnée une fois que le traitement inhalé l’aura
soulagé partiellement ? Comment rendre un patient
plus actif pour réduire le risque cardiovasculaire et
le handicap, alors que la dyspnée ou le contexte
social sont des obstacles ?
Ce “know how” est une dimension de la médecine
qu’il faut revendiquer et valoriser (7, 8). Depuis de
nombreuses années, des praticiens de terrain ont
conseillé à leur patients dyspnéiques de marcher
tous les jours en écoutant de la musique, mais
c’est en 2010 que des études neurophysiologiques
ont montré une amélioration considérable de la
dyspnée chez des sujets soumis à des interactions
auditives ou visuelles plaisantes (9). Pour pallier ou
compenser la nature souvent empirique du savoir-
faire, les pneumologues peuvent aujourd’hui se doter
d’outils permettant d’évaluer leur pratique médicale
et d’analyser les caractéristiques de leur patientèle
afi n de mettre en place des actions thérapeutiques
ciblées.
La nouvelle génération de pneumologues devra
défendre une clinique holistique des maladies chro-
niques respiratoires, en élaborant une méthodologie
d’évaluation de son savoir-faire et des recomman-
dations scientifi ques, à partir d’outils informatiques
comme les consultations Web (COLIBRI-BPCO,
www.colibro-bpco.fr). Ainsi, nous pourrons promou-
voir, individuellement ou collectivement, des propo-
sitions de soins non médicamenteux réellement
créatives, car émergeant de la clinique quotidienne.
Infl uence
ou éducation thérapeutique ?
Les termes “infl uence” et “éducation” véhiculent
une connotation qui peut faire oublier que ces
procédés ont un objectif commun : pousser le patient
à adopter des attitudes bénéfi ques pour sa santé et
pour sa qualité de vie. Si l’infl uence peut être utilisée
avec empathie et méthode, elle est néanmoins un
pouvoir sans contrôle, ce qui relègue ce procédé
thérapeutique au rang des pratiques inavouables. À
l’inverse, depuis quelques années, l’éducation théra-
peutique est réglementée, et quiconque veut s’en-
gager dans ce processus doit remplir des obligations
dont certaines relèvent de l’éducation proprement
dite, c’est-à-dire de l’apprentissage de la maladie
ou de ses traitements. Néanmoins, les 2 procédés
reposent sur l’idée qu’il faut créer les conditions d’un
changement de comportement durable et favorable
à la santé.
Les programmes d’éducation thérapeutique étant
très peu financés, le médecin est le plus souvent
confronté au choix de laisser faire ou de tenter, à
travers sa relation thérapeutique, d’influencer le
comportement du patient. Parfois, il s’appuiera
sur un rationnel glané empiriquement auprès des
sciences sociales, psychologiques ou de l’éduca-
tion. Le plus souvent, il suivra son intuition clinique
et son propre désir d’intervenir dans le désir de
l’autre. Comme le choix est finalement déter-
miné par les conditions d’exercice, pourquoi ne
pas accepter que la médecine, même spécialisée,
est aussi une histoire qui se joue entre 2 individus,
dont l’un admet que l’autre a une connaissance
sur sa propre personne. Dans cette configura-
tion, le pneumologue doit réfléchir à la manière
dont l’influence thérapeutique peut compléter la
pratique scientifique et rigoureuse de sa spécialité.
L’influence thérapeutique évoquée ici n’est pas
un pouvoir personnel, qui s’apparenterait alors à
une manipulation ou au charlatanisme. C’est au
contraire une posture relationnelle qui a pour objet
de faire accéder le patient à d’autres influences,
sans préjuger de celle qui sera efficace en défini-

Actualités dans
LA PRISE EN CHARGE
DE LA BPCO
1. Aguilaniu B, Plaindoux A, Brosson C, Jeanmart M, Maitre J,
Diab S. Mécanismes intégrés de la dyspnée et du handicap
au cours de la BPCO. Presse Med 2009;38(3):413-20.
2. Crim C, Calverley PM, Anderson JA et al. Pneumonia
risk in COPD patients receiving inhaled corticosteroids
alone or in combination: TORCH study results. Eur Respir
J 2009;34(3): 641-7.
3. Vestbo J, Edwards LD, Scanlon PD et al.; ECLIPSE Inves-
tigators. Changes in forced expiratory volume in 1 second
over time in COPD. N Engl J Med 2011;365(13):1184-92.
4. Nelson K, Nelson RR. The cumulative advance of
human know-how. Philos Trans A Math Phys Eng Sci 2003;
361(1809):1635-53.
5. Mulhall A. Bridging the research-practice gap: breaking
new ground in health care. Int J Palliat Nurs 2001;7(8):
389-94.
6. Aguilaniu B, Ouksel H, Desplan J, Gindre D, Gros-
bois JM. Question 1. Respiratory therapy for chronic
obstructive pulmonary disease. Rev Mal Respir 2005;
22(5 Pt 3):7S15-7S6.
7. Paley J. Clinical cognition and embodiment. Int J Nurs
Stud 2004;41(1):1-13.
8. Kayes NM, McPherson KM. Human technologies in reha-
bilitation: ’Who’ and ’How’ we are with our clients. Disabil
Rehabil 2012;34(22):1907-11.
9. Schön D, Dahme B, von Leupoldt A. Associations between
the perception of dyspnea, pain, and negative affect. Psycho-
physiology 2008;45(6):1064-7.
10. Roberts M. Time, human being and mental health care: an
introduction to Gilles Deleuze. Nurs Philos 2005;6(3):161-73.
Références bibliographiques
L’auteur déclare
ne pas avoir de liens d’intérêts.
tive. Cette posture est guidée par une réflexion
élaborée autour de chaque patient, à partir des
objectifs thérapeutiques rappelés plus haut. Elle
doit mener le patient à d’autres interactions qui
initieront le désir de changement. Les prescriptions
formelles (par exemple l’entraînement à l’exer-
cice ou les séances de massage) sont, en plus de
leur bénéfice potentiel, l’occasion d’interactions
avec des personnes, des lieux et des perceptions.
C’est surtout l’effet de la “déterritorialisation” de
la maison au cabinet médical, en déclenchant des
“agencements désirants”, qui induira peut-être
une volonté de changement (10). Sur ce moment
à saisir, d’autres thérapeutiques complémentaires
(non médicamenteuses) pourront être proposées
qui, en plus de leurs actions physiologiques suppo-
sées, compléteront le maillage propice à un chan-
gement de comportement prolongé.
Les thérapeutiques non médicamenteuses de la
BPCO mettent le pneumologue face à un triple défi :
➤
être le coordonnateur des soins des patients
BPCO “naufragés” qui nécessitent prioritairement
une expertise pneumologique ;
➤
développer des savoir-faire et acquérir les
moyens de les évaluer ;
➤
et donc évaluer les caractéristiques (phénotypes)
de sa patientèle. ■
Découvrez le premier numéro sur
http://education-therapeutique.edimark.fr
Nouvelle formule
Octobre-Novembre-Décembre 2013
01
Association française
pour le développement
de l’éducation thérapeutique
Association régie selon la loi de 1901
Société éditrice : EDIMARK SAS
CPPAP et ISSN : en cours
Trimestriel
Octobre-Novembre-Décembre 2013
20 €
Premier numéro déjà disponible
*
Abonnez-vous au 01 46 67 62 74 / 87
Publication trimestrielle
EDIMARK éditeur de la nouvelle publication de l’AFDET
Former, informer !
Éducation thérapeutique :
comment vous former et informer vos patients
Publication à destination de tous les professionnels de santé
1
/
4
100%