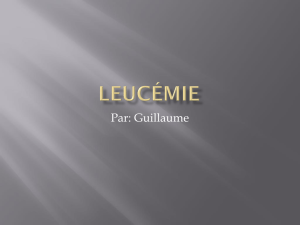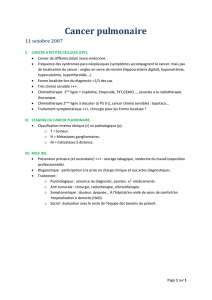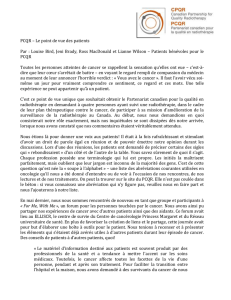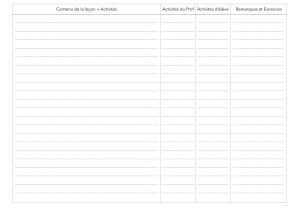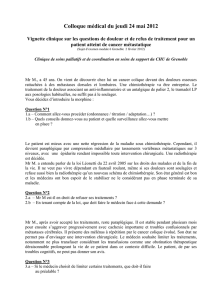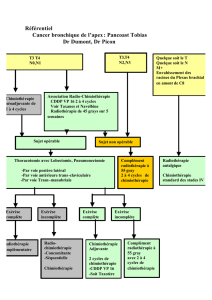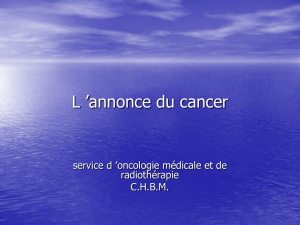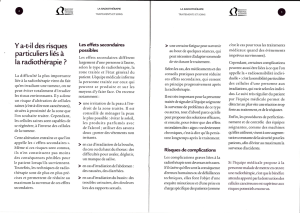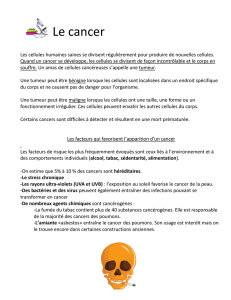Télécharger le PDF - Institut Roi Albert II

Cliniques
universitaires Saint-Luc
Av Hippocrate, 10
1200 Bruxelles
Belgique
Tel: 02/764.11.11
Fax: 02/764.37.03
www.saintluc.be
•Approches Thérapeutiques
Actuelles du Mélanome
de l’Uvée
•Congélation du
tissu ovarien avant
chimiothérapie.
•Le congrès
de l'ESTRO 2006.
Dans cenuméro
NEWSLETTER 2 - MARS 2007
Innovation
Research
Care
Excellence

Our commitment
in Oncology

Pluriels. La seconde livraison de notre «newsletter», riche des contributions
d’un ophtalmologue (cf. l’article du Prof. P. De Potter), d’un gynécologue (cf.
l’article du Prof. J. Donnez), d’un pneumologue (cf. l’article du Dr. Th. Pieters),
d’un hématologue (cf. l’article du Prof. A. Ferrant), illustre à quel point la prise en
charge optimale du patient cancéreux requiert la concertation multidisciplinaire
telle qu’elle est orchestrée dans le cadre des programmes de soins en oncologie.
La cancérologie, discipline à temps plein pour les uns (radiothérapeutes oncologues,
oncologues médicaux), spécialité dans les spécialités pour les autres, discipline d’espoir
et de crainte (le cancérologue n’est pas installé confortablement dans le traitement de
maladies spontanément curables), est partie intégrante de la pratique de tout médecin
en ce compris les omnipraticiens.
Acet égard, la récente reconnaissance officielle de l’Oncologie médicale, spécialité qui
existait de facto en Belgique depuis plusieurs décennies, va dans le sens d’un aggiorna-
mentolongtemps attendu et augure d’une volonté de modernisation de la part des
autorités de Santé Publique pour le plus grand bien de nos patients.
Plurielle, la diversité des talents des acteurs médicaux, paramédicaux, biologistes …
Elle est distribuée tout au long d’une activité de recherche qui va du lit du malade à la
paillasse de laboratoire en un incessant aller-retour. A une extrémité les cliniciens plein
temps, à l’autre les fondamentalistes purs et durs, au centre les pilotes d’une recherche
de transfert… De ces derniers est attendue une double humilité vis-à-vis de leurs parte-
naires cliniciens ou fondamentalistes. Le plus souvent ce sont eux les animateurs des
sociétés savantes et des colloques scientifiques (cf.les comptes-
rendus du Prof. V.Gregoire et du Prof. R. Opsomer). Il faut veiller à
cequ’ils ne soient pas assis entredeux chaises et qu’ils trouvent
toujoursune placeoù se poser lorsque leursactivités reprennent
une tournureplus routinière.
Tous, dans ce combat gratifiant mais moralement lourd contre la
maladie cancéreuse, sommes soutenus par l’espoir d’avancées
scientifiques et de progrès thérapeutiques rapides. C’estpourquoi
notreprochaine newsletter seraentièrement consacrée à
donner un aperçu des différents programmes de recherches
cliniques, translationnelles et fondamentales en cours aux
Cliniques Universitaires Saint-Luc et dans les laboratoires de
notreAlma-Mater.
Plurielles enfin les équipes de cliniciens extérieures partenaires
de notreCentredu Cancer.Il estprévu également de présenter
leur originalité et leursspécificités dans un prochain numéro.
A tous, bonne lecture.
edito
Prof Michel SYMANN
Rédacteur en chef
Oncologue médical
PLURIELS :
NOUS SOMMES TOUS DES CANCEROLOGUES !
sommaire
Approches Thérapeutiques Actuelles
du Mélanome de l’Uvée.
Prof Patrick De Potter........................................ 4
Congélation du tissu ovarien
avant chimiothérapie.
Prof Jacques Donnez........................................... 7
Evolution dans la stadification clinique
du cancer bronchique. L’arrivée de
l’échographie endobronchique.
Docteur Thierry Pieters................................. 10
L'approche thérapeutique
de la leucémie myéloïde aiguë.
Prof Augustin Ferrant....................................... 12
Le congrès de l'ESTRO 2006
Prof Vincent Gregoire........................................ 16
Xe symposium du Centre de Pathologie
Sexuelle Masculine (C.P.S.M.)
18-11-2006. Thème : Onco-Sexologie
ou Sexualité et Cancer.
Prof Reinier Opsomer ....................................... 18
News..............................................................................20

chimiothérapiques a déjà été intensément
exploitée dans le traitement de tumeurs
malignes in vitro et in vivo. Le terme de
thermothérapie s’applique au traitement
hyperthermique induisant une température
tissulaire supérieure à 45°C et inférieure à
60°C dans le but d’obtenir un effet direct
létal cellulaire permanent jusqu'à une pro-
fondeur tissulaire de 4.0mm sans l’effet
photocoagulant. Dans la thermothérapie
transpupillaire (TTT) du mélanome de la
choroïde, un faisceau laser diode infrarouge
(810 nm) est émis d’une source portable
adaptée sur la lampe à fente et focalisé sur
la tumeur par un verre de contact rétinien.
La TTT a l’avantage de pouvoir se pratiquer
en ambulatoire(Figure 1) nécessitant
seulement une anesthésie rétrobulbaireet
d’êtrerépétée facilement; le but étant
d’obtenir une cicatrice tumorale atrophique.
La TTT a été utilisée comme une approche
thérapeutique de premièreintention du
mélanome de la choroïde ou en com-
plément d’une radiothérapie de contact
(thérapie “sandwich” ou délimitante).
(Figure 2A et 2B) Dans notre expérience
incluant 80 mélanomes de la choroïde
traités exclusivement par thermothérapie,
le succès thérapeutique rapporté est de
94% après une moyenne de 3sessions.
Laradiothérapie soit par irradiation externe
(en autrela protonthérapie non utilisée en
Belgique) ou soit de contact (brachythérapie)
offreaux patients présentant un mélanome
de la choroïde une confortablealternative à
l’énucléation notamment lorsque l’état
général du patient contre-indique une
résection tumorale ou que la taille et la loca-
lisation de la tumeur ne constituent pas l’in-
dication d’un traitement par TTT.
Dans la radiothérapie de contact par
plaque, plusieursisotopes peuvent être
utilisés. [1,2,23,24] L’avantage de l’iode 125
(à irradiation de faible énergie) que nous
utilisons à l’Unité d’Oncologie Oculaire est
une meilleure pénétration tissulaire et la
possibilité de placer les grains radioactifs
sur la plaque de support en or afin de
garantir une distribution homogène de
Chez l’adulte, la tumeur intraoculaire
maligne la plus fréquente est le mélanome
de l’uvée (choroïde et corps ciliaire). Durant
cettedernière décennie, de nouveaux
concepts dans le traitement du mélanome
de la choroïde ont vu le jour avec une
tendance de plus en plus prononcée pour
une approche conservatrice évitant une
chirurgie d’énucléation (retrait chirurgical
de l’oeil) qui était encore il y a dix ans le
traitement de choix du mélanome intra-
oculaire. Ceci d’autant plus que la Colla-
borative Ocular Melanoma Study (COMS),
étude prospectiverandomisée multicentri-
que initiée aux Etats-Unis pour essayer de
répondre à plusieurs questions sur l’appro-
che thérapeutique du mélanome de la
choroïde et notamment sur l’impact de
l’énucléation ou de la radiothérapie sur la
maladie métastatique n’a montré aucun
bénéficestatistiquement significatif d’une
énucléation sur la survie du patient par
rapport à un traitement conservateur.
Laphotocoagulation au laser, la radiothé-
rapie, la résection tumorale, l’énucléation,
et l’exentération font toujours partie de
notre arsenal thérapeutique mais leurs
indications et modalités techniques ont été
redéfinies au cours de ces dernières
années à l’Unité d’Oncologie Oculaire des
Cliniques universitaires Saint-Luc.
Parmi les nouvelles armes thérapeutiques,
nous avons actuellement à notre disposition
la thermothérapie transpupillaire. L’action
synergique hyperthermie - radiations
ionisantes et hyperthermie - agents
PROF PATRICK DE POTTER OPHTALMOLOGUE
DOCTEURS JEAN-FRANÇOIS BAURAIN, LORETTE RENARD, CATHERINE GODFRAIND.
4
Approches Thérapeutiques Actuelles
du Mélanome de l’Uvée
Figure 1
Séance de traitement
par thermothérapie transpupillaire
Figure 2A
Mélanome de la choroïde avant (A)
et après traitement par plaque d’Iode
125 radioactif et thermothérapie
transpupillaire adjuvante (B).
Anoter absence de complications au pôle
postérieur oculaire.
Figure 2B

L’énucléation reste le choix thérapeutique
obligatoire lorsque la tumeur est trop large
pour être traitée par radiothérapie, résec-
tion tumorale, thermothérapie transpupil-
laire, ou photocoagulation au laser. La
présence d’un décollement rétinien total,
d’un glaucome néovasculaire, d’une infil-
tration de la tête du nerf optique, ou d’une
extension extrasclérale orbitaire constitue
également l’indication d’une énucléation.
Lorsque la composante extra-oculaire est
trop importante pour envisager une énu-
cléation du globe oculaire, une chirurgie
d’exentération avec épargne palpébrale
devra être considérée. L’utilisation dans
notre technique chirurgicaled’implant en
matériel poreux comme l’hydroxyapatite
(FCI®,BioEye®)ou le polyéthylène poreux
(Medpor®)aconsidérablement amélioré le
problème cosmétique de la cavité orbitaire
anophtalme et la motilité de la prothèse.
Malgré ces traitements locaux, certains
patients vont présenter une récidive sys-
témique. Celle-ci survient principalement
au niveau hépatique et dans les 3 premières
années. Certains facteurs prédisposant ont
été identifiés tels que la taille de la tumeur,
l’extension au corps ciliaire, l’invasion
sclérale ou extrasclérale, la présence de
cellules épithéloïdes, l’expression de c-myc
ou la monosomie 3. La survie médiane des
patients métastatiques varie de 2 à 6 mois.
Seuls les patients avec une récidive
uniquement extra-hépatique ont une survie
plus longue (19mois). L’élévation sérique
des LDH et des phosphatases alcalines sont
des facteurs de mauvais pronostic.
Différentes approches thérapeutiques
systémiques ont été proposées: chimio-
thérapie, radiothérapie, immunothérapie.
Toutes sont équivalentes en terme d’in-
efficacité: taux de réponse de 10% et un
gain de 1 à 2 mois de survie. Des traite-
ments loco-régionaux ont été développés et
sont basés sur la prédilection du mélanome
oculaire à récidiver au niveau hépatique.
La survie des patients présentant une
récidiveuniquement hépatique peut être
augmentée si une chirurgie hépatique
l’irradiation quelque soit la configuration de
la surface basale tumorale et son épaisseur.
De plus, la plaque de support (applicateur)
pour une irradiation par grains d’iode 125
peut être créée de façon à pouvoir s’appli-
quer anatomiquement le mieux à la tumeur
àirradier (par exemple avec encoche pour
le traitement des tumeurs juxta-papillaires)
(Figure 3A).La plaque est fixée en position
épisclérale pour une durée de 3 à 6 jours
pour délivrer une dose approximative de
90 Gy à l’apex tumoral (Figure 3B).Le
placement et le retrait de la plaque peuvent
se faire sous anesthésie locale rétro-
bulbaire. Dans notre expérience, le contrôle
tumoral (supérieur à 96%) après radio-
thérapie par plaque dépend principalement
de la tailleinitialedu mélanome ainsi que
de sa localisation. Les risques de morbidité
visuelle importante sont liés principale-
ment au développement d’une rétinopathie
radique dont l’incidenceestde 42% à 5 ans
[Kaplan-Meier].
Les complications radiothérapiques au
niveau du segment antérieur (sécheresse
oculaire, cataracte, glaucome néovascu-
laire) après irradiation par plaque d’iode
125 sont moins élevées qu’après radiothé-
rapie externe par particules accélérées.
Une approche combinée radiothérapie et
photocoagulation au laser ou thermo-
thérapie transpupillaire est utilisée depuis
peu pour accélérer la fonte tumorale et
diminuer les risques de récidivetumorale
intraoculaire. Quelque soit la forme de
radiothérapie utilisée une moyenne de 5 à
10% des patients traités subiront une
énucléation secondairesuite aux com-
plications radiothérapiques (décollement
exsudatif total, hémorragie vitréenne,
glaucome néovasculaire) ou au développe-
ment d’une récidive tumorale.
Enrègle générale, la résection tumorale
est réservée aux tumeurs localisées
antérieurement au niveau du corps ciliaire
et de la choroïde pour lesquelles les risques
d’intégrité du globe et de morbidité visuelle
seraient plus élevés si une radiothérapie
était envisagée.
Approches Thérapeutiques Actuelles
du Mélanome de l’Uvée
5
Figure 3A
Plaque avec grains iode 125 radioactifs
collés sur le support en or de 12mm de
diamètre (A), avec encoche de façon à être
appliquée contre le nerf optique et suturée
àla surface oculaire durant la chirurgie
d’application (B).
Figure 3B
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%