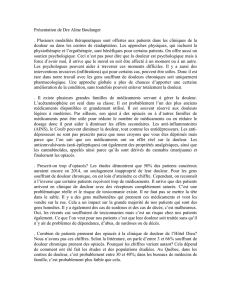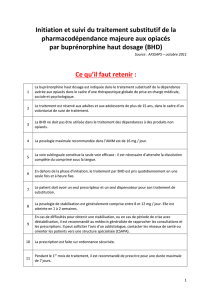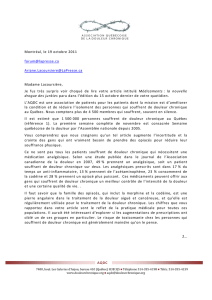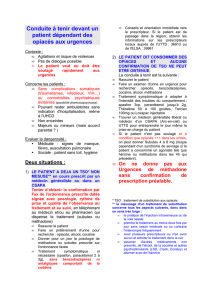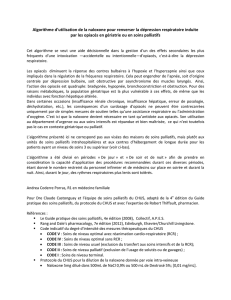c o F

Le Courrier des addictions (12) – n ° 1 – janvier-février-mars 2010 22
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
Toujours des questions
en suspens
La politique de substitution qui existe depuis
maintenant quinze ans en France est un suc-
cès incontestable, comme le décrivait déjà la
conférence de consensus en juin 2004. Fin
2009, il y a environ 120 000 personnes traitées
en même temps (100 000 sous buprénorphine
haut dosage [BHD] et 30 000 sous chlorhy-
drate de méthadone [MET]) sur 150 000 à
200 000 usagers de drogues potentiels. Cela
correspond à deux tiers des patients traités.
Une inégalité d’accès aux traitements persiste
malgré tout, sans réelle justification. Pourquoi
des traitements pour 14 jours et d’autres pour
28 jours ? Pourquoi des primo-prescriptions
dans certains cas et pas dans d’autres ? Quel
est réellement l’avantage de la forme gélule de
la MET, que nous attendions depuis si long-
temps, alors que les hauts dosages n’existent
pas et que les paperasses qui entourent le pas-
sage en ville sont lourds et dissuasifs ? Pour-
quoi faut-il attendre un an avant de passer à la
forme gélule et non trois mois ou dix-huit ? On
peut également s’interroger sur la faible péné-
* Psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier, docteur
ès sciences de l’éducation CSST SATIS, pôle de psychiatrie
CHU Gabriel-Montpied, 63003 Clermont-Ferrand Cedex
01.
Actualités de la substitution :
nouveaux enjeux
Current events of substitution: new stakes
P. Courty*
tration des génériques de la BHD après 3ans
de commercialisation. En effet, la molécule
originale représente encore 70 % du marché,
ce qui prouve bien que la dépendance majeure
aux opiacés est une maladie chronique et que
les patients ne souhaitent pas être déstabilisés
dans l’équilibre qu’ils ont réussi à atteindre
avec un produit qui leur a apporté une amélio-
ration de leur qualité de vie. On continue donc
en France de travailler sur des représentations
plus que sur des faits et de l’évaluation. Ce n’est
pas un hasard (sic!) si les campagnes de pré-
vention télévisées sont davantage vécues par
nos patients comme de la publicité. Les der-
niers spots en date, admirablement réalisés
façon séries TV, "supportent" un slogan qui
énonce "La drogue, ça n’est pas par hasard si
c’est illégal". On voit bien, là encore, la difficul-
té des pouvoirs publics à faire la différence au
niveau des substances psychoactives entre ce
qui ressort du soin ou de la loi. Cette confusion
nous paraît encore plus préjudiciable à l’heure
actuelle, car elle est inefficace. En effet, les re-
présentations valent dans les deux sens. Ainsi
une enquête de l’institut BVA pour la MILDT
en 2009 a-t-elle montré que 32 % des sondés
pensent qu’il n’est pas interdit de consommer
de l’héroïne ou de la cocaïne à son domicile,
et 50 % pour le cannabis. On voit bien qu’il y
a confusion entre cause et conséquences et
l’on aimerait voir des spots qui montrent au
contraire des gens qui s’en sortent et qui sont
capables de dire combien ils étaient mal avant
le traitement et comment ils s’en sont sortis.
le Soin : de vrais progrès
Pourtant, sur l’autre rive, celle du soin, de réels
progrès ont été réalisés grâce en particulier à
la politique de réduction des risques. En ce qui
concerne les contaminations par le VIH, les
UD ne représentent plus que 2 % des conta-
minations pour l’année 2008. Le nombre de
diagnostics diminue depuis 2003. 77 % sont de
nationalité française, 10 % d’un pays d’Europe
de l’Est et 6 % d’Afrique du Nord. Les patients
ont en moyenne 39 ans et sont souvent dia-
gnostiqués trop tardivement : 28 % au stade
sida. Les contaminations par le VHC sont
en baisse en particulier chez les plus jeunes.
Selon le Bulletin Épidémiologique Hebdoma-
daire n° 37 du 6 octobre 2009, une enquête a
évalué, pendant deux ans sur 526 UD et 111
patients non à risque, l’impact sanitaire du
dispositif des microstructures médicales sur le
dépistage, le suivi et le traitement des patients
présentant une addiction, en partenariat avec
le pôle de référence "hépatites virales" des hô-
pitaux universitaires de Strasbourg et le réseau
des microstructures médicales "RMS Alsace".
De même, "un dépistage du VHC, réalisé chez
80 % des UD, a montré que 39 % d’entre eux
étaient séropositifs versus 4,5 % chez les pa-
tients non à risque (p < 0,001). Le taux de sé-
ropositivité des UD variait avec l’âge: 7 % des
moins de 30 ans versus 80 % des plus de 45ans
étaient infectés. Par ailleurs, la pratique de l’in-
jection était majoritaire chez les plus âgés. Les
moins de 30 ans semblaient l’abandonner au
profit du sniff. Dans 88 % des cas, la sérologie a
été complétée par le dosage de l’ARN du VHC.
La prise en charge thérapeutique a pu être ef-
fectuée chez 43 patients, soit 40 % des patients
ARN-VHC positif.
Ces résultats, plus favorables que ceux rap-
portés dans la littérature, montrent que le
dispositif en réseau des microstructures mé-
dicales a un impact sanitaire favorable dans le
dépistage, le suivi et le traitement de l’hépatite
C chez les patients qui y sont pris en charge.
Les problèmes posés par le VHC à l’heure ac-
tuelle, c’est d’avoir des traitements efficaces
mais pas assez souvent employés, car la ma-
ladie est d’évolution lente. Les traitements
sont mal perçus, à la fois par les patients et les
soignants. Il est encore difficile et compliqué
Les traitements de substitution aux opiacés ont entraîné en quinze ans une réelle évo-
lution dans la prise en charge des patients dépendants, transformant une maladie de
caractère aigu avec des infections et une psychopathologie destructrice en une prise en
charge de longue durée. La diminution des infections grâce à l’implication des usagers
a modifié également le pronostic. Nous nous attacherons à évoquer les dimensions qui
posent encore des problèmes aux soignants tels que le mésusage et le traitement de la
douleur en proposant des solutions pratiques fondées sur l’expérience et la littérature.
Substitution treatments have been such an évolution for the last fifteen years that they’ve changed
an acute disease with infections and heavy psychopathology into a chronical disease with long term
care. The decrease of blood borne infections due to the harm réduction policy involving drug users
has modified fatal issues. We will focus on problems still occuring (misuse and relieving pain) by
proposing good practices based on expérience and littérature.
Mots-clés :
Substitution, Mésusage,
Douleur, Éducation thérapeutique.
Keywords :
Substitution treatment,
Misuse, Pain, Therapeutic education.

Le Courrier des addictions (12) – n ° 1 – janvier-février-mars 2010
23
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
de traiter des gens qui n’ont aucun symptôme.
Pourtant, c’est un enjeu majeur de les traiter ra-
pidement, car l’apparition des signes cliniques
marque souvent la gravité de la dégradation hé-
patique. Le travail en équipe entre les médecins
généralistes, les hépatologues et les psychiatres
(les addictologues au sens large) est un pré-
alable mais n’est pas toujours suffisant. Nous
l’avons expérimenté à Clermont-Ferrand alors
que les équipes travaillent ensemble depuis des
années. Il faut être délibérément volontariste et
que les idées reçues ne soient pas préjudiciables
aux patients. Évaluer les points positifs et néga-
tifs ne doit pas s’envisager qu’au temps T mais
au temps T + 10 ou 20 ans. Ces deux exemples
de la diminution des contaminations ne doi-
vent pas faire oublier l’impression générale de
rajeunissement des populations reçues. Est-ce
parce que les soignants vieillissent et se lassent
? Sûrement en partie, mais il faut bien constater
qu’avec une adolescence de plus en plus pré-
coce apparaissent également plus précocement
les consommations. On constate alors le dé-
nuement de pédopsychiatres dans nos contrées
et chacun est renvoyé à son réseau et à un bri-
colage qui permet une approche plus ou moins
adaptée. Or, il est important de ne pas perdre
de vue ces adolescents et de tisser des liens qui,
certes ténus au départ, peuvent devenir au fil
du temps plus solides. La prise de substances
psychoactives va entraîner des dommages sur
un cerveau en formation, puisqu’on est censé
"maturer" jusqu’à 25 ans (Natalie Levisalles :
L’Ado (et le bonobo). Essai sur un âge impos-
sible – Hachette Littérature, 2009). Nous de-
vons considérer deux axes pour prendre en
charge ces patients de plus en plus jeunes : l’un
va être celui de la prise de produits et des rap-
ports entretenus avec ce produit. Le deuxième
axe est celui de la maturation psychique qui est
influencée par cette prise de produits mais pas
seulement, et c’est là que notre rôle de théra-
peute redevient central, car il montre que si le
traitement est nécessaire il n’est pas tout. Deux
exemples nous paraissent significatifs : le can-
nabis et ses rapports avec la dépression (phase
de sommeil paradoxal absente car décalage de
phase de l’adolescence renforcé par le cannabis)
et l’utilisation chronique d’opiacés modifient
durablement et quelquefois probablement défi-
nitivement la neurotransmission (exemple de la
douleur et de l’hyperalgésie sur lesquelles nous
allons revenir un peu plus loin). D’autres sujets
posent problème, ceux que nous appelons les
"sujets qui fâchent" tels que le mésusage des
traitements de substitution aux opiacés (TSO).
le mésusage :
de quoi parle-t-on ?
S’agit-il de s’injecter, sniffer, fragmenter ? Ou les
trois ? Quelles questions poser ? Il faudrait oser
les questions suivantes : "Quelle est la fréquence
de vos injections ?" au lieu de "Vous injectez-
vous ?" ou encore "Qu’en attendez-vous?" En
clair, "Vous injectez-vous pour vous sentir bien,
pour éviter le manque ou pour arrêter l’héroïne
?" Car la prise en charge nous paraît différente
et à adapter selon que l’on est encore à cheval
sur la consommation ou que l'on a commencé à
faire le deuil d’une certaine relation au produit.
Là se joue également l’importance de la dose.
Beaucoup de patients et de médecins pensent
que baisser la dose est un signe que tout va
bien. Ce peut être le cas, mais bien souvent,
les baisses de doses interviennent chez des pa-
tients non encore suffisamment équilibrés et
elles ont tendance à précipiter les rechutes.
Dans une enquête réalisée en 2007 sur 298
patients prenant de la BHD prescrite ou non,
70 % d’entre eux déclarent que la dose n’est pas
suffisante pour eux. Nous insistons également
sur les différents articles qui ont montré que
le mésusage des patients était en miroir de la
formation des praticiens. Plus les praticiens
sont formés, mieux ils prescrivent, en particu-
lier les bonnes doses, et évitent ainsi le noma-
disme médical.
De même pour l’injection, nous avons montré
en 1999 que la fréquence des injections est
moindre chez les sujets pris en charge médi-
calement. Le mésusage n’est pas dû à la seule
responsabilité du patient. Il faut se poser les
questions suivantes : les soignants reçoivent-
ils la formation adéquate ? Sont-ils capables
de transmettre l’information à leurs patients?
D’admettre pour eux-mêmes et leurs patients
que la dépendance majeure aux opiacés est une
maladie chronique qui réclame une confiance
mutuelle ? Cela débouche sur la mutualisation
des savoirs et des expertises entre patients et
soignants : c'est ce que l’on appelle à l’heure
actuelle l'éducation thérapeutique.
La douleur comme exemple
"La plus grande des douleurs est celle qu’on
ne peut partager." Il semble y avoir autour de
l’appréhension du phénomène douloureux les
mêmes réticences que pour la substitution
aux opiacés. Nous avons déjà traité dans cette
même revue de ces problèmes. Nous allons
maintenant nous attacher à des aspects plus
pratiques. Notons qu’il faut attendre 1998
pour voir une première campagne de lutte
contre la douleur, avec un slogan qui n’a rien
à envier à ceux que nous connaissons dans le
domaine de la toxicomanie : "La douleur n’est
pas une fatalité", et la loi de mars 2002 pour
que le soulagement de la douleur soit reconnu
comme un droit fondamental du malade. Les
liens qui unissent les phénomènes douloureux
et l’addiction aux opiacés sont complexes et
"bi-directionnels". Ils peuvent être vus comme
la résultante d’un sous-traitement de la dou-
leur, d’une augmentation de la disponibilité
des opiacés ou de leur prescription. D’où la
nécessité de compétences croisées dans le
domaine du traitement de la douleur et de la
dépendance aux opiacés. C’est bien pour cela
que les addictologues sont les spécialistes que
l’on sollicite le plus pour prendre en charge les
patients douloureux. Il faut souvent prendre
en compte que les douleurs sont sous-évaluées
(ou mal évaluées) ; que les traitements inappro-
priés ont des effets secondaires rédhibitoires;
que les "petites" et les "fortes" doses sont tout
aussi néfastes ; que chacun a "ses" propres re-
cettes de cuisine, mais que peu de références
Evidence Based (prouvées scientifiquement)
existent. Il faut aussi tenir compte du fait que
les opiacés sont un "Janus thérapeutique" qui
peut faire passer de l’apaisement de la douleur
à l’addiction (tout d’abord, soulage la douleur
puis soulage la douleur et la souffrance, puis
soulage la souffrance et la détresse, puis vous
font sentir mieux, puis vous font sentir bien,
puis vous font sentir "vraiment" bien !).
Rappelons aussi les différences entre douleur
aiguë et douleur chronique. La douleur aiguë
est rattachée à un événement (une chute par
exemple), son soulagement est espéré dans
un délai rapide (jours ou semaines) tandis la
douleur chronique n’a pas toujours de cause
identifiée. Elle entraîne des modifications du
système nerveux central (SNC) et il ne s’agit
pas d’épisodes de douleur aiguë à répétition.
En résumé, la douleur aiguë est une sensation
et permet de répondre à la question "De quoi
souffre le patient ?" C’est un indicateur de sur-
vie immédiate tandis que la douleur chronique
ne sert à rien, elle est devenue une façon de
vivre. "Quel type de patient a cette douleur?"
Les douloureux chroniques souffrent pour
rien ! Quand la douleur devient chronique, les
traitements ne sont plus efficaces. Le patient
perd confiance dans son médecin. Le patient

Le Courrier des addictions (12) – n ° 1 – janvier-février-mars 2010 24
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
F
o
c
u
s
est accusé de ne pas aller mieux. Il devient
"dépendant" des autres pour des actes habi-
tuellement faciles à réaliser. Il se sent délaissé
quand les autres ne peuvent pas tout faire à
sa place. Il devient anxieux, colérique et dé-
primé. En un mot, il endosse les habits d’un
douloureux chronique. On retrouve dans ces
caractéristiques des critères de nos patients
dépendants des opiacés. Comment traiter
ces douloureux ? Nous rappellerons les ob-
jectifs: sélectionner les bons produits, doses,
voies d’administration, intervalles entre les
prises et durées du traitement ; effectuer
une titration pour obtenir l’effet maximal ;
prévenir les moments de réapparition de la
douleur ; utiliser des co-analgésiques non
opiacés ; minimiser et traiter les effets secon-
daires. Il ne faut pas avoir peur de "faire mal
à la douleur" (Pain on Pain) et la traiter avec
des opiacés (le traitement idéal ayant un effet
rapide, durée courte, sûr, convient au patient,
effets secondaires acceptables). Face à une
douleur chronique, toujours se demander :
pourquoi a-t-on prescrit des opiacés ? Qu’est-
ce que l’on attend en termes de réduction de
la douleur, d’amélioration fonctionnelle ? Les
effets secondaires et paradoxaux sont-ils "do-
cumentés" ?
Et comme le dit Walter Ling, "se rappeler à
cette occasion que ce qui n’est pas écrit n’ar-
rive jamais et qu’une réputation se fait sur le
médecin que l’on est et pas sur les patients que
l’on a". La douleur aiguë est une menace pour
l’équilibre, souvent précaire du patient dépen-
dant substitué. Elle est amplifiée par les idées
reçues sur la douleur.
Idées reçues sur les patients
dépendants des opiacés
En bref : ces patients ne connaissent pas la
douleur. Ils n’ont pas besoin d’opiacés car
ils reçoivent déjà des doses importantes de
morphiniques. Les traitements antidouleurs
ne fonctionnent pas chez les patients subs-
titués. On ne peut pas prescrire légalement
davantage de traitements. Les traitements de
la douleur entraînent immanquablement des
rechutes. Tout cela est complètement faux,
bien au contraire. Les patients sous TSO font
l’expérience de la douleur. Ils connaissent à
la fois la tolérance aux opiacés et l’hyperalgé-
sie, comme le prouvent des scores plus élevés
concernant la douleur. Leur douleur répond
aux traitements opiacés. Ils ont besoin d’opia-
cés de base (dette en opiacés). Ils nécessitent
de plus fortes doses, une fréquence et une
durée d’administration plus élevée. Premiè-
rement, il faut chercher une cause curable à
la douleur et l’éradiquer. Deuxièmement, en
cas de douleur mesurée grâce à une échelle vi-
suelle analogique (EVA) entre 4 et 7, associer
des antalgiques de niveau I (paracétamol, as-
pirine, AINS) – sauf contre-indication – à un
antalgique de niveau II (néfopam) [EVA 7].
En pratique, pour les patients sous MET:
continuer la MET en répartissant la dose sur
la journée en 3 à 4 prises ; utiliser d’autres
opiacés pour la douleur plutôt que d’ajouter
une dose supplémentaire de MET; se sou-
venir que ces patients ont une hyperalgésie
et ont besoin de doses plus fortes d’opiacés
(4). Utiliser la rotation des opiacés ; adjoindre
d'autres antalgiques; utiliser des moyens non
pharmacologiques ; travailler en équipe et
poursuivre le traitement de l’addiction.
En pratique, pour les patients sous BHD:
continuer la BHD en la fractionnant toutes
les 6 à 8 heures ; ajouter de la BHD ou un
opiacé d’action rapide et forte pour traiter la
douleur aiguë ; changer pour un autre ago-
niste opiacé y compris la MET pendant la
douleur aiguë; revenir à la BHD une fois que
la douleur aiguë est traitée ; ne pas oublier
les autres antalgiques et les traitements non
médicaux ; travailler en équipe et poursuivre
le traitement de l’addiction. En clair et en
résumé, la BHD est un excellent produit qui
a deux types d’action suivant son dosage et
surtout sa fréquence d’administration. En
prise unique et à dose suffisante, c’est un
produit de substitution sûr avec un effet pla-
fond et une longue durée d’action. En prises
fractionnées et doses adaptées, c’est un an-
talgique efficace. Reste que le profil de nos
patients est très particulier (hyperalgésie),
et il est indispensable de garder à l’esprit
que chaque cas est différent et que chaque
prescription se négocie et s’adapte. Par
conséquent, il n’y a pas et il n’y aura jamais
de recette universelle: "Most things work for
something ; nothing works for everything ; a lot
doesn’t work for anything", comme se plait à
le répéter Walter Ling. Il faut fractionner les
doses (passer de la substitution à l’antalgie),
les augmenter et aborder le problème dans
une approche multidisciplinaire.
L’enjeu essentiel
de l’Éducation
Thérapeutique du Patient
Les patients sous MET et sous BHD n’ont
pas les mêmes réactions (Authier, Courty : en
cours). Le traitement de leur douleurs et de
leur anesthésie est donc différent. Quoiqu’il
en soit, il est impératif que ces patients soient
associés à l’élaboration des protocoles, qui
doivent être souples et adaptés. Le rôle de
l’éducation thérapeutique du patient est
primordial. L’adaptation permanente du
soignant à la demande du soigné, dans un
partenariat vraiment interactif autour des
compétences des deux côtés, ne peut se faire
que dans un réel effort de formation des thé-
rapeutes, non seulement à des connaissance
nouvelles, mais aussi à un autre rapport à la
souffrance de l’autre. On le sait bien : les plus
grandes réticences et idées reçues viennent
des prescripteurs. Cela nécessite d’accep-
ter que les patients aient besoin d’un traite-
ment de longue durée. Cela ne semble facile,
ni pour les usagers, ni pour les soignants. Il
faut admettre aussi que nous sommes dans
le registre du soin et non plus dans celui de
l’illégalité ou du traitement de confort d’une
conduite à risque. Il convient là aussi d’être
"les accoucheurs" attentifs de ce travail en
orientant, accompagnant et non pas en impo-
sant ou ordonnant. L’échange, l’acceptation
des différences et des attentes doivent être la
préoccupation des soignants devenant ainsi
des éducateurs thérapeutiques. Car, même si
les patients ont des compétences, le médecin
reste bien le pivot de l’accès aux soins dans
notre système de santé. Néanmoins, il semble
qu’ils soient les plus difficiles à "éduquer" ! Ce
modèle éminemment éducatif, s’il peut s’ap-
pliquer aux usagers de drogues, doit pouvoir
s’adapter sans mal à toutes les autres mala-
dies chroniques. C’est tout l’enjeu de l’avenir
des interrelations patient/éducateur pour la
santé et d’un changement radical de notre ap-
proche du soin.
v
Références bibliographiques
1. Conférence de consensus sur les traitements de
substitution aux opiacés, Lyon, 2004 (http://www.
has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
TSO_court.pdf)
2. http://crips.cirm-crips.org/crips/dossiers/chiffre2008.
pdf VIH/SIDA 2008 Les chiffres clés de l’épidémie
3. http://www.invs.sante.fr/beh/2009/37//index.htm
4. Randl K, Courty P, Dubost S et al. Une prise en
charge multidisciplinaire est-elle suffisante pour inci-
ter les usagers de drogue sous traitement de substitu-
tion aux opiacés à traiter leur hépatite chronique C ?
Gastroenterol Clin Biol 2009;33:86.
5. Courty P. Use and abuse of high dosing buprenor-
phine (HDB) obtained without prescription: a French
survey. Heroin Addict Relat Clin Probl 2009;11(1):
23-30.
6. Courty P. Buprénorphine haut dosage (Subutex®)
et pratique d’injection : à propos d’une enquête au-
près de 303 personnes. Annales de Médecine Interne
– Supplément Médecine des Addictions 2003;154, HS
I:IS46-IS50.
7. Authier N, Courty P. Douleur et addictions aux
opiacés. Le Courrier des addictions 2007;2(9):49-52.
8. Authier N, Llorca PM, Courty P. Soulager la dou-
leur chez les patients dépendants aux opiacés. Le
Courrier des addictions 2008;4(10):11-3.
1
/
3
100%