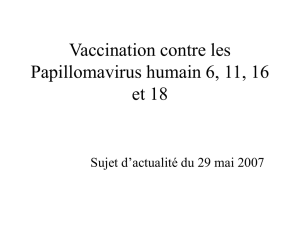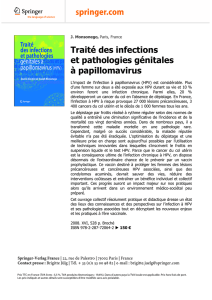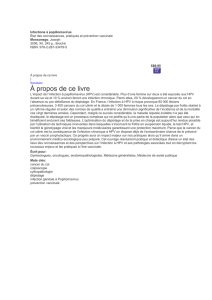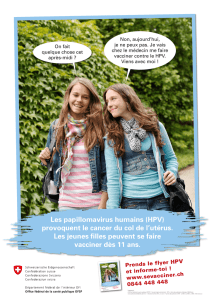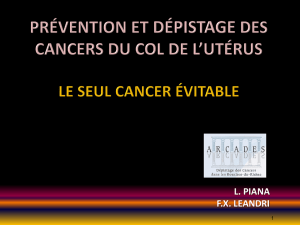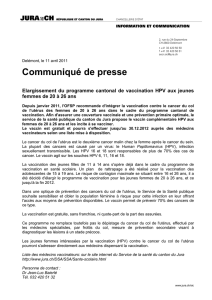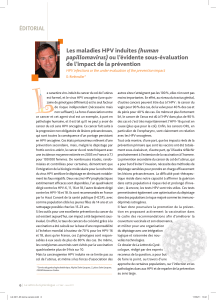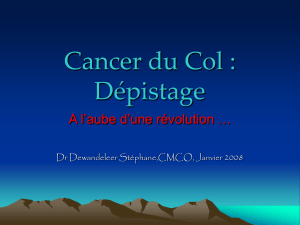31 édition de l’International Papillomavirus Conference, HPV 2017

28 | La Lettre du Gynécologue • N° 408 - mai-juin 2017
CONGRÈS
RÉUNION
31e édition de l’International
Papillomavirus Conference,
HPV 2017
27 février-4 mars 2017, Le Cap (Afrique du Sud)
D. Riethmuller1, J. Levêque2, O. Jourdain3, M.P. Bersani4, H. Borne5,
N. Castaing6, M.A. Dommergues7, M. Fender8, A. Touzé9, M. Veluire10, P. Descamps11
1
Service de gynécologie-obstétrique,
CHRU de Besançon.
2
Service de gynécologie-obstétrique,
oncologie chirurgicale, DOGMR
hôpital Anne-de-Bretagne, Rennes.
3 Service de gynécologie-obstétrique,
polyclinique Jean-Villar, GynFeminae,
Bruges (Bordeaux).
4
Cabinet de gynécologie-obstétrique,
Pau.
5 Cabinet de gynécologie médicale,
Paris.
6
Service de gynécologie-obstétrique,
centre hospitalier des Quatre-Villes,
Saint-Cloud.
7 Service de pédiatrie, CH de
Versailles-Le Chesnay.
8 Association EVE, Illkirch-Graffens-
taden.
9
Virologie, université François-Rabe-
lais, Tours.
10 Service de gynécologie-obstétrique,
sexologie, clinique Caron, Athis-Mons.
11
Service de gynécologie-obstétrique,
CHU d’Angers.
HPV : un “fardeau” mondial
Le papillomavirus humain (HPV) est à l’origine d’une
importante morbidité dans le monde. S. Franceschi
et al. (1) ont estimé qu’il serait responsable de 8,6 %
de tous les cancers féminins au niveau mondial,
ce chiffre pouvant atteindre 26 % en Afrique subsaha-
rienne. Cette forte disparité provient, entre autres,
de facteurs propres aux régions à faibles ressources :
➤
forte prévalence du HPV et du VIH, entraînant une
susceptibilité accrue au développement de cancers
liés au HPV ;
➤
multiparité et accès limité au dépistage du cancer
du col.
Au total, au niveau mondial, 630 000 nouveaux cas
de cancer seraient attribuables au HPV tous les ans,
dont 73 % seraient liés aux HPV 16 et 18. Le cancer
du col de l’utérus représenterait à lui seul 83 % de
l’ensemble des cancers HPV induits, suivi des cancers
ORL (~ 38 000 cas).
L’Europe est, parmi les régions développées, la zone
géographique dans laquelle la proportion de cancers
dus aux HPV est la plus élevée (4,4 %). S. Hartwig
et al. (2) ont estimé à environ 56 500 le nombre
annuel de nouveaux cas de cancer dus aux HPV en
Europe, la majorité d’entre eux étant attribuables
aux génotypes 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (~ 50 000).
La 31
e
édition de l’International Papillomavirus
Conference (HPV 2017) s’est tenue du 28 février
au 5 mars au Cap, en Afrique du Sud, réunissant
chercheurs et cliniciens de tous horizons. Le compte-
rendu qui suit n’a pas vocation à l’exhaustivité. Il
propose simplement une mise en exergue des faits
marquants relevés par les auteurs.
Les cancers les plus fréquents sont ceux du col de
l’utérus (35 000 cas), suivis des cancers ORL (plus de
10 200 cas) et de ceux de l’anus (plus de 6 500 cas).
Les cancers masculins constituent une part substan-
tielle du fardeau (12 000 nouveaux cas annuels chez
l’homme, soit un peu plus de 21 % du nombre total
de cancers dus au HPV), et cette part semble en
augmentation selon une étude menée aux Pays-Bas
par S. McDonald et al. (3) [9,9 % en 1989 et 26 %
en 2014].
De plus en plus d’études
montrent le bénéfice
en “vie réelle” de la vaccination
prophylactique
Près de 10 ans après l’introduction de la vaccination
HPV, de nombreuses études ont montré l’efficacité
en “vie réelle” des vaccins préventifs anti-HPV.
Les pays ayant obtenu de fortes couvertures
vaccinales bénéficient déjà de réductions impor-
tantes en termes de morbidité au niveau popula-
tionnel (4, 5). Dans leur revue systématique de la
littérature, S. Garland et al. (4) ont observé une
réduction drastique de la prévalence des infections
par HPV 6, 11, 16 et 18 et des verrues génitales
(allant jusqu’à ~ 90 %), ainsi qu’une diminution
importante des anomalies cervicales (jusqu’à 47 %
des lésions dysplasiques de bas grade et 84 %
des lésions dysplasiques de haut grade) chez les
jeunes femmes d’Australie, d’Europe, d’Amérique
du Nord et de Nouvelle-Zélande, après l’introduc-
tion de vastes programmes de vaccination utilisant
le vaccin quadrivalent. Sur la base d’une méta-
analyse portant sur 48 études menées dans 11 pays,
M. Drolet et al. (5) montrent que l’impact observé

La Lettre du Gynécologue • N° 408 - mai-juin 2017 | 29
CONGRÈS
RÉUNION
en population sur les verrues génitales et les lésions
cervicales de haut grade est d’autant plus important
que l’âge de la vaccination est précoce et que la
couverture vaccinale est élevée. Cette méta-analyse
confirme par ailleurs l’existence d’une protection
de groupe en cas de forte couverture vaccinale des
jeunes filles. Parmi les possibles risques discutés
lors de la mise à disposition des vaccins prophy-
lactiques, le potentiel retentissement écologique de
la vaccination HPV (remplacement des génotypes
oncogènes vaccinaux par des génotypes oncogènes
non vaccinaux) avait été évoqué. Cette question
a été explorée dans une étude menée par J. Kahn
et al. (6), entre 2007 et 2014, chez des jeunes
femmes américaines, âgées de 13 à 26 ans. Cette
étude n’a pas retrouvé d’augmentation significa-
tive des génotypes non vaccinaux chez les femmes
vaccinées, mais au contraire une diminution de
36,1 % des génotypes non vaccinaux apparentés
au HPV 16 (HPV 31, 33, 35, 52, 58 et 67), mettant
ainsi en lumière l’existence d’une vraisemblable
protection croisée.
Enfin, pour la première fois, à la suite de l’intro-
duction du vaste programme de vaccination austra-
lien (vaccin quadrivalent), J. Brotherton et al. (7) ont
décrit une diminution de l’incidence des papilloma-
toses laryngées juvéniles récurrentes (PLJR) chez les
enfants. Le taux de nouveaux cas de PLJR est passé
de 0,3 pour 100 000 en 2012 à 0,04 pour 100 000
en 2016. Aucune des mères des 15 nouveaux cas
observés n’avait été vaccinée avant la grossesse.
Cette maladie rare est liée aux HPV 6 et 11, et
l’hypo thèse étiologique d’une transmission verti-
cale pendant la grossesse est généralement admise.
Bien que non maligne, elle met en jeu le pronostic
fonctionnel vocal et le pronostic vital respiratoire.
Son évolutivité est imprévisible et sa prise en charge,
particulièrement lourde, nécessite des exérèses
chirurgicales répétées sous anesthésie générale. Ces
résultats suggèrent que la vaccination quadrivalente
des futures mères pourrait prévenir la survenue de
PLJR chez leurs enfants. De nouvelles études sont
nécessaires pour confirmer cette observation.
Évolution de la prévention
secondaire du cancer
du col de l’utérus
Éducation, vaccination et dépistage restent les
outils complémentaires de prévention du cancer
du col de l’utérus, et l’évolution des modalités du
dépistage a fait l’objet de très nombreuses commu-
nications. Cette question demeure centrale, et les
études présentées par différents pays restent
sujettes à débat. La comparaison cytologie versus
test HPV en test primaire a été, dans la plupart
des études, en faveur d’un passage au test HPV.
D’après un modèle australien développé par M. Hall
et al. (8), ce passage pourrait s’accompagner d’une
élévation transitoire de l’incidence des lésions de
haut grade et des cancers cervicaux (+ 32 % et
+ 15 %, respectivement), essentiellement liée au
gain de sensibilité de la méthode de dépistage.
En revanche, selon ce modèle, des réductions
de 39 et 51 % respectivement seraient atten-
dues à plus long terme et la mortalité par cancer
du col pourrait diminuer de 45 % d’ici 2035. Le
concept HPV-FASTER (9) a lui aussi été largement
présenté et discuté. Il vise à “accélérer” la réduc-
tion de l’incidence des cancers du col de l’utérus
en utilisant une approche combinée associant
vaccination des femmes adultes (de 25 à 45 ans)
et dépistage par un test HPV à partir de 30 ans.
Les femmes adultes ayant eu un test HPV négatif
bénéficieraient, après vaccination, d’une protec-
tion optimale, comme cela a été démontré dans
les populations perprotocole des essais cliniques
de vaccins. Elles auraient ensuite un risque très
faible de développer ultérieurement un cancer du
col, et leur suivi ne comprendrait qu’un nombre
limité de tests HPV. Les femmes ayant un test HPV
positif bénéficieraient, elles, d’un triage spécifique
et de procédures diagnostiques et thérapeutiques
adaptées. L’acceptabilité de cette approche inté-
grée est en cours d’étude.
HPV et pathologies ORL
Certains cancers ORL, notamment ceux de l’oro-
pharynx, sont clairement liés au HPV, particuliè-
rement à HPV 16. Il s’agit avant tout de cancers
touchant une population masculine (environ
80 % des cas selon les données européennes de
S. Hartwig et al. [2]). Contrairement aux cancers
ORL “classiques” HPV négatif, liés à l’alcool et au
tabac, les cancers ORL HPV induits voient leur inci-
dence augmenter régulièrement depuis quelques
décennies. Alors qu’aucun précurseur histologique
de ces cancers n’a à ce jour été identifié, 2 études
récentes, menées par K. Lang Kuhs et al. (10) aux
États-Unis et par D. Holzinger et al. (11) en Alle-
magne, confirment que la détection sérologique
d’anticorps anti-E6 de HPV 16 pourrait avoir un
intérêt dans le diagnostic précoce des cancers de

CONGRÈS
RÉUNION
l’oropharynx et de leurs récidives, avec un haut
niveau de sensibilité et de spécificité. Aucun essai
clinique n’a actuellement évalué l’efficacité des
vaccins HPV en prévention des cancers ORL, et
des appels ont été faits dans ce sens à l’occa sion
du congrès. Néanmoins, de manière similaire à ce
qui est observé au niveau cervical, les anticorps
induits par le vaccin quadrivalent ont été retrouvés
dans la muqueuse buccale des femmes. l. Pinto
et al. (12) viennent de démontrer qu’ils étaient
également présents dans la muqueuse buccale des
hommes, ce qui pourrait suggérer l’existence d’une
protection vaccinale au niveau ORL.
Conclusion
Cette 31e édition de l’International Papillomavirus
Conference confirme que le contrôle des maladies
liées au HPV est plus que jamais fondé sur la
prévention, notamment sur la prévention primaire
que constitue la vaccination HPV. Des recherches
s’ouvrent aujourd’hui sur la possible mise au point
de nouveaux vaccins ciblant à la fois les protéines L1
et L2 de la capside du papillomavirus (13). L’avenir
immédiat repose, quant à lui, sur la vaccination
nonavalente qui aurait le potentiel d’éviter 90 %
des cancers liés aux HPV. ■
D. Riethmuller, J. Levêque,
M.P.Bersani, H. Borne, A.Touzé,
M. Veluire, O. Jourdain,
N.Castaing et P. Descamps
déclarent avoir des liens d’intérêts
avec MSD Vaccins (activité d’ex-
pertise et/ou orateurs). M. Fender
déclare avoir des liens d’intérêts
avec MSD Vaccins (soutien
institutionnel pour la réalisation
d’études). M.A. Dommergues
déclare avoir des liens d’intérêts
avec MSD et GSK (expertise et
orateur).
1. Franceschi S, de Martel C, Vignat J, Ferlay J, Bray F,
Plummer M. Burden of HPV-attributable cancer by site,
sex, country, and HPV type. HPV2017: abstr. 386.
2. Hartwig S, Alemany L, Lacau St Guily J, Domi-
niak-Felden G, De Sanjosé S. Overall burden of cancers
associated with the 9-valent human papillomavirus vaccine
types in women and men in Europe. HPV2017: abstr. 397.
3. McDonald S, Qendri V, Berkhof J, de Melker H, Bogaards J.
Disease burden of human papillomavirus infection in the
Netherlands, 1989-2014: the gap between females and
males is diminishing. HPV2017: Research Papers Session 0.
4. Garland S, Kjaer S, Munoz N et al. Impact and effective-
ness of the quadrivalent human papillomavirus (4vHPV)
vaccine: ten years of real-world experience. HPV2017:
abstr. 304.
5. Drolet M, Benard E, Brisson M. Population-level impact
and herd effects of HPV vaccination programs: updated
systematic review and meta-analysis. HPV2017: Research
Papers Session 05.
Références bibliographiques

La Lettre du Gynécologue • N° 408 - mai-juin 2017 | 37
CONGRÈS
RÉUNION
6. Kahn J, Saccucci M, Ding L, Franco E, Bernstein D,
Brown D. Non-vaccine-type HPV prevalence over the first
8 years after vaccine introduction: evidence for cross-pro-
tection but no evidence for type replacement. HPV2017:
Research Papers Session 05.
7. Brotherton J, Novakovic D, Cheng A et al. Australian
national surveillance of juvenile onset recurrent respira-
tory papillomatosis: declining incidence post quadrivalent
HPV vaccination. HPV2017: Research Papers Session 07.
8. Hall M, Simms K, Lew JB, Smith M, Saville M, Canfell K.
Combined impact of HPV vaccination and primary HPV
screening on cervical abnormalities and cancer: example
from Australia. HPV2017: Research Papers Session 05.
9. Félez-Sánchez M, de Sanjosé S, Faber MT et al. Multi-
national study assessing the acceptability and determinants
of compliance to hpv vaccination to women in screening
ages 25-45 years. HPV2017: abstr. 582.
10. Lang Kuhs K, Kreimer A, Trivedi S et al. HPV16 E6 antibodies are
highly sensitive for hpv-driven oropharyngeal cancer and are asso-
ciated with risk of recurrence. HPV2017: Research Papers Session 04.
11. Holzinger D, Wichmann G, Baboci L et al. Sensitivity of
antibodies against HPVE6 and other early proteins for the
detection of HPV16-driven head and neck cancer. HPV2017:
Research Papers Session 05.
12. Pinto L, Kemp T, Abrahamsen M et al. HPV-specific
antibodies at the oral cavity among mid-adult aged men
at 24 months post three doses of quadrivalent HPV vaccine.
HPV2017: abstr. 024.
13. Bywaters S, Brendle S, Biryukov J, Pino-Tossi K, Meyers
C, Christensen N. Sensitivity of antibodies against HPVE6
and other early proteins for the detection of HPV16-driven
head and neck cancer. HPV2017: abstr. 0121.
Références bibliographiques (suite de la p. 30)
1
/
4
100%