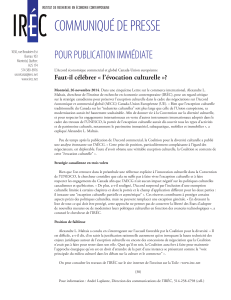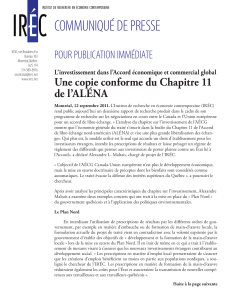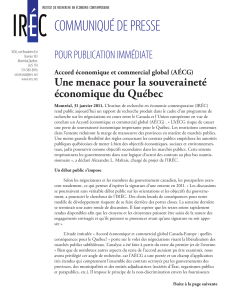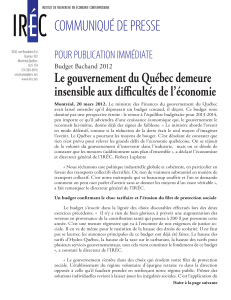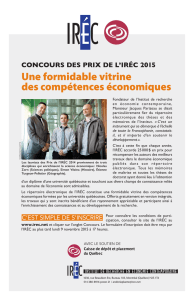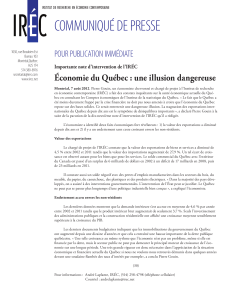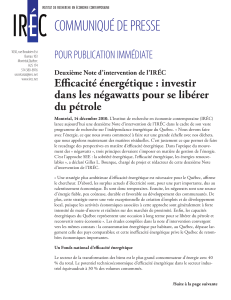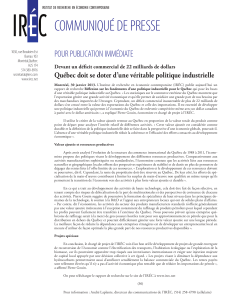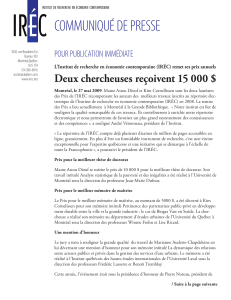BULLETIN DE L’ C’est le chapitre 11 de l’ALÉNA

BULLETIN DE L’
Mensuel publié par l’Institut de recherche en économie contemporaine/Septembre 2011
SOMMAIRE
À NOTER
❚
Institut de la statistique du
Québec (ISQ)
Première journée
d’étude sur la qualité
de l’emploi
L’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) tiendra une
première journée d’étude
sur le thème de la qualité de
l’emploi. Cette activité aura
lieu le mercredi 5 octobre
2011 de 9h à 17h15, à
l’Université de Sherbrooke,
au campus de Longueuil
(salle3660. L’adresse est le
150, place Charles-Lemoyne à
Longueuil.
❚
Forum international
de l’économie sociale et
solidaire (FIESS)
Pouvoirs publics et
société civile
Ce colloque se tiendra
à Montréal du 17 au 20
octobre 2011. Pour obtenir de
l’information ou s’inscrire,
voir www.chantier.qc.ca
2/Analyse du CASIQ
3/ Entrevue avec Alexandre L.
Maltais
4/ L’IRÉC en mouvement:
embauche, agrandissement
des locaux et nouveau système
téléphonique
Ce rapport de l’IRÉC propose une analyse de la
dernière version du brouillon d’accord daté
d’octobre 2010. Alexandre Maltais a fait porter son
analyse sur les règles d’investissements prévues
dans le projet de traité. Le constat est troublant. Le
chercheur de l’IRÉC a établi que l’objectif de l’AÉCG
Canada-Union européenne n’est pas tant le déve-
loppement économique que la mise en oeuvre de
préceptes dont les bienfaits sont considérés comme
automatiques. « Le traité, dit-il, évacue la défense
des intérêts supérieurs du Québec ». Après avoir ana-
lysé les principales caractéristiques du chapitre sur AÉCG/SUITE À LA PAGE 2
L’INVESTISSEMENT DANS L’AÉCG CANADA EUROPE
C’est le chapitre 11 de
l’ALÉNA
L’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) a produit un deuxième
rapport de recherche sur les négociations en cours entre le Canada et l’Union euro-
péenne pour un accord de libre-échange. Selon le chercheur Alexandre L. Maltais,
« l’économie générale du traité s’inscrit dans la foulée du chapitre 11 de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALÉNA). Le modèle utilisé interdit notamment les
prescriptions de résultats et laisse présager un régime de règlement des différends
qui permet aux investisseurs de porter plainte contre un État lié à l’Accord ».
l’investissement, le chercheur de l’IRÉC a examiné
deux exemples concrets qui ont trait à la mise en
place du « Plan Nord » du gouvernement québécois
et à l’application des politiques environnementales.
Le Plan Nord
En interdisant l’utilisation de prescriptions de
résultats par les différents ordres de gouvernement,
par exemple en matière d’embauche ou de formation
de main-d’oeuvre locale, la formulation actuelle du
projet de traité vient en contradiction avec la volonté
NOTE D’INTERVENTION DE L’IRÉC NUMÉRO 8
Objectif: 50000 logements d’ici dix ans
Après avoir analysé les tendances actuelles et à
venir du logement au Québec, Gilles. L. Bour-
que recommande la construction de 50000 loge-
ments d’ici dix ans. « Une vigoureuse politique de
construction de logements sociaux, dit-il, permettrait
de réduire les listes d’attente, de consolider un taux
d’inoccupation du logement locatif en équilibre et de
répondre aux besoins de logement des aînés ».
L’année 2011 marque le début d’une transition
démographique importante. Le chercheur de l’IRÉC
constate aussi une croissance phénoménale du
groupe des 75 ans et plus. Le logement social est
important, car il améliore non seulement la situation
financière des ménages, mais aussi la probabilité
NOTE D’INTERVENTION DE L’IRÉC NUMÉRO 9
Renouveler les politiques industrielles
La conjoncture économique montre l’urgence de
relancer les économies des pays industrialisés
en s’inspirant du renouvellement des politiques
industrielles des pays émergents et en adoptant une
stratégie de reconversion écologique. Selon Gilles
L. Bourque, « le Québec en tardant à réactiver une
politique industrielle adaptée aux défis du XXIe
siècle s’expose à des régressions brutales ».
Il préconise l’adoption de nouvelles politiques
industrielles basées sur l’établissement un dialogue
ouvert, la transparence, la coopération, la clarté des
critères de financements, un programme précis et
une reddition de compte. Car des enjeux nouveaux
imposent de revenir à des politiques industrielles
NOTES D’INTERVENTION DE L’IRÉC
Un corpus de connaissances qui s’enrichit
POLITIQUES INDUSTRIELLES/SUITE À LA PAGE 3
LOGEMENT/SUITE À LA PAGE 3

Au cours du mois d’août 2011, l’IQ-30 a
subi une baisse de 3,14 % pour se situer
à 1308,39. Huit titres ont augmenté alors que
22 autres ont baissé au cours du mois. Six
des sept secteurs de l’IQ-30 ont connu une
baisse. Le secteur des Industries a connu
la plus forte variation négative soit -7,04 %.
Seul le secteur des Télécommunications a
connu une hausse de l’ordre de 8,01 %.
Durant le dernier mois, le titre de BCE a
augmenté de +8,01 %. Celui de la compagnie
Tableau comparatif des secteurs de l’IQ-30 avec les secteurs de
l’Indice composé S & P/TSX
Depuis le début de l’année au mercredi 31 août 2011
IQ-30 (%) TSX composé (%)
10–Énergie - -11,86
15–Matériaux -42,84 -3,98
20–Industrie 3,85 -4,31
25–Consommation discrétionnaire 55,88 -15,43
30–Biens de consommation de base 3,76 0,96
35–Santé - 5,89
40–Finance -3,01 -3,29
45–Technologies de l’information -20,24 -3,13
50–Télécommunications 6,60 12,07
55–Services aux collectivités - 1,55
Variation -1,62 -5,02
N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
IQ-30: Les plus fortes hausses depuis le début de l'année
Prix ($) Prix ($) Variation Pondération (%) Variation
31 déc. 31 août du titre au 31 déc. pondérée
Société 2010 2011 % 2010 %
BCE 35,34 39,38 11,43 7,82 0,89
Groupe CGI 17,20 19,84 15,35 3,64 0,56
Groupe Jean Coutu 9,63 12,15 26,17 1,98 0,52
Banque Nationale du Canada 68,52 72,53 5,85 8,33 0,49
CN 66,35 72,03 8,56 5,61 0,48
Bombardier a affiché une diminution de
-17,47 %.
Depuis le début de l’année, six des dix
secteurs du TSX composé ont affiché des
résultats négatifs. La variation totale a été
de -5,02 %. La plus forte variation positive
provient du secteur des Télécommunications
avec une croissance de 12,07 % depuis le
début de l’année.
Pour des informations plus complètes, voir
l’URL: http://www.iq30-iq150.org/
AÉCG/SUITE DE LA PAGE1
exprimée par le gouvernement d’établir des
objectifs de « développement et la formation
de la main-d’oeuvre locale » lors de la mise en
oeuvre du Plan Nord. Il en irait de même en ce
qui a trait à l’établissement de mesures visant
à s’assurer que les nouveaux investissements
étrangers contribuent au développement social.
« Les prescriptions en matière d’emploi local
permettraient de s’assurer que les créations
d’emplois bénéficient au moins en partie aux
populations nordiques », a souligné le cher-
cheur de l’IRÉC. Les prescriptions en matière
de formation de la main-d’oeuvre réduiraient
également les coûts pour l’État et assureraient
la transmission de nouvelles compétences aux
travailleuses et aux travailleurs québécois.
Pourtant, plusieurs pays parmi les plus
développés comme la Nouvelle-Zélande, la
Norvège, la France et le Japon imposent des
restrictions à la propriété étrangère afin de
maintenir un contrôle et de protéger les rende-
ments d’une industrie particulière. Le Canada
a déjà mis en place de telles politiques. Or,
l’utilisation de prescriptions de résultats serait
interdite par l’AÉCG!
L’environnement
Concernant l’environnement, le rapport
relate l’expérience de l’ALÉNA qui contient
des dispositions quasi identiques à l’AÉCG
Canada-UE. Des avocats « créatifs et astucieux
» ont convaincu les tribunaux d’arbitrage
d’interpréter certaines dispositions de manière
totalement contraire à ce qui était prévu par les
négociateurs.
Des exemples: Metalclad qui s’était vu
interdire l’utilisation d’un site d’enfouissement
au Mexique, Ethyl Corporation dont on avait
prohibé l’importation du méthylcyclopenta-
diényle tricarbonyle de manganèse (MMT),
un additif dans l’essence et S.D. Myers qui ne
pouvait plus exporter au Canada des déchets de
biphényles polychlorés (BPC) ont gagné en tout
ou en partie leur plainte contre les autorités
gouvernementales. Ironiquement, ces décisions
arbitrales ont été prises en dépit du préambule
de l’ALÉNA qui rend légitime la poursuite
d’objectifs environnementaux. Autrement dit,
les investisseurs étrangers se servent de la
législation pour contester la règlementation des
États et les objectifs environnementaux ne sont
pratiquement jamais pris en compte dans les
décisions d’arbitrage
Le rapport de l’IRÉC s’intitule L’inves-
tissement dans l’Accord économique et
com mercial global Canada-Europe et ses
conséquences pour le Québec.
Voir l’URL http://www.irec.net/index.
jsp?p=33 sur le site de l’IRÉC.
2
Tableau comparatif des secteurs
Depuis le vendredi 29 juillet 2011 au mercredi 31 août 2011
IQ-30 (%) TSX Composé (%)
10–Énergie - -8,24
15–Matériaux -0,39 5,06
20–Industrie -7,04 -5,66
25–Consommation discrétionnaire -3,55 -7,31
30–Biens de consommation de base -3,87 -2,62
35–Santé - -11,05
40–Finance -3,59 -1,13
45–Technologies de l’information -3,41 -0,20
50–Télécommunications 8,01 3,87
55–Services aux collectivités - 2,41
Variation -3,14 -1,37
N.B. Le secteur de l’énergie, la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
ANALYSE DU CASIQ AU 31 AOÛT 2011
L’IQ-30 connaît une baisse de 3,14%

Le chercheur poursuit en expliquant que «
nous sommes témoins de la victoire d’une
idéologie mise de l’avant par les gouverne-
ments. Bien que l’esprit qui guide ces négocia-
tions est fortement teinté de l’idéologie néolibé-
rale, ce ne sont pas les entreprises privées qui
les ont mises de l’avant. Ce sont les élus. C’est
notamment le cas du premier ministre Charest
qui en fait une question quasi personnelle,
d’héritage politique même. Pour lui, le traité
constitue un premier pas vers d’autres ententes
comme celle signée avec la France sur la
reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles ».
Ce rapprochement avec l’Europe est la mise
à jour d’une vieille idée qui avait émergé sous
le gouvernement Trudeau. Ce dernier voulait
développer une troisième voie afin de réduire la
dépendance du Canada envers les États-Unis.
Des études peu convaincantes
Pourtant, toutes les études portant sur les
bienfaits de l’ALÉNA sont loin d’être convain-
cantes. « Les travaux notamment du Groupe de
recherche sur l’intégration continentale1 ainsi
que ceux de Dorval Brunelle et de Christian
Deblock 2 devraient inciter les responsables
politiques à faire preuve de discernement
lorsqu’ils négocient des accords de libre-
échange », indique Alexandre L. Maltais.
Pas n’importe quel accord éco-
nomique
Le chercheur de l’IRÉC ne s’oppose pas à
la négociation d’accords économiques entre
les pays. Cet accord avec l’Union européenne
pourrait être une chance pour le Québec à
1. http://www.gric.uqam.ca
2. BRUNELLE, Brunelle et de Christian DEBLOCK.
L’ALENA: le libre-échange en défaut, Fides, 2004; «
Une intégration nord-américaine destructrice d’emplois:
les illusions du libre-échange au Québec », Le Monde
diplomatique, février 1999
3
Le gouvernement canadien
n’a rien appris
Alexandre L. Maltais, l’auteur de la deuxième étude de l’IRÉC sur l’Accord
économique commercial et global - Canada-Europe (AÉCG), est sidéré de voir
avec quelle désinvolture le gouvernement canadien s’apprête à signer un
accord sans tenir compte de l’expérience de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA). « Depuis 20 ans, le chapitre 11 de l’ALÉNA s’est révélé
être l’aspect le plus problématique de l’entente tripartite, explique le cher-
cheur. Pourtant, les négociateurs canadiens s’apprêtent à conclure un accord
en tous points semblable au chapitre 11 tout en sachant qu’il contribuera
à la marginalisation de l’intérêt public. C’est grave, car nous ne pourrons
pas plaider que nous ne savions pas! ». La rédaction du Bulletin de l’IRÉC le
remercie chaleureusement pour l’entrevue qu’il a accepté de lui accorder.
condition qu’il soit négocié correctement.
D’ailleurs, il note dans son rapport une
explosion du nombre de traités bilatéraux de
promotion et de protection de l’investissement
(TBI) depuis les dernières décennies. Selon la
Conférence des Nations unies sur le commerce
et le développement, plus de 2800 traités bila-
téraux étaient en vigueur en 2008. Il en résulte
que la vaste majorité des États du monde est
liée à un ou plusieurs accords de ce type. Par
exemple, le Canada a conclu plus de 33 accords
de protection de l’investissement étranger et
négocie avec huit autres États.
Cependant, « les négociations entourant
l’AÉCG sont troublantes à plus d’un titre, dit-il.
D’une part, on peut entrevoir les coûts énormes
engendrés par un tel accord, notamment en
octroyant aux investis-
seurs étrangers un droit de
poursuivre les gouverne-
ments devant les tribunaux
internationaux, de l’autre,
il y a un risque réel de perte
de souveraineté. L’objectif
de l’AÉCG Canada-Union
européenne n’est plus le
développement économique,
mais l’application doctri-
naire de préceptes dont les
bienfaits sont considérés
comme automatiques. Le
traité évacue la défense des intérêts
supérieurs du Québec ».
Approche pragmatique
Bien entendu, il se trouve des chercheurs
pour dire que ce danger n’existe pas. À preuve,
dit-on, c’est l’État canadien appuyé notamment
par le Québec de Jean Charest qui a enclenché
la négociation. « J’ai adopté une approche
pragmatique, explique le chargé de projet. Je
crois que ce serait une erreur de débattre de
cet enjeu à partir de préjugés, favorables ou
défavorables envers le libre-échange, puisqu’il
s’agit d’étudier les textes. Il nous faut analy-
ser, quantifier, établir le pour et le contre. Je
constate que l’accord est encore plus large que
ce qui a été négocié auparavant. La libéra-
lisation des marchés publics des provinces
canadiennes et du Québec par exemple, c’est du
jamais vu. Le Québec n’a jamais fait cela dans
le cadre d’un traité permanent. Les négocia-
teurs nous présentent cela comme un accord de
seconde génération, un bel euphémisme pour
cacher l’hypothèque qu’ils feront peser sur les
générations qui vont suivre! »
L’avenir des négociations
Alexandre Maltais a terminé l’entrevue
en expliquant que les négociations peuvent
prendre une autre tournure lorsque la question
de la culture et des télécommunications
sera remise à l’ordre du jour. Il prévoit une
réaction de l’opposition parlementaire et de
la société civile. « Ma compréhension est que
les négociateurs ne veulent pas y toucher alors
que les Conservateurs veulent en faire un
enjeu de ces négociations. Le Québec a été de
tous les combats pour faire reconnaître, avec
succès jusqu’ici, l’exception culturelle dans les
accords commerciaux. Cette victoire qui a été
obtenue de haute lutte demeure vivace dans
la mémoire. D’ailleurs, le premier ministre
Charest est sur la même longueur d’onde que
le président français Nicolas Sarkozy précisé-
ment sur la question de l’exception culturelle »,
conclut-il.
Natif d’Alma, Alexandre L. Maltais pour-
suit des études de droit international à
l’Institut des Hautes études internationales et
du développement (IHEID) de Genève avec un
intérêt marqué pour le droit économique.
Il détient un baccalauréat en relations
internationales et en droit international de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Il a rédigé les deux rapports de recherche de
l’IRÉC sur l’Accord économique commercial et
global (AÉCG) Canada-Europe.
Le premier1, publié en janvier 2011, analyse
l’accord sous l’angle des services publics; le
second2, publié en septembre 2011, le fait sous
l’angle des investissements.
Alexandre L. Maltais
1. MALTAIS, Alexandre. L’Accord économique et
commercial global Canada-Europe: quelles consé-
quences pour le Québec? IRÉC, Janvier 2011, 39 pages.
2. MALTAIS, Alexandre. L’investissement dans l’Accord
économique et commercial global Canada-Europe
et ses conséquences pour le Québec. IRÉC, Septembre
2011, 31 pages.
La version intégrale de ces deux rapports est disponible
sur notre site à l’URL suivante: http://www.irec.net/index.
jsp?p=33
ENTREVUE AVEC ALEXANDRE L. MALTAIS

Bulletin d’information
de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) à l’intention des Amis
de l’IRÉC/Numéro 17
1030, rue Beaubien Est, bureau 103
Montréal, Québec H2S 1T4
Tél. 514 380-8916/Télécopieur: 514 380-8918
secretariat@irec.net/ www.irec.net
Directeur général de l’IRÉC: Robert Laplante
Responsable du bulletin: André Laplante
514 380-8916 poste 21
andrelaplante@irec.net
Collaboration: Frédéric Farrugia (CASIQ)
Graphisme(grille): Anne Brissette
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du
Québec
BULLETIN DE L’
LOGEMENT
/SUITE DE LA PAGE1
4
L’IRÉC EN MOUVEMENT
n
L’équipe se consolide
L’IRÉC a embauché un quatrième économiste en la personne de Jules Bélanger. Il s’occupera
principalement des questions liées à l’énergie
Il est détenteur d’une maîtrise et d’un bacca-
lauréat en Sciences économiques à l’Université de
Montréal et d’une deuxième maîtrise de l’École
d’économie de Toulouse (TSE) en environnement,
ressources naturelles et agriculture.
Il a déjà travaillé pour l’institut à titre de
chargé de projet sur l’électrification des trans-
ports collectifs et l’indépendance énergétique du
Québec.
Jules Bélanger
Photo:AndréLaplante
Vue d’ensemble de la nouvelle salle de conférence. À
gauche de la photo, on peut apercevoir un des deux
bureaux qui ont été ajoutés.
n
L’agrandissement
des bureaux
L’IRÉC a également agrandi ses bureaux.
Cette décision a été rendue nécessaire par
le grand nombre de projets mis de l’avant par
l’institut. Ce dernier compte maintenant six
bureaux, une petite salle de réunion et une
salle de conférence plus grande
pour les réunions du conseil
d’administration notamment. (Voir
photo ci-contre)
n
Modernisation
du système
téléphonique
Enfin, l’IRÉC a modernisé son
système téléphonique. On peut
rejoindre directement chacun des
membres de l’équipe et laisser un
message dans leur boîte vocale. En écoutant
le message après avoir signalé le (514) 380-
8916, vous avez les options suivantes:
Robert Laplante, poste 20;
André Laplante, poste 21;
Odile Rochon, poste 22;
Gilles L. Bourque, poste 23
Jules Bélanger, poste 25.
Il est possible de contacter l’IRÉC en
signalant le zéro ou de laisser un message
dans la boîte vocale dédiée à l’institut.
Pour joindre Frédéric Farrugia (CASIQ),
signalez le (819) 821 8000 poste 61932
Des adresses de courriel ont été modifiées
ou ajoutées:
robertlaplante@irec.net
julesbelanger@irec.net
gillesbourq[email protected]
Celles d’André Laplante (andrelaplante@
irec.net), de l’IRÉC (secretariat@irec.net) et de
Frédéric Farrugia (frederic.farrugia@usher-
brooke.ca) sont demeurées telles quelles.
d’impacts positifs sur la santé et le bien-être. Le
chercheur recommande donc de maintenir la
formule du programme AccèsLogis Québec.
En ce qui a trait au renouvellement des
conventions sur le logement social, des
solutions doivent déboucher sur le maintien
de l’intervention publique et sur une capacité
améliorée des organisations collectives à déve-
lopper le logement social au Québec. Ainsi, des
pistes doivent être explorées pour utiliser les
capitaux des caisses de retraite pour soutenir le
niveau et la qualité de vie des retraités par des
placements dans des infrastructures répondant
adéquatement aux besoins sociaux. Diverses
formules d’investissement mériteraient d’être
examinées.
Cette huitième note d’intervention de l’IRÉC
s’intitule Le logement au Québec: les ten-
dances actuelles. Voir l’URL suivante: http://
www.irec.net/index.jsp?p=76
POLITIQUES INDUSTRIELLES
/SUITE DE LA PAGE1
plus ciblées. Le rôle des acteurs économiques
ne repose plus sur le seul État et accorde la
priorité aux dynamiques plutôt qu’aux seuls
résultats. D’où l’importance stratégique d’une
coordination efficace et d’une participation de
tous les acteurs. Le succès repose aussi sur la
création de nouveaux instruments complémen-
taires aux banques et au capital de risque.
C’est ce renouveau des politiques industriel-
les qui explique le succès des pays émergents et
des régions dynamiques des pays avancés.
Gilles Bourque suggère pour le Québec de
créer une nouvelle agence pour coordonner les
stratégies visant une reconversion écologique
de l’économie québécoise, de lancer de grands
projets mobilisateurs dans les domaines des
transports, de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables et de redonner à tous les
acteurs de la société civile – en particulier les
mouvements syndicaux, de l’économie sociale
et écologiste – une pleine participation au
processus de formulation et de mise en oeuvre
des stratégies.
Cette neuvième note d’intervention de
l’IRÉC s’intitule Le renouveau des politi-
ques industrielles: de la restructuration
industrielle à la reconversion écologi-
que. Voir l’URL suivante: http://www.irec.net/
index.jsp?p=76
Nous vous suggérons de consulter l’excellent
article paru le 30 août 2011 dans Le Devoir au
sujet de cette note d’intervention. Voir l’URL
suivante: http://www.ledevoir.com/econo-
mie/actualites-economiques/330314/l-
irec-propose-de-remodeler-la-strategie-
industrielle
Photo:AndréLaplante
1
/
4
100%