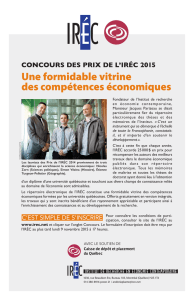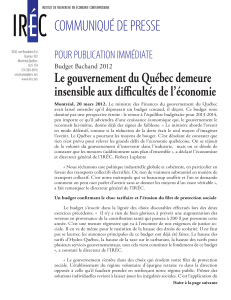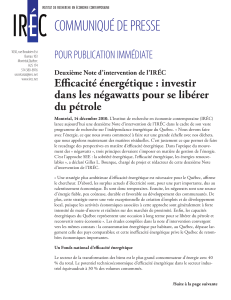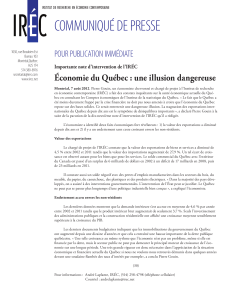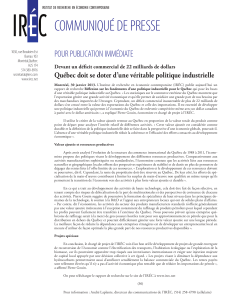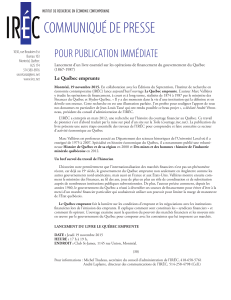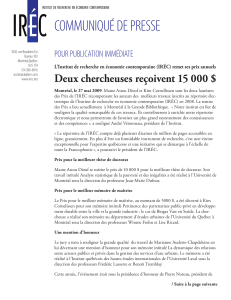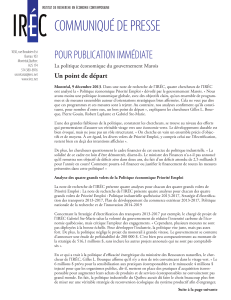Bulletin de l’ L’échec prévisible des régimes volontaires d’épargne retraite (rVÉr)

Bulletin de l’
Mensuel publié par l’Institut de recherche en économie contemporaine/Avril 2013
SOMMAIRE
2/Analyse du CASIQ
3/Une étude biaisée sur les
dépenses publiques au Québec
4/Nouvelles brèves
Crédits
RéfoRme des Régimes de RetRaite
L’échec prévisible des régimes volontaires
d’épargne retraite (RVÉR)
RÉFORMES/Suite à la page2
Les amis de L’iRéC
Soutenir son
indépendance
En devenant un Ami
de l’IRÉC ou en inci-
tant vos amis à le devenir,
vous permettez à l’Institut
de préserver son indé-
pendance intellectuelle et
financière. Pour en savoir
plus: http://www.irec.net/
index.jsp?p=31
COLLOQUE IRÉC/HEC MONTRÉAL
Une politique
industrielle du
21e siècle
L’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) et la Direction du
développement durable HEC Montréal orga-
nisent un colloque sur les restructurations
en cours et à venir en vue d’une reconversion
écologique de l’économie et l’établissement
d’une politique industrielle du 21e siècle.
Pour informations: www.irec.net/Col-
loques/Colloques de l’IRÉC/Colloque sur la
reconversion ou André Laplante, IRÉC, 514-
380-8916 poste21.
DATE: 31 mai 2013
ENDROIT: HEC Montréal, 5255
rue Decelles, salle Lévis
HEURE: 8h30 à 16h45
Le Comité sur l’avenir des régimes complémentaires de retraite a présenté son rap-
port. Quelques jours avant le dépôt, l’Institut de recherche en économie contempo-
raine (IRÉC) a diffusé une note d’intervention sur les écueils à éviter. La critique de
la formule des régimes volontaires d’épargne retraite (RVÉR) est particulièrement
pertinente, car le RVÉR est une des mesures favorisées dans le rapport D’Amours.
Une analyse plus complète de ce rapport par l’IRÉC est en préparation.
À NOTER
❚
À Radio-Ville Marie
Par-dessus le
marché
L
es émissions économiques
hebdomadaires de l’IRÉC
sont diffusées sur les ondes
de Radio Ville-Marie tous les
mercredis à 11 heures. Ils sont
aussi disponibles sur le site
de l’IRÉC. Cliquer sur l’icône
représentant un œil à gauche
de l’écran sur la page d’accueil
et à côté de laquelle est inscrit
«Audio et vidéo». [http://www.
irec.net/index.jsp?p=58].
Les défauts du RVÉR sont nombreux et sont loin
d’être des vues de l’esprit. «Pour les visuali-
ser correctement, souligne Gilles Bourque, il faut
regarder ce qui se passe aux États-Unis avec la
formule du régime401(k). C’est à partir du début
des années1980 que se généralise sur une large
échelle dans les entreprises la formule du régime de
retraite du régime401(k), dont le nom réfère à la
section401(k) de la loi de l’impôt des États-Unis. Le
régime401(k) permet d’épargner pour sa retraite en
défiscalisant l’argent investi et les revenus du capital
jusqu’à leur retrait. L’employé est libre de participer
ou non au régime401(k) offert par son employeur.
Il peut décider de limiter les sommes épargnées,
et choisit les stratégies d’investissement de son
capital dont la gestion est conduite par des sociétés
spécialisées en gestion d’actif. Comme le propose le
RVER, l’employeur n’est pas obligé de contribuer au
régime401(k) de ses employés.
Mêmes limites que les RÉER
De façon identique aux RÉER, les régimes401(k)
sont vulnérables aux fluctuations boursières, avec
les résultats de rendement désastreux depuis la crise
de 2008. Il n’est pas rare qu’ils subissent des pertes,
Un soUtien poUR La ReCheRChe en
sCienCe éConomiqUe
Remise des Prix
de l’IRÉC2012
Pour la treizième année consécutive, l’Institut
de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) décerne
ses Prix de l’IRÉC. L’institut offre
annuellement 25000$ en prix
pour récompenser les auteurs
des meilleurs travaux inscrits
à son répertoire électronique de
publications.
Pour informations: www.irec.net/Prix de
l’IRÉC ou André Laplante, IRÉC, 514-380-8916
poste21.
DATE: 22 mai 2013
ENDROIT: Grande Bibliothèque, 475
boulevard de Maisonneuve, salle M-450,
HEURE: 17h30 à 19h
À ne pas
manquer

RÉFORMES/Suite de la page1
Au cours du mois de mars 2013, l’IQ-
30 a baissé de 0,61% pour se situer à
1521,58. Quatorze titres ont augmenté alors
que 16 autres ont baissé. Cinq des sept secteurs
de l’IQ-30 ont connu une hausse. Celui de la
Consommation discrétionnaire a connu la plus
forte variation positive soit 2,47%. Le secteur
de l’Industrie a connu une baisse de l’ordre de
2,86%.
Le titre de la compagnie Dollorama a
augmenté de 7,64%. Celui de la compagnie
IQ-30: Les plus fortes hausses depuis le début de l’année
Prix ($) Prix ($) Variation Pondération (%) Variation
31 déc. 28 mars du titre au 31 déc. pondérée
Société 2012 2013 % 2012 %
BCE 42,63 47,46 11,33 8,33 0,94
Groupe CGI 22,94 27,61 20,36 4,21 0,86
Cie des chemins de fer nationaux 90,33 102,10 13,03 5,88 0,77
Industrielle Alliance 31,38 37,36 19,06 3,00 0,57
Alimentation Couche-Tard 48,93 55,06 12,53 4,28 0,54
Banque Nationale du Canada a affiché une
diminution de l’ordre de -5.03%.
Depuis le début de l’année, neuf des dix
secteurs du TSX composé ont crû positivement
alors que la variation totale a été de 2,54%. La
plus forte variation positive provient du secteur
des Technologies de l’information avec une
croissance de 15,81%.
Pour des informations plus complètes, voir
l’URL: [http://www.iq30-iq150.org]
2
Tableau comparatif des secteurs
Depuis jeudi 28 février 2013 au jeudi 28 mars 2013
IQ-30 (%) TSX Composé (%)
10– Énergie - -0,36
15– Matériaux 1,51 -1,95
20– Industrie -2,86 0,28
25– Consommation discrétionnaire 2,47 5,07
30– Biens de consommation de base 1,46 1,16
35 – Santé - 0,56
40– Finance -2,32 -2,42
45– Technologies de l’information 1,32 2,72
50– Télécommunications 2,09 -2,13
55– Services aux collectivités - -2,66
Variation -0,60 -0,56
N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
anaLyse dU Casiq aU 28 maRs 2013
L’IQ-30 connaît une baisse de 0,61%
Tableau comparatif des secteurs de l’IQ-30 avec les secteurs de
l’Indice composé S & P/TSX
Depuis le début de l’année au jeudi 28 mars 2013
IQ-30 (%) TSX composé (%)
10– Énergie - 1,87
15– Matériaux -19,27 -10,74
20– Industrie 8,45 13,96
25– Consommation discrétionnaire 10,20 11,79
30– Biens de consommation de base 6,70 5,16
35 – Santé - 13,96
40– Finance 4,22 3,46
45– Technologies de l’information 20,36 15,81
50– Télécommunications 11,33 9,05
55– Services aux collectivités - -1,05
Variation 6,49 2,54
N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
1. BOURQUE, Gilles L. Réforme des retraites: éviter
les catastrophes, Note d’intervention de l’IRÉC,
numéro26, avril 2013, 4 p. [http://www.irec.net/upload/
File/note_d_intervention_no_26_avril_2013.pdf]
l’épargnant voyant ainsi sa retraite diminuer,
voire presque totalement disparaître comme ce
fut le cas pour plusieurs employés d’Enron. Les
employés avaient placé en moyenne 62% de
leur capital401(k) en actions d’Enron (classées
triple A par les firmes de notation!). Ils ont tout
perdu avec la faillite frauduleuse.
Après l’apparition du régime401(k), la
situation des régimes de retraite des salariés
étatsuniens s’est transformée: sur tous les
travailleurs couverts par des régimes, dans
62% des cas ils avaient des régimes à presta-
tions déterminées contre 12% des régimes à
cotisations déterminées. Trente ans plus tard,
ils n’étaient plus que 19% avec des régimes à
prestations déterminées contre 12% de régimes
hybrides et 69% à cotisations déterminées,
principalement des régimes401(k).
«Non seulement, note le chercheur, cette
formule n’est pas bonne pour les ménages, avec
de mauvais rendements, des frais élevés et une
sensibilité extrême au cycle économique, elle
représente en plus une dépense fiscale pharao-
nique au budget des États-Unis. Selon l’Urban
Institute-Brookings Institution Tax Policy
Center, les pertes de revenus fiscaux associés
au régime 401(k) et à l’IRA (la version état-
sunienne de nos RÉER) s’élèveraient à 1 000
milliards de dollars pour la présente décennie
(2011-2020)».
Comprendre les enjeux
La note fournit un excellent cadre général
d’analyse pour comprendre les enjeux liés aux
réformes et l’auteur propose des pistes de solu-
tions afin de rendre les régimes plus viables à
long terme en réduisant la probabilité de défi-
cit. «Cette recherche, explique-t-il, passe par
la constitution de réserves ou par la mise en
place de certaines prestations conditionnelles
à la situation financière du régime ou encore
par des mesures qui répartissent mieux les
risques lorsque des déficits se produisent tout
en offrant des garanties et un contrôle clairs
sur l’orientation du régime lorsque les surplus
vont se produire».
Gilles Bourque donne l’exemple des cols
bleus de Montréal, qui ont entériné une entente
de principe avec leur employeur au sujet de
leur régime de retraite. Pour améliorer la santé
financière du régime, la solution négociée a été
d’augmenter les cotisations par travailleur et de
créer un fonds de stabilisation afin d’amortir
les chocs ultérieurs éventuels.

CentRe sUR La pRodUCtivité et La pRospéRité
Une étude biaisée sur les dépenses
publiques au Québec
Une étude1 publiée récemment attaque de front les choix démocratiques faits par le Qué-
bec au cours des dernières décennies. Cette étude veut démontrer qu’en matière de finances
publiques le Québec est incompétent, ce qui le condamne à une performance économique
médiocre. Cette analyse est minée par de graves erreurs méthodologiques qui faussent les
résultats. En outre, les auteurs mettent en évidence les informations qui soutiennent leur
thèse tandis qu’ils ignorent les constatations qui la contredisent.
Jonathan Desrosiers et Robert Gagné
analysent une grande quantité de données
sur les dépenses des administrations publiques
au Canada de 1981 à 2009 pour illustrer une
réalité déjà connue, soit que le Québec dépense
proportionnellement davantage que les autres
provinces canadiennes en services publics.
L’à priori idéologique
La faiblesse la plus fondamentale de cette
étude se trouve à la page d’introduction. On y
tente d’établir que les dépenses publiques éle-
vées sont toujours néfastes à l’économie. Pour-
tant il ne s’agit pas là d’une loi généralement
acceptée par les économistes universitaires et
les pays scandinaves en sont un contrexemple
éloquent.
Ce qui est généralement admis, c’est qu’un
déficit budgétaire qui subsiste pendant une
longue période génère nécessairement des pro-
blèmes économiques et c’est plutôt cela qui est
en cause dans les difficultés de pays européens
surpris par la crise
financière interna-
tionale. Pour sa part,
le Québec a fait des
choix de société et il
les assume par une
taxation respon-
sable. Depuis une
quinzaine d’années,
le Québec respecte
l’équilibre entre ses
revenus courants
et ses dépenses
courantes, sauf pour
l’épisode récent et
tout à fait acceptable d’un déficit lié à la crise
économique.
Cependant, indépendamment de la crise,
l’équilibre budgétaire a été mis en péril depuis
l’élection en 2003 du gouvernement libéral qui
a décrété des baisses d’impôts sur des fonde-
ments idéologiques en planifiant du même
coup que ces baisses forceraient la réduction
des services publics ou
leur privatisation. En effet,
une dépense en santé,
par exemple, constitue un
problème pour l’économie
tant qu’elle est une dépense
publique, mais elle devient
respectable dès qu’elle
génère des profits privés.
Parce qu’elles profitent
aussi aux entrepreneurs
privés, les dépenses publi-
ques en infrastructures,
principales responsables
de la croissance de la
dette du Québec depuis
dix ans, sont également
respectables dans l’optique
néolibérale, même lorsqu’elles dégagent des
odeurs de corruption.
Il est vrai que la population a élu et réélu
un gouvernement libéral qui promettait des
baisses d’impôts, mais il promettait aussi que
l’équilibre budgétaire serait maintenu grâce à
la réingénierie de l’État et sans réduction des
services publics.
Quant aux choix rationnels des Québé-
cois et des Québécoises, les auteurs de l’étude
tentent de faire croire, en les qualifiant de
dépensiers, qu’ils ne réussissent pas à contrôler
leur frénésie de dépenses en services publics
et qu’ils ne comprennent pas l’impact de ces
dépenses sur leur économie, un impact qu’ils
supposent négatif à priori.
Les lacunes méthodologiques
Les comparaisons interprovinciales de
dépenses publiques exigent une grande pru-
dence dans le choix et dans l’interprétation des
données. Quand on considère globalement les
dépenses des trois niveaux d’administration, le
fédéral, le provincial et le municipal, l’écueil
le plus important est lié à ce qu’on appelle les
dépenses fiscales. Quand un gouvernement
offre des crédits d’impôt aux utilisateurs de
services publics, l’impact
budgétaire est aussi impor-
tant que si le gouvernement
offrait lui-même le service
ou le subventionnait.
Cependant, la valeur de ces
crédits d’impôt n’est pas
prise en compte dans les
dépenses publiques et c’est
pourquoi on a créé une
comptabilité spéciale qui
les inclut sous l’appella-
tion de dépenses fiscales.
Les auteurs de l’étude ne
mentionnent pas qu’ils
auraient pris en compte ces
dépenses fiscales. Ainsi, le
réseau de garderies à sept
dollars et celui des centres d’hébergement et de
soins de longue durée impliquent des dépenses
publiques élevées au Québec alors que les pro-
vinces qui privilégieraient les crédits d’impôt
aux utilisateurs apparaîtraient artificiellement
plus économes. Dans le chapitre où les dépen-
ses du gouvernement fédéral sont exclues, le
partage variable des responsabilités entre le
fédéral et les provinces vient aussi fausser les
résultats. Par exemple, le Québec s’est retiré de
plusieurs services fédéraux, comme la percep-
tion des impôts et le programme d’assurance
parentale et il gère son propre régime public
de retraite, le RRQ. Finalement, dans l’analyse
des dépenses des administrations provinciales
il est essentiel de reconnaître que le partage
des juridictions entre les municipalités et les
administrations provinciales n’est pas uniforme
dans l’ensemble des provinces canadiennes.
Par exemple, les municipalités ontariennes
assument des dépenses sociales qui, au Québec,
sont réalisées par l’administration provin-
ciale. Les auteurs reconnaissent ce problème
méthodologique, mais ils maintiennent les
résultats de ces comparaisons non valides et
DÉPENSES PUBLIQUES/Suite à la page4
Pierre Gouin, économiste et chargé de projet
Les auteurs met-
tent en évidence
les informations
qui semblent
soutenir leur
thèse tandis
qu’ils ignorent
les constatations
qui la contredi-
sent.
Photo: Normand Rajotte

4
Bulletin d’information
de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) à l’intention des
Amis de l’IRÉC/Numéro33
1030, rue Beaubien Est, bureau103
Montréal, Québec H2S 1T4
Tél. (514) 380-8916/Télécopieur: (514)
380-8918
secretariat@irec.net/ www.irec.net
Directeur général de l’IRÉC: Robert
Laplante
Responsable du bulletin: André Laplante
(514) 380-8916 poste21
andrelaplante@irec.net
Collaboration: Frédéric Farrugia, Pierre
Gouin, Gilles Bourque
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du
Québec
Bulletin de l’
DÉPENSES PUBLIQUES/Suite de la page3
n Les 15 et 16 avril, l’IRÉC a participé aux
Assises nationales de la recherche et de
l’innovation à Québec organisées par le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie.
Pour un compte rendu fidèle, voir [http://
www.ledevoir.com/societe/science-et-technolo-
gie/375883/duchesne-prete-l-oreille-aux-propo-
sitions-des-participants]
n Le 23 avril, l’IRÉC a participé à une table
ronde Les redevances minières: quel
modèle pour le Québec ? dans la cadre de la
grande conférence Les Affaires Objectif Nord
à Québec. [http://www.lesaffaires.com/evene-
ments/grandes-conferences/le-developpement-
nordique/552945]
n Il est possible d’écouter l’entrevue que
Pierre Gouin a accordée
à l’émission de radio
Par-dessus le marché
du 24 avril 2013 au sujet
de l’étude de Desrosiers et
Gagné qu’il analyse dans
ce numéro du Bulletin de
l’IRÉC [http://www.irec.
net/index.jsp?p=58]
n Dans le cadre du congrès de l’Associa-
tion francophone pour le savoir (ACFAS),
l’IRÉC est coorganisateur le 10 mai 2013 d’un
colloque sur le modèle agricole québécois.
[http://www.acfas.ca/evenements/congres/
programme/81/400/424/c]
en reprennent même un des éléments dans la
conclusion.
Une interprétation biaisée
Le titre de l’étude annonce des comparai-
sons interprovinciales ainsi que l’analyse de
tendances. Les données sur les dépenses publi-
ques globales des trois paliers de gouvernement
semblent soutenir l’hypothèse que le Québec
utilise davantage de servi-
ces publics que l’Ontario
et que les autres provinces
canadiennes, en moyenne.
Ainsi, ces dépenses s’éta-
blissent à 47% du PIB au
Québec en 2009, compara-
tivement à 38% en Ontario,
ce qui représente un ratio
25% plus élevé. De même,
les dépenses publiques par
habitant sont de 16150$
au Québec en 2009, com-
parativement à 14847$ en
Ontario, un écart de 9%. Il
faudrait prendre en compte
les dépenses fiscales sous
forme de crédits d’impôt
pour obtenir un portrait exact.
Par contre, l’analyse de l’évolution des
dépenses publiques de 1981 à 2009 est loin
d’être défavorable au Québec. De 1981 à
2009, les dépenses publiques par habitant ont
augmenté moins rapidement au Québec (40%)
qu’en Ontario (56%) et qu’en moyenne au
Canada (48%). Au cours de cette période, le
reste du Canada s’est rapproché du Québec en
matière de dépenses publiques par habitant. De
plus, le ratio des dépenses publiques sur le PIB
a légèrement diminué au Québec alors qu’il
augmentait légèrement en Ontario et dans le
reste du Canada. Même en ne considérant que
les dépenses des administrations provinciales,
par habitant, celles-ci ont crû moins rapide-
ment au Québec qu’ailleurs au Canada entre
1981 et 2009. Les auteurs ont donc dû se rabat-
tre sur deux observations plutôt insignifiantes
en conclusion de leur analyse des tendances.
D’abord, l’étude retient qu’au Québec les
dépenses provinciales sont responsables d’une
plus grande part (80%) de la croissance des
dépenses publiques qu’en Ontario (56%)
et qu’ailleurs au Canada (64%) sans men-
tionner que les dépenses de l’administration
provinciale y ont augmenté moins rapidement
qu’ailleurs au Canada. On ne rappelle pas que
les écarts sont beaucoup plus faibles si on tient
compte du partage différent des responsabilités
entre les provinces et les municipalités.
Enfin, on conclut que la croissance des
dépenses du gouvernement du Québec provient
principalement des dépenses pour les garde-
ries, les centres d’hébergement pour personnes
âgées et les services sociaux autres que l’éduca-
tion et la santé, deux secteurs où la croissance
des dépenses a été plus faible au Québec. Les
auteurs ignorent que la décision de mettre en
place un réseau de garderies publiques n’a pas
été le fruit d’une rage incontrôlée de dépenser.
Une étudeéconomique2 a montré que l’ob-
jectif visé avait été atteint
puisqu’un impact significa-
tif sur le taux de participa-
tion au marché du travail et
sur l’économie du Québec a
été généré par l’implanta-
tion de ce réseau.
Une gestion rigou-
reuse
Paradoxalement, cette
dernière constatation
des auteurs indique une
rigueur dans la gestion
des fonds publics au
Québec puisque, malgré
les dépenses créées par de
nouveaux choix de société,
au total, les dépenses publiques en proportion
du PIB sont demeurées stables depuis 1981, et
les dépenses par habitant ont augmenté moins
rapidement qu’en Ontario et dans le reste du
Canada. Quant à l’impact négatif sur le niveau
de vie, il n’est pas confirmé par le PIB par
habitant qui s’est accru au même rythme au
Québec qu’en moyenne au Canada depuis 1981.
1. DESROSIERS, Jonathan et Robert GAGNÉ.
Dépenses publiques au Québec: compa-
raisons et tendances, HEC-Montréal, avril
2013, 36 p. [http://cpp.hec.ca/cms/assets/docu-
ments/recherches_publiees/PP_2012_06.pdf].
2. FORTIN, Pierre, Luc GODBOUT et Suzie
ST-CERNY. L’impact des services de garde
à contribution réduite du Québec sur le
taux d’activité féminin, le revenu inté-
rieur et les budgets gouvernementaux,
chaire de recherche en fiscalité et en finan-
ces publiques, Université de Sherbrooke, 13
avril 2012, 34 p. [http://www.usherbrooke.ca/
chaire-fiscalite/fileadmin/sites/chaire-fiscalite/
documents/Cahiers-de-recherche/Etude_fem-
mes_travail.pdf]
Nouvelles brèves
Le Centre sur la productivité et la
prospérité de HEC Montréal a été créé
en 2009. Il a deux partenaires: le
ministère des Finances du Québec et
Productivité 202020, un programme
lancé par le Groupe Les Affaires.
1
/
4
100%