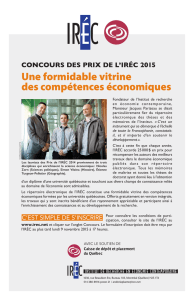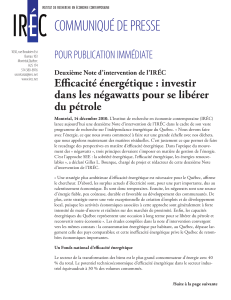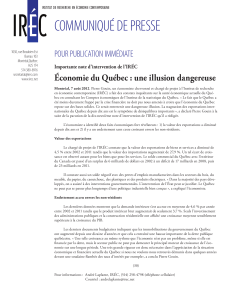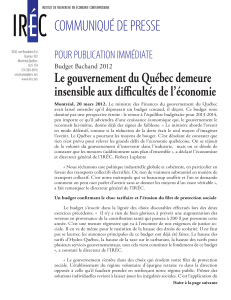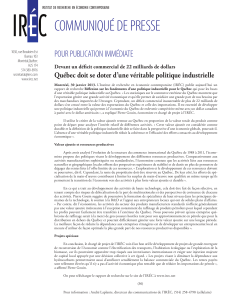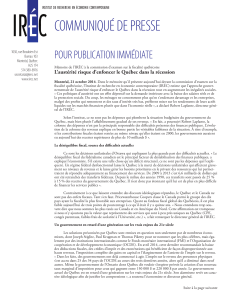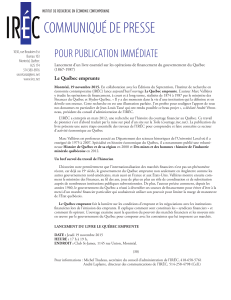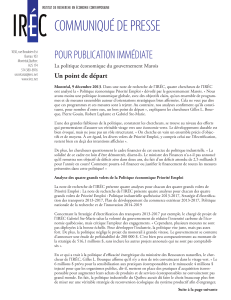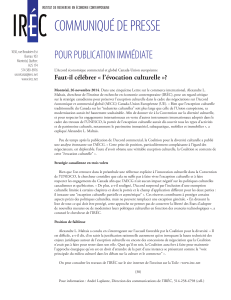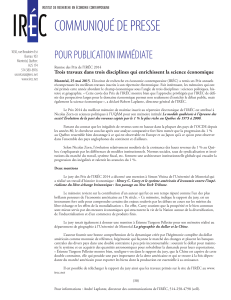CoMMuniQué dE prESSE pour puBliCaTion iMMédiaTE

1030, rue Beaubien Est
Bureau 103
Montréal,Québec
H2S 1T4
514 380-8916
www.irec.net
INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Un choix stratégique prioritaire pour la reconversion verte
Investir massivement dans les nouvelles technologies propres
Montréal, 18 mars 2013. L’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) publie aujourd’hui une
note d’intervention sur les technologies propres rédigée en collaboration avec Écotech Québec, la grappe des
technologies propres. «Le Québec présentant un marché limité pour ces technologies, le développement du
secteur repose sur la demande internationale. À l’IRÉC, nous pensons qu’un appui gouvernemental, prenant
la forme d’un crédit d’impôt à la commercialisation, permettrait aux entreprises de technologies propres de
devenir des acteurs mondiaux, leur assurant ainsi une possibilité de croissance. Les choix en faveur d’une
économie verte imposent d’investir massivement dans le développement des capacités nancières, humaines
et productives des nouvelles technologies qui permettront de s’engager dans cette reconversion», ont expliqué
les chercheurs de l’IRÉC, Oscar Calderon et Gilles L. Bourque.
En eet, le Québec se positionne déjà favorablement au point de vue international dans les secteurs de
l’ecacité énergétique, les matières résiduelles, la biomasse et l’hydroélectricité. Il possède aussi des atouts
importants dans les secteurs du traitement de l’eau, du transport, de la réhabilitation des sols, de la chimie
verte, de l’éolien et du solaire. «En 2011-2012, sur la base d’un chire d’aaires de 6,4 milliards de dollars,
les entreprises au Québec qui développent des technologies propres ont contribué à la création de 30385
emplois directs et indirects dans l’économie québécoise. Par contre, le succès du secteur des technologies
propres, au Québec ou ailleurs, dépend en grande partie de l’ecacité de la commercialisation des produits
et services sur les marchés intérieurs ou d’exportation», constatent Oscar Calderon et Gilles L. Bourque.
Crédit d’impôt à la commercialisation
Pour soutenir un secteur où l’ore est souvent en avance sur la demande, Écotech Québec propose
l’instauration d’un crédit d’impôt à la commercialisation qui s’appliquerait en extension du crédit d’impôt
à la R&D. «L’évaluation que nous avons réalisée pour les coûts associés à cette proposition repose sur les
taux applicables les plus élevés, soit 37,5% pour le Québec et 35% pour le Canada. Nous estimons les coûts
scaux bruts de cette mesure entre 14,4 et 35,4M$, pour le gouvernement du Québec. Au fédéral, nous
les estimons entre 8,4 et 20,6M$. Pour l’intervalle supérieur, nous estimons selon les résultats de l’étude
d’impact économique qu’une augmentation du chire d’aaires de 8,2% permettrait au gouvernement du
Québec de récupérer les coûts associés à la mesure. Pour le gouvernement fédéral, il faudrait que cette mesure
entraîne une augmentation du chire d’aaires de 13,8%, pour que celui-ci récupère par la scalité et la
parascalité les coûts associés au crédit d’impôt à la commercialisation», ont expliqué les deux chercheurs.
La mesure proposée permettrait de bien positionner l’industrie des technologies propres du Québec
sur la scène internationale. «N’oublions pas que les gouvernements investissent déjà massivement pour
soutenir l’innovation. Cependant, la diculté d’accès au nancement pourrait créer une situation où les
droits de propriété intellectuelle des nouvelles technologies sont vendus à des entreprises qui ont les moyens
pour en assurer la commercialisation. Cette structure économique ne permet pas d’assurer que l’innovation
soit bénéque pour l’économie du Québec. Le crédit d’impôt à la commercialisation permettrait donc aux
gouvernements d’obtenir un meilleur rendement sur leurs investissements en recherche et développement,
en facilitant l’entrée sur le marché des nouvelles technologies propres québécoises», ont conclu les deux
chercheurs de l’IRÉC.
(30)
Pour informations: André Laplante, Direction des communications de l’IRÉC, 514 278-4798 (cell.)
1
/
1
100%