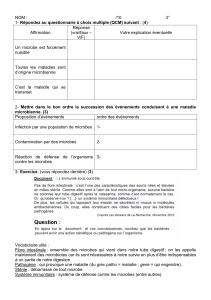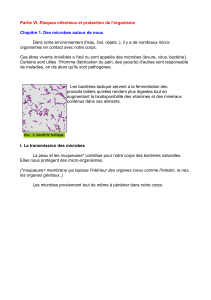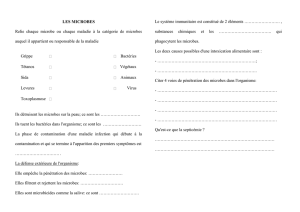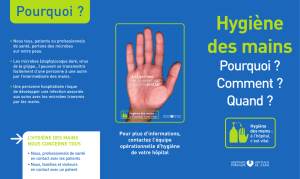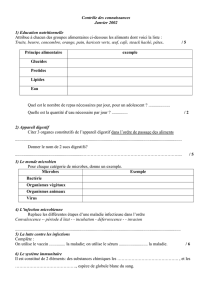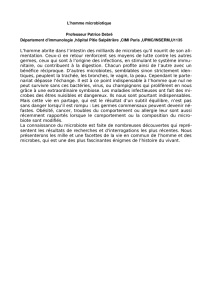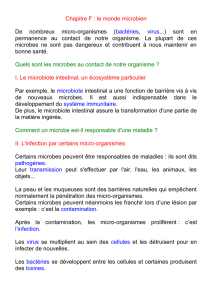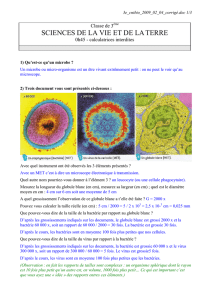dossier - Sens et Symboles

Dossier réalisé par Myriam Marino
22
23
dossier les microbes
● Les microbes : ces «ennemis» qui nous veulent du bien
•
24 ● Dr Olivier Soulier : «Les microbes nous ont fait naître et continuent de nous
•faire progresser»

dossier ●● les microbes
23
•
Les microbes
Ces «ennemis» qui nous
veulent du bien
S’il était besoin d’une preuve que l’on a souvent besoin de plus petit
que soi, comme le suggère si pertinemment Jean de la Fontaine dans
la fable «Le lion et le rat», les microbes que l’on s’évertue tant à vouloir
éradiquer, en sont une. Ils nous ont fait naître, nous constituent et
continuent de s’assurer que nous sommes bien vivants. À la découverte
de ce merveilleux monde de l’infiniment petit...
Ivan Wallin aurait pu faire l’objet de
notre rubrique «Savants maudits,
chercheurs exclus». Ce fou de bio-
logiste, (né en 1883 aux États-Unis et
mort en 1969), surnommé «l’homme
aux mitochondries», a osé dire en
1927, expériences à l’appui, que les
mitochondries (tout comme les chlo-
roblastes, nous verrons en détail en-
suite ce dont il s’agit précisément avec
le Dr Olivier Soulier) provenaient de
bactéries anciennes ayant établi une
relation symbiotique avec une autre
cellule hôte. Il a été le premier à sug-
gérer l’idée que la cellule eucaryote
était composée de micro-organismes.
Cette idée a été très importante en-
suite dans l’élaboration de l’hypothèse
de l’endosymbiose. Ivan Wallin a éga-
lement expliqué comment les bacté-
ries pouvaient représenter la première
cause de l’origine des espèces. Ainsi,
la création d’une espèce peut se pro-
duire par endosymbiose. Quel héré-
tique ce Wallin ! (c’est bien ce qu’on a
dit de lui alors...).
Il a en fait étendu les recherches d’un
autre fou : Konstantin S. Meresch-
kowski (1855-1921), botaniste russe, le
premier à formuler en 1910 les théo-
ries de l’endosymbiose. Il connaissait
le travail du botaniste français Andreas
Schimper (1856-1901,) qui avait ob-
servé en 1883 que la division des chlo-
roplastes dans les plantes vertes
ressemblait à ceux des cyanobactéries
autonomes, et qui avait lui-même pro-
posé à titre provisoire (dans une note)
que les plantes vertes ont surgi d’une
union symbiotique de deux orga-
nismes.
Pour Ivan Wallin, les mitochondries
ont aussi une origine endosymbio-
tique : il le décrivit en expliquant ses
théories et expériences à travers une
série de neuf articles.
Ces théories ont été reçues comme il
se doit par la communauté scienti-
fique en pareil cas, c’est-à-dire quand
elle n’est pas prête : rejet, ignorance,
voire moquerie. L’occasion pour nous
de convoquer une nouvelle fois Mar-
guerite Yourcenar : «c’est un tort que
d’abord raison trop tôt».
Chaque époque a son dogme. Tout le
monde, tout scientifique n’est pas un
Claude Bernard qui souligna si sage-
ment : «Quand le fait que l’on rencontre ne
s’accorde pas avec une théorie régnante, il faut
accepter le fait et abandonner la théorie»....
Le Pr Hans Ris (1914-2004) a relancé
cette théorie au début des années
1960. Ses études de la structure du
matériel génétique l’ont amené à être
le premier scientifique «moderne» à
documenter la similitude, voire l’iden-
tité, entre les nucléoïdes de cyanobac-
téries (les «plantes primitives»,
«cyanophycées, «cyanophytes» ou
«algues bleu-vert») et ceux des chloro-
plates des algues. La théorie endo-
symbiotique, selon laquelle les
cellules eucaryotes sont le résulta
d’une suite d’associations symbio-
tiques avec différents procaryotes, a
ensuite été formulée par la microbio-
logiste américaine Lynn Margulis
(1938-2011) dans les années 1960
aussi. Voilà. Et la communauté scien-
tifique semble plutôt y adhérer au-
jourd’hui. C’et un bon départ. Reste à
prendre vraiment conscience que ce
sont les bactéries qui nous ont fait naî-
tre et que nous continuons à avoir une
très grande intimité avec elles. Cela a
un sens en soi. Nous sommes consti-
tués de bactéries, et pourtant nous vi-
vons dans une ère de phobie totale
des microbes d’une manière générale,
microbes qu’il faut absolument éradi-
quer. Pourtant, ils ont un rôle, et non
des moindres, ainsi que nous allons
maintenant le découvrir... n

•••
24
dossier ●● les microbes, notre adversaire ontologique
•
Le Dr Olivier Soulier est médecin homéopathe. Il a beaucoup travaillé sur le rôle des
microbes, sujet d’un séminaire qu’il propose, dont le prochain aura lieu en juin. Il nous
explique l’importance de la rencontre des microbes dans notre constitution, puis comme
accompagnateur confrontateur « ami » tout au long de notre vie..
Interview
«Les microbes nous ont
fait naître et continuent
de nous faire progresser»
Olivier Soulier
On a assisté au XXe siècle à une véritable chasse aux
microbes qu’il fallait absolument éradiquer. Une asep-
tisation qui mène aux limites que l’on connaît au-
jourd’hui : la résistance bactérienne. Vous avez
beaucoup travaillé sur les microbes. Loin d’être les en-
nemis que l’on nous présente, vous nous dites au
contraire qu’ils sont nos alliés. Comment cela ?
Pour commencer, je rappellerai que les microbes sont inti-
mement liés à l’histoire du monde et à l’histoire de l’être
humain. Il y a trois types de microbes : les bactéries, les
virus et les parasites. Les bactéries ont été les premières
habitantes de notre terre et l’ont préparée pour que nous
puissions y vivre en créant l’oxygène et l’ozone, donc l’at-
mosphère.
Les microbes sont notre adversaire ontologique dans le
sens où ils nous confrontent à nous-même : c’est une no-
tion fondamentale. Ils nous ont fait naître et continuent de
nous tester pour garantir notre intégrité et notre croissance.
Ensuite, il est important de souligner que nous sommes ha-
bités de bactéries. Nous avons 1013 cellules dans notre
corps et 1014 bactéries rien que dans notre tube digestif.
Elles sont donc dix fois plus nombreuses que les cellules.
Enfin, 8% de notre ADN est d’origine microbienne, essen-
tiellement virale.
Vouloir éradiquer tous les microbes est donc un non-sens.
Certes, la découverte des agents microbiens par la méde-
cine moderne a permis de grandes avancées menant à des
actes et à des guérisons jusqu’alors impossibles, mais elle
rencontre aujourd’hui les limites que l’on connaît. L’anti-
biorésistance, effectivement : les bactéries résistantes aux
antibiotiques sont responsables de 25 000 morts par an au-
jourd’hui en Europe1, et 150 000 dans le monde2. Ce, avec
des microbes comme le staphylocoque doré autrefois tota-
lement banal ou le Klebsellia pneumoniae.
On assiste également à un phénomène de déplacement
vers de nouvelles maladies : dès lors qu’une maladie dis-
paraît, une autre apparaît à la place.
Enfin, la traque impitoyable aux bactéries a mené au fait
que plus vous stérilisez, plus vous générez des maladies,
des allergies, c’est ce que l’on appelle l’hypothèse hygié-
niste, émise depuis une vingtaine d’années. Nous sommes
dans une impasse ; je dirais plus précisément une impasse
biologique. À force de trop soigner, on rend plus les gens
malades.
L’exposition précoce aux microbes permet de forger notre
système immunitaire. L’arrivée des antibiotiques, puis
l’abus de leur utilisation, a créé non seulement des résis-
tances bactériennes, d’une part. L’utilisation systématique
des antibiotiques a, d’autre part, barré la route aux infec-
tions qui nous touchent de la petite enfance à l’âge adulte
et qui sont nécessaires à la constitution de notre immunité
et de notre personnalité ; cela a favorisé l’émergence de
nouvelles maladies comme l’asthme et les allergies qui tou-
chent maintenant 20% de la population et pourraient en
toucher 70% dans les années à venir, selon le Pr Vincent
Castronovo.
La meilleure immunisation possible, c’est l’enfant qui par-
tage sa glace avec le chien ou encore c’est la maman qui ra-
masse la tétine de bébé tombée à terre et qui l’essuie avec
sa main pour enlever les saletés et la lèche avant de
1 - http://www.ecdc.europea.eu/en/aboutus/organisation/Director%20Speeches/20120314_AMR_presentation_Copenhagen_EUpresidency.pdf
2 – http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/fr

•••
25
dossier ●● les microbes, notre adversaire ontologique
•
3 - Dont cette étude suédoise parue en 2013 dans Pediatrics : «Pacifier cleaning practices and risk ofallergy development», Bill Hesselmar et
al., 6 mai 2013, cette adresse : http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/04/30/peds.2012-3345
de la remettre dans la bouche de bébé. Plusieurs études ré-
centes ont démontré ce fait3.
Le sens des infections qui nous touchent de la petite en-
fance à l’âge adulte est en effet un point très important
sur lequel nous reviendrons plus tard. Avant cela, par-
tons à la découverte des microbes. On n’en a pas tou-
jours eu peur…
Microbios signifie «petite vie». Les microbes ont été long-
temps méconnus car on ne les voyait pas. Leur apparition
date du XVIIe siècle : ils ont été observés pour la première
fois grâce à l’invention du microscope par Antoine van
Leeuwenhoek (1632-1723).
Les grandes épidémies étaient vues comme des punitions
divines, des malédictions, mais les médecines anciennes
savaient soigner les maladies sans pour autant les com-
prendre. La maladie s’inscrivait dans un équilibre du
monde. L’acupuncture savait soigner les maladies il y a
4000 ans sans avoir besoin de connaître le rôle des mi-
crobes grâce à une compréhension globale de la vie très
nette. On peut se demander ici si ce n’est pas la présence
ancienne de la médecine traditionnelle chinoise et de l’acu-
puncture qui a permis à la Chine d’avoir, et de loin, la pre-
mière population mondiale. Les Chinois ont peut-être tout
simplement la première médecine.
Avec l’arrivée d’Hippocrate, nous sortons des superstitions :
la maladie n’est pas une punition infligée par les dieux,
mais plutôt la conséquence de facteurs environnementaux,
de l’alimentation et des habitudes de vie. Elle est donc en
lien avec la manière dont nous vivons.
Un autre tournant important apparaît au XVIIIe siècle avec
Samuel Hahnemann (1755-1843), inventeur de l’homéopa-
thie. Il n’est pas possible que Dieu avec sa sagesse n’ait pas
mis dans la nature à la fois le problème et sa solution,
pense-t-il. C’est dans l’état de la bonne santé que l’on va
trouver la manière de soigner.
C’est la célèbre phrase : «La maladie commence à l’instant où l’on
justifie par l’extérieur le malaise intérieur».
Il est intéressant de souligner que le premier à avancer
l’idée que «les semblables sont guéris par les semblables», avec
l’utilisation d’Arsenicum album, c’est Hippocrate. Ainsi, tous
les médecins qui ont prêté le serment d’Hippocrate sont
censés appliquer ce principe…
Au XIXe siècle, l’homéopathie soigne plusieurs maladies :
- Le typhus épidémique de 1813 : alors que le taux de mor-
talité par la médecine conventionnelle était de 30%, Samuel
Hahnemann est capable de traiter 180 cas avec seulement
2 décès quand l’épidémie arrive à Leipzig.
- Le choléra épidémique de 1830-1832 : quand il atteint
l’Europe, la mortalité, avec le traitement conventionnel, est
de 40 à 80%, variant selon les sources d’information. Hah-
nemann, de son côté, est capable d’identifier les
Une résistance bactérienne
mondiale
La résistance bactérienne est désormais une grave me-
nace pour la santé publique, souligne l’OMS qui vient
de sortir son premier rapport sur le sujet. Ce, dans le
monde entier. Dressant les données de114 pays, ce
rapport fait état de la présence d’une résistance aux
antibiotiques dans toutes les régions du monde. En Eu-
rope, le rapport relève que des niveaux élevés de ré-
sistance de Klebsellia pneumoniae aux
céphalosporines de troisième génération ont été
constatés dans l’ensemble de la région européenne de l’OMS. Dans certains lieux, jusqu’à 60% des in-
fections à Staphylococcus aureus sont résistantes à la méticilline (SARM), ce qui signifie que le traite-
ment par les antibiotiques classiques est inefficace.
Source : Antimicrobial resistance : global report on surveillance, avril 2014 (télécharger le rapport en
anglais : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/fr/
Vue microscopique de
Klebsellia pneumoniae
•••

stades de la maladie et de dire le remède adapté à chaque
stade.
- Les grippes graves, dont la fameuse grippe espagnole en
1918-1919 qui a tué entre 22 et 100 millions de personnes
dans le monde. Dean W. A. Pearson de Philadelphia rap-
porte 26 795 cas de grippe traités par des médecins homéo-
pathes : le taux de mortalité a été de 1,05% alors qu’il était
de 30% en médecine conventionnelle. Le Dr H. A. Roberts,
du Connecticut, rapporte de son côté les données de 30
praticiens, rassemblant 6 602 cas : 55 sont morts, ce qui
donne une mortalité inférieure à 1%.
L’homéopathie soigne aussi la fièvre jaune, la poliomyélite,
la diphtérie… Il existe des dizaines d’exemples.
L’homéopathie intègre le principe des microbes avec les
diathèses, qui sont au nombre de quatre : la psore, en lien
avec le processus de la gale, la sycose avec la gonococcie,
la luèse avec la syphilis, le tuberculinisme avec la tubercu-
lose. Les diathèses font le lien entre la physiologie d’un mi-
crobe et le mode réactionnel d’un individu. Par exemple, la
psore, dont le modèle est la gale, représente un principe
d’élimination centrifuge ; la luèse, en lien avec la syphilis,
nous parle d’une action de destruction psychologique et
biologique. D’autres homéopathes, comme Rajan Sanka-
ran, ont mis en place d’autres diathèses.
Je pense que l’on peut encore élargir ce système à une dia-
thèse par famille microbienne. Nous verrons cela avec la
bactérie Helicobacter pylori : on pourrait parler de la diathèse
ou du processus Helicobacter pylori.
En homéopathie toujours, les nosodes sont des remèdes
essentiellement fabriqués à partir de microbes. Le Dr Ed-
ward Bach (1886-1936), avant d’élaborer les Fleurs, a tra-
vaillé sur les microbes et a élaboré sept nosodes.
Et puis arrive Louis Pasteur (1822-1895), et c’est le grand
tournant : le microbe passe du stade d’agent à stade de res-
ponsable, oubliant au passage la grande phrase de Claude
Bernard : «Le microbe n’est rien, le terrain est tout». Même s’il se
rétracta durant les derniers jours de sa vie, confiant : «Bé-
champ avait raison, le microbe n’est rien, le terrain est tout», et ajou-
tant «C’est Claude qui a raison».
Le microbe, c’est le grand méchant qu’il faut éradiquer à
tout prix. On va tout guérir : c’est la grande découverte des
agents microbiens des maladies, ainsi que celle des anti-
biotiques et des vaccins glorieux. C’est la médecine mo-
derne avec les limites qu’elle rencontre aujourd’hui, nous
l’avons dit.
Le danger, et c’est ce qui se passe, c’est d’externaliser la
responsabilité : c’est la faute à l’autre, c’est la faute aux mi-
crobes.
Quand nous comprendrons que nous sommes des mi-
crobes et que nous sommes en lien permanent avec eux,
nous comprendrons comment ils viennent confronter nos
fragilités.
Pouvez-vous préciser votre propos ?
Nous sommes tous constitués de bactéries.
Le premier des microbes, c’est la bactérie. La terre a 4,9 mil-
liards d’années, les bactéries sont présentes depuis 4 mil-
liards d’années globalement. Elles ont créé l’atmosphère
terrestre en digérant les pierres et elles vont continuer à
évoluer.
La bactérie «primitive», c’est un brin d’ADN ou d’ARN dans
une membrane, mais elle n’a pas de noyau. Toutes les bac-
téries sont des procaryotes (avant le noyau). Elles vont en-
suite s’associer les unes aux autres pour créer les
eucaryotes par différents processus, dont l’endosymbiose.
C’est l’apparition des premières cellules et le début de la
vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Par exemple, les cellules humaines vont intégrer une bac-
térie qui va devenir la mitochondrie, l’usine à énergie de la
cellule ; les futures cellules végétales vont intégrer le chlo-
roplaste qui va fabriquer la chlorophylle. D’autres bactéries
comme les spirochètes vont constituer les canaux cellu-
laires. Et ainsi de suite dans une sorte de mécano.
Donc, les cellules sont une association de bactéries, cha-
cune apportant sa compétence. On peut dire que le maté-
riel cellulaire est au départ du matériel bactérien.
J’aurais tendance à dire que l’apparition du noyau, c’est
l’apparition de la possibilité de conscience.
Ensuite, nous allons passer à des organismes pluricellu-
laires, des organismes de plus en plus complexes jusqu’à
créer les premières formes de vie, les premières formes de
poissons, les reptiles, puis les mammifères, etc.
Ainsi, l’être humain est une bactérie qui a réussi. Nous
sommes tous des bactéries qui avons réussi.
Nous sortons de ce que la médecine appelle la soupe pri-
mitive (voir encadré page suivante), puis d’une
•••
•••
La mitochondrie, usine à énergie de la cellule
26
dossier ●● les microbes, notre adversaire ontologique
•
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%