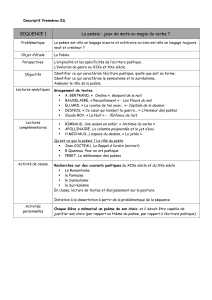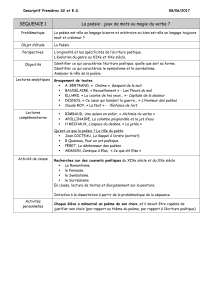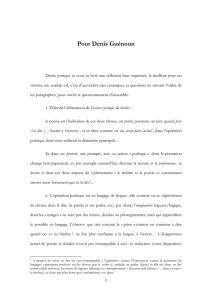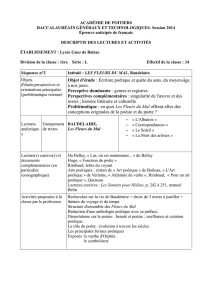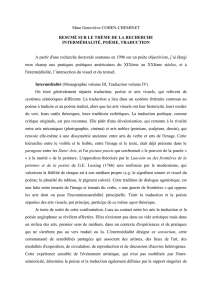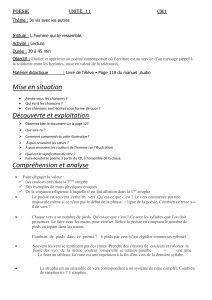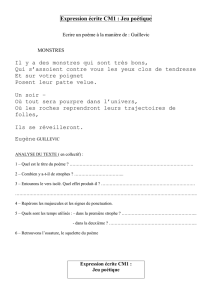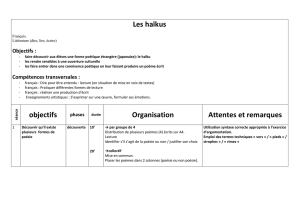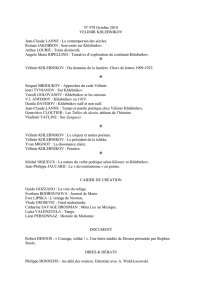Format PDF - Noesis

Noesis
7 | 2004
La philosophie du XXe siècle et le défi poétique
De l’athéisme poétique aujourd’hui
(Contingence, ironie et lyrisme)
Jean-Claude Pinson
Édition électronique
URL : http://noesis.revues.org/34
ISSN : 1773-0228
Éditeur
Centre de recherche d'histoire des idées
Édition imprimée
Date de publication : 15 mars 2004
ISSN : 1275-7691
Référence électronique
Jean-Claude Pinson, « De l’athéisme poétique aujourd’hui », Noesis [En ligne], 7 | 2004, mis en ligne le
15 mai 2005, consulté le 04 octobre 2016. URL : http://noesis.revues.org/34
Ce document a été généré automatiquement le 4 octobre 2016.
© Tous droits réservés

De l’athéisme poétique aujourd’hui
(Contingence, ironie et lyrisme)
Jean-Claude Pinson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Cet article a fait l’objet d’une publication antérieure, constituant un chapitre du livre
Sentimentale et Naïve, Nouveaux essais sur la poésie contemporaine (Seyssel, Champ Vallon,
2002). J’ai tenu compte, dans les notes, de la nouvelle traduction du Zibaldone de Leopardi
procurée récemment aux éditions Allia par Bertrand Schefer.
Dieu est mort ; mais tels sont les hommes qu’il y
aura peut-être encore
pendant des millénaires des cavernes dans
lesquelles on montrera son ombre...
Et nous..., il faut encore que nous vainquions son
ombre.
Nietzsche, Le Gai savoir, § 108.
1 Philosophie et poésie en Occident, sœurs jumelles et rivales dès l’origine, ont longtemps
partagé un même « instinct de ciel », un même désir d’absolu, de transcendance, de
supérieure musique. Pour l’une, ce désir a nom métaphysique. Pour l’autre, il prend la
forme du lyrisme, nom moderne pour l’idée de style « élevé » ou « inspiré ». Deux
modalités d’une même postulation, dont on ne peut se défaire comme on se débarrasse
d’une simple opinion, parce qu’aussi désœuvré, dépourvu de point d’appui et d’horizon,
que soit aujourd’hui ce désir, il demeure au moins comme élan intransitif.
2 Il semble pourtant qu’aux dix-neuvième et vingtième siècles, philosophie et poésie, au
regard de cette question de « ciel », aient connu des destins différents. La première, pour
l’essentiel, après avoir déboulonné le Dieu de la raison, n’a cessé, selon des modalités très
variées, d’approfondir son travail de déconstruction de la métaphysique. La seconde au
contraire, à partir des Romantiques de Iéna, s’est souvent vue reconnaître une aptitude
De l’athéisme poétique aujourd’hui
Noesis, 7 | 2005
1

spéciale à paître dans les alpages de l’Absolu. Elle s’est vue investie de la mission de
veiller sur l’Être même, mission qui faisait d’elle un substitut de la métaphysique défunte.
Si bien que la philosophie, pour se soustraire au positivisme et demeurer éveillée à une
pensée de ce qui vient excéder l’objectivité, a souvent choisi d’emboîter le pas au poème.
3 Toutefois (j’ouvre ici une parenthèse), il n’est pas impossible qu’il y ait eu là comme un
malentendu, négligeant par trop la différence des opérations linguistiques engagées par
l’une et par l’autre. La philosophie (une certaine philosophie romantique et post-
romantique) a cherché du côté de la poésie ce qu’elle ne pouvait y trouver qu’au prix
d’une vision fantasmée du poème1. Car si persiste le désir d’absolu de la poésie, il ne vise
pas (ou plus) l’Idée ou quelque Donation originaire, sauf à réduire ce désir à un signifié
programmatique qui n’est pas exactement l’affaire du poème. Dans ses opérations de
langage effectives, le poème vise plutôt ce qu’il est justement dans l’habitus même de la
philosophie de délaisser. Disons, pour faire vite, que la philosophie, sacrifiant la
contingence du sensible, cherche, au moyen du concept, le nécessaire et l’a priori, le vrai
en tant qu’il est susceptible de s’énoncer sous une forme universelle, ou encore le
primordial censé transir toute réalité. La poésie, au contraire, en son désir de présence
sensible, se tourne vers les réalités contingentes du monde, pour tenter – tâche
impossible – de les nommer avant que les mots (les concepts) n’en aient effacé les
couleurs vives. Le désir de présence, d’une présence « apothéosée » comme dirait
Baudelaire, se manifeste d’abord dans le poème comme désir de toucher, de rendre les
mots contigus aux choses, de les unir bord à bord2. Aussi la poésie, art du sens (Hegel),
mais d’un sens plus « tactile », plus « froissé », qu’idéel, critique-t-elle la philosophie, à
ses yeux trop pressée de s’enclore dans l’ordre conceptuel des raisons qu’elle construit.
Elle lui reproche de trop vite sacrifier, pour les besoins de thèses et systèmes (où pourrait
paraître, enfin sommé, récapitulé, quelque signifié transcendantal), la part fuyante,
nocturne et bigarrée d’un réel infiniment divers, que les mots, parce qu’ils sont tournés
vers l’universel, ne parviennent pas à éclairer. Tel est le sens, en tout cas, de la critique
qu’adresse Yves Bonnefoy à la philosophie de Hegel (et par-delà à la philosophie tout
entière).
4 Quoi qu’il en soit, après la « mort de Dieu », c’est bien la poésie
5 (la poésie et non le roman, notons-le) qui sert d’asile, au vingtième siècle (et d’abord au
dix-neuvième), à cette demande de divin dont a pu se nourrir la nostalgie métaphysique
qui sourdement continue de hanter la philosophie. Au désenchantement du monde
moderne et de la philosophie elle-même, la poésie a pu sembler pouvoir offrir la bouée de
secours de son propre Dieu. Qu’il suffise ici de rappeler le philosophème de Heidegger :
seul un Dieu – et il ne peut être que celui des poètes – pourrait désormais nous sauver.
6 Dans un texte récent, Alain Badiou a proposé une définition du type de rapport spécifique
qu’implique ce « Dieu des poètes », qui n’est ni le Dieu vivant des religions chrétiennes, ni
le Dieu-géomètre des philosophies classiques. Ni mort avec la foi comme le premier, ni
invalidé par la critique de la métaphysique comme le second, il s’est simplement retiré et
doit un jour faire retour. La tâche propre du poète, selon la lecture de Heidegger que fait
Alain Badiou, est alors de porter dans la langue la pensée de ce retrait et « de concevoir le
problème de son retour comme une incise ouverte dans ce dont la pensée est capable3 » .
Le rapport au Dieu poétique n’est donc ni un rapport de deuil, comme celui qu’implique le
Dieu mort des religions, ni un rapport critique, comme celui qui convient au Dieu-
Principe des métaphysiques, mais un rapport, au sens propre, nostalgique, rapport où
De l’athéisme poétique aujourd’hui
Noesis, 7 | 2005
2

s’envisage, dans la mélancolie, les chances d’un réenchantement du monde et d’un retour
du divin.
7 On reconnaît là, sans difficulté, toute la thématique romantique du kommende Gott, du
« Dieu à venir ». Que ce Dieu poétique soit encore un ressort décisif de quelques-unes des
poétiques majeures de notre temps, c’est ce que tendrait à démontrer sans doute l’œuvre
d’Yves Bonnefoy, auquel manifestement pense Badiou, même si jamais il ne le nomme.
8 L’auteur de Douve, pourtant, se déclare « athée » et sa poétique de la « présence », insiste,
contre la tentation de l’« excarnation », sur la considération de l’existence en sa
contingence. Mais l’horizon cosmo-théologique demeure : l’épiphanie de la présence est
ouverture à l’Un. Elle réfracte une lumière de « l’indéfait du monde » où peut se
redéployer le tissu invisible des correspondances par quoi le chaos du vécu est susceptible
de retrouver le sens secret d’une harmonie, d’un cosmos qu’il s’agirait par la poésie de
sauver de l’oubli, gardant la chance qu’il puisse un jour renaître, malgré les déchirures
qu’y a inscrites le nihilisme de l’ironie moderne.
9 L’athéisme d’Yves Bonnefoy n’est donc pas sans reste et le poète continue d’inscrire son
geste en direction d’un « Dieu qui n’est pas, mais qui sauve le don4 » ; « Dieu à naître qui
n’est personne, ne sera rien, brillant pourtant là-bas sur le toit transfiguré d’une grange,
ici dans quelques mots rédimés5 ». Dieu négatif donc, et comme tel proche sans doute du
Dieu-néant de la mystique apophatique6. Mais surtout Dieu plus « pratique » que
théorique – Dieu « poéthique », car indissociable de l’action (quelque restreinte soit-elle)
du poème gardant ouvert un autre horizon.
10 L’« athéisme contemporain » consistera au contraire, selon Alain Badiou, à en finir avec
ce « mouvement qui confie la relève du Dieu de la religion et du Dieu métaphysique au
Dieu du poème7 » . C’est lui, cet athéisme, qui est désormais « devant nous, comme une
tâche de la pensée ». Tâche aussi de la poésie – et d’autant plus qu’elle est l’abri où s’est
réfugiée la pulsion religieuse (unitive) de la pensée. D’où l’affirmation que « l’impératif du
poème est aujourd’hui de conquérir son propre athéisme, et donc de détruire de
l’intérieur des puissances de la langue la phraséologie nostalgique, la posture de la
promesse, ou la destination prophétique de l’Ouvert. Le poème n’a pas à être le gardien
mélancolique de la finitude, ni la découpe d’une mystique du silence, ni l’occupation d’un
improbable seuil8 ».
11 Cette conquête, qui est aussi bien la mise à mort par la poésie de son propre Dieu, est une
entreprise à laquelle, Badiou en convient volontiers, maints poètes s’emploient depuis au
moins le début du siècle. Dans la poésie contemporaine, elle me semble lisible selon deux
lignes de forces au moins. D’une part, dans la descendance du Baudelaire, balzacien, du
Spleen de Paris, comme inscription du poème dans l’horizon sans transcendance d’une
prose qui est intrinsèquement affirmation de la contingence radicale de toutes choses9.
D’autre part, dans la descendance du « matérialisme poétique » de Francis Ponge, comme
recherche d’un degré maximal de « littéralité ». Et souvent, dans quelques-unes des
œuvres aujourd’hui les plus intéressantes, ces deux lignes s’entrecroisent et se mêlent.
12 Cependant, cette conquête ne risque-t-elle pas d’être aussi synonyme d’une perte ? Ne
faut-il pas ici s’inquiéter, avec George Steiner, de ce que « lorsque la présence de Dieu est
devenue une supposition intenable, et lorsque Son absence ne représente plus un poids
que l’on ressent de manière bouleversante, certaines dimensions de la pensée et de la
créativité ne peuvent plus être atteintes10 » ? En d’autres termes, le risque de l’athéisme
poétique, effaçant le Dieu des poètes (c’est-à-dire un Dieu absent mais cependant
De l’athéisme poétique aujourd’hui
Noesis, 7 | 2005
3

continuant de peser sur le déploiement de la parole poétique), n’est-il pas de mettre fin,
en même temps qu’à l’illusion théologico-poétique, à la poésie comme « Grand Art » –
c’est-à-dire comme lyrisme, « haut » lyrisme ?
13 Car si le renoncement au Dieu poétique signifie aussi la mise à mal, dans le poème, de
toute cette opération d’apothéose en quoi, selon Baudelaire, consiste le lyrisme, ne s’en
déduit-il pas, pour la poésie moderne, une nécessaire aphonie, l’invalidation de toute
forme de « chant » et de voix lyrique ? La figure de Baudelaire devenu à Bruxelles
aphasique serait ainsi emblématique du destin obligé de la poésie (et plus généralement
de l’art). La césure de toute nostalgie du divin et de tout « appel en direction de ce qui
manque » impliquerait que l’art n’aurait aujourd’hui d’autre issue que dans ce qu’Adorno
nommait « l’extrémisme esthétique ». Il serait la seule « légitimation de l’art11 » – une
légitimation déceptive, aporétique, où le « Grand Art » ne pourrait que faire l’épreuve de
sa propre impossibilité (ou du moins ne pourrait s’assurer de lui-même qu’en se
renonçant). À l’époque de la modernité négative, la poésie n’aurait d’autre issue que
d’expérimenter sans fin la déconstruction « grammatique » du lyrisme.
14 En effet, le poète « athée », parce qu’il a renoncé à toute croyance romantique en un
prétendu pouvoir de la poésie à parler la langue des dieux ou des prophètes et à pouvoir
ainsi s’approcher davantage que les autres langages de la réalité vraie, n’est-il pas d’abord
un déconstructeur, un ironiste ? Un ironiste « linguistique » : c’est à même la langue qu’il
met en crise toutes les opérations verbales par lesquelles menace sans cesse de s’insinuer
dans les mots l’illusion théologico-poétique.
15 Mais s’il est ironiste jusqu’au bout, s’il est aussi (et comment peut-il ne pas l’être ?) un
ironiste « métalinguistique », un ironiste « philosophe », il ne peut pas ne pas « passe(r)
son temps, comme dit Rorty, à s’inquiéter de la possibilité qu’on l’ait [lui poète moderne]
initié dans la mauvaise tribu, qu’on lui ait appris à jouer le mauvais jeu de langage12 ». Il
ne peut pas ne pas s’interroger sur la contingence de tout langage et surtout il ne peut
sans barguigner faire crédit, sauf à tomber dans quelque illusion « linguistique », à la
croyance compensatoire qui dit, quand rien d’autre ne peut plus l’être, que la langue
seule est « salut13 » . Il se doit donc de renoncer, en même temps qu’à l’illusion théologico-
poétique, à l’idolâtrie « grammatique ».
16 Mais puisqu’il est poète – et pas seulement ironiste –, on suppose qu’il a à cœur la
recherche d’une intensité autre dans le langage. Ce pourquoi il ne peut être indifférent à
la question du lyrisme, entendu comme mouvement où se cherche dans le poème une
parole pleinement en acte, capable de se « hausser » jusqu’au « chant ».
17 Il demandera donc (première question) si n’est pas malgré tout possible quelque chose
comme un lyrisme qui ne soit pas théologicolyrique – i.e. un lyrisme qui, « ineffaçant »,
comme dit Michel Deguy, les « théologèmes défunts », puisse conserver l’élan de
l’opération « apothéosante », alors même qu’il a déposé le terme de l’« apothéose »,
renoncé à se tourner vers le focus imaginarius du Dieu poétique.
18 Il s’enquerra ensuite (seconde question) de déterminer, si la réponse est positive, comment
un tel lyrisme athée peut être possible; comment il peut être « césuré » sans du même
coup censurer toute mise en branle de ce « style élevé » par quoi il se définit. Ou encore :
comment, pour reprendre les termes de Hölderlin, la « sobriété junonienne », succédant
au « feu du ciel », peut être encore synonyme de lyrisme.
19 Qu’un lyrisme profane, un lyrisme athéologique soit possible, qu’il ne soit pas un cercle
carré, c’est évidemment d’abord au poème contemporain d’en administrer, par l’exemple
De l’athéisme poétique aujourd’hui
Noesis, 7 | 2005
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%