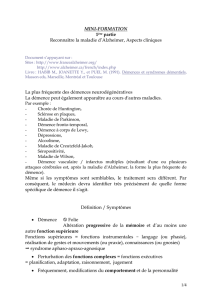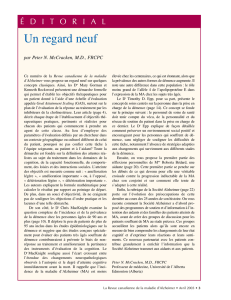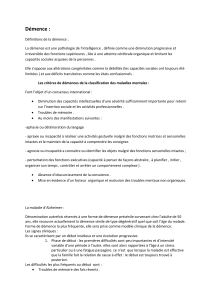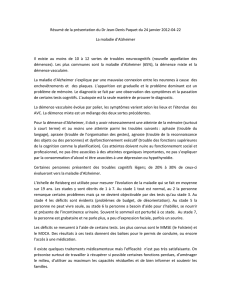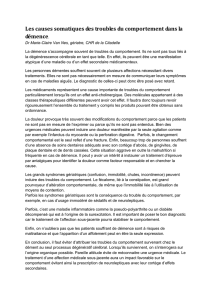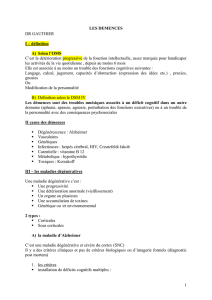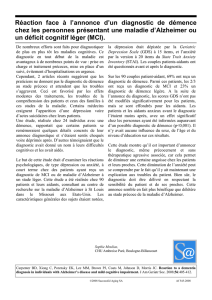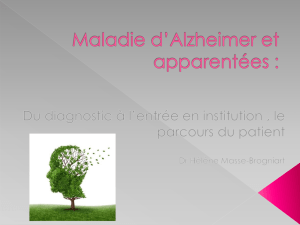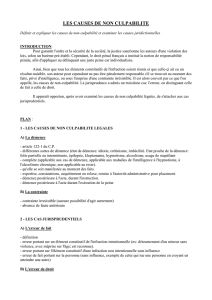Les maladies mémodégénératives et l`éthique

ÉTHIQUE
Neurologies • Mai 2011 • vol. 14 • numéro 138 309
Les maladies mémodégénératives
et l’éthique
Le poids des mots
n
Si la sémantique est indispensable à une bonne caractérisation des éléments, concepts,
idées, et à leur classement, sa simplification permet une meilleure compréhension pour les
non-initiés ; mémodégénératif évoque peut-être plus la mémoire pour le commun des mortels
que la neurodégénérescence.
Michel Davin*
DÉMENCE,
VOUS AVEZ DIT
DÉMENCE ?
Etymologiquement mens, terme
latin, signifie l’esprit, et demens,
l’esprit qui se délite, qui se dis-
sout.
La définition du Larousse est
celle d’un affaiblissement psy-
chique global et profond, en gé-
néral lent et progressif, frappant
l’individu dans toute sa person-
nalité, mais surtout dans ses fa-
cultés intellectuelles.
Esquirol disait : « le dément est
privé des biens dont il jouissait
autrefois, c’est un riche devenu
pauvre ; l’idiot a toujours été
dans l’infortune et la misère ».
Pour le psychiatre (P. Charazac),
« la démence est un groupe d’af-
fections dont l’unité se trouve
dans l’évolution (...). Le dément
est quelqu’un qui se trouve de
plus en plus privé des moyens
qu’il avait acquis, adulte, de
traiter ce qu’il y avait d’indési-
* Chef du Pôle gériatrie, Centre Hospitalier de Moulins
rable dans sa vie et d’y trouver
des satisfactions (...). Le rôle des
fonctions cognitives n’étant pas
de garantir la bonne qualité
d’une pensée mais de lui donner
le meilleur effet possible dans la
SIMPLE ADJECTIF OU
NOM DE MALADIE ?
Si la démence est devenue, pour
certains, un terme inacceptable,
honteux et insupportable, il reste
tolérable et toléré pour d’autres.
La démence est manifestement,
pour le grand public, ce qui se rapproche le plus
de la folie.
recherche d’une satisfaction li-
bidinale se conjuguant avec une
juste connaissance de la réalité ».
Quels sont les synonymes : alié-
nation mentale, folie ?
Alzheimer, un autre nom pour la
folie ?
La démence est manifestement,
pour le grand public, ce qui se
rapproche le plus de la folie ;
ne fait-on pas des crises de dé-
mence permettant de s’exonérer
de toute responsabilité en droit
commun ? Certains de nos pa-
tients nous disent, en expliquant
leurs difficultés : « je ne suis pas
fou ».
Faut-il un langage réservé aux
professionnels et un autre aux
profanes ?
Les associations de familles et de
malades sont très demandeuses
d’une réflexion globale sur la
qualification de la maladie, sa
prise en charge, sa reconnais-
sance, sa compréhension.
Le Anglo-saxons ont aussi ce
débat et, actuellement, ceux
qui défendent la digité des per-
sonnes atteintes de maladie
d’Alzheimer (des Américains,
Dr John Zeisel, par exemple, ou
Richard Taylor, psychologue at-
teint de la maladie) proposent
de remplacer le mot “dément”

310Neurologies • Mai 2011 • vol. 14 • numéro 138
ÉTHIQUE
non par “client” ou “patient”, ce
qui ne permettrait pas de carac-
térisation suffisante, mais plutôt
par l’expression « people living
with Alzheimers’ disease » .
Si l’on prend la définition médi-
cale du DSM-IV, manuel améri-
cain qui fait référence, on retient
que la démence est a priori un
processus incurable et définitif.
Le dément devient incapable
de s’adapter au situations nou-
velles : n’est-ce pas le cas de
certains artistes, d’hommes po-
litiques...
UN MOT SYNONYME
DE VIOLENCE,
DE SOUFFRANCE
La banalisation du terme “dé-
ment” rappelle celle de la vio-
lence et du spectaculaire, de tout
ce qui fait recette ; les journaux
écrits ou télévisés parlent sur-
tout des scandales, des crimes,
du sensationnel.
La démence reste véritable-
ment terrifiante pour les pa-
tients, les familles et même cer-
tains médecins, étant une source
de souffrance indicible ; pas seu-
lement par le caractère un peu
mystérieux de la maladie, mais
aussi pour le pronostic effroy-
able et par la connotation sociale
péjorative et destructurante.
Ne va-t-on pas leur mettre une
étoile jaune ou leur donner une
clochette, comme autrefois les
lépreux, pour mieux les repérer ?
Le respect ne doit-il pas rester
la valeur absolue dans une so-
ciété entièrement tournée vers
le politiquement correct et le
profit. Où se trouve le respect de
l’identité, de la dignité, de leurs
décisions, de leurs opinions, de
la souffrance intérieure inimagi-
nable de ces patients ?
Le terme de dément est un peu
synonyme d’inhumanité : « ce
n’est plus mon mari, ce n’est
plus un être humain, c’est un
dément » qui entre dans un pro-
cessus inexorable de disquali-
fication, de désintégration psy-
chique. Plus que le mot démence
utilisé, à la rigueur, nosologique-
ment par les professionnels, le
terme dément est une atteinte à
la dignité de l’Homme.
Qui peut supporter le désappren-
tissage progressif de l’être aimé,
cette évolution vers la déchéance
absolue, s’il n’est pas considéré
avant tout comme un malade ?
OÙ COMMENCE, OÙ
S’ARRÊTE LA DÉMENCE ?
Il semble que, quelle que soit la
gravité du diagnostic, très à la
mode de nos jours, il est à l’évi-
dence plus facile d’accepter ce-
lui de maladie d’Alzheimer, car
sant “grands déments” (quelques
mots de ceux qui ne parlaient
plus depuis des mois, une reprise
d’activité simple, dans le chant,
la musique…, un sourire chez
certains totalement inexpressifs
depuis si longtemps…).
Qu’y a-t-il de dément chez un
patient qui perd un peu la mé-
moire, qui a quelques difficultés
d’orientation dans le temps, qui
fait des erreurs dans ses comptes,
mais qui continue à peindre des
toiles, à jouer aux cartes, ou à rire
avec ses petits-enfants ?
Qu’y a-t-il dans leur regard, si-
non une détresse incommensu-
rable et/ou une anxiété infinie ?
Où est la démence dans tout
cela ? Où commence la dé-
mence, à quel chiffre du MMS ?
Dans notre société de mesures,
de tests, de records, de standar-
disation, de normalisation, qui
La banalisation du terme “dément” rappelle
celle de la violence et du spectaculaire.
il sous-entend celui de malade,
donc de reconnaissance d’un sta-
tut social, d’une prise en charge
et d’un traitement ; surtout pas
celui de DTA, démence de type
Alzheimer, sigle qui devrait être
amené à disparaître ou tout au
moins à changer de signification.
Dément est un mot barbare qui
nie toute la capacité restante du
patient : son affectivité majeure
qu’il ne peut pas exprimer, sa
spiritualité, toutes ses ressources
enfouies qui ne demandent qu’à
être stimulées ; et les équipes de
soignants le savent lorsqu’elles
obtiennent des résultats non pas
spectaculaires, mais tellement
enrichissants de la part de soi-di-
pourra dire à quel moment pré-
cis on bascule dans la démence ?
Cette société d’experts autopro-
clamés en tous genres, de sidéa-
nologues, d’alzheimérologues,
a-t-elle besoin en plus de dé-
mentologues ?
A partir de quand va-t-il être rejeté
par sa famille (la séparation d’avec
la famille est souvent un déchire-
ment pour cette dernière), ou par
la société qui en a peur ?
DES MALADES “COMME
LES AUTRES”
Non, ce ne sont pas des déments,
ce sont des malades comme les
autres, ce sont des déficients,

LES MALADIES MÉMODÉGÉNÉRATIVES ET L’ÉTHIQUE
Neurologies • Mai 2011 • vol. 14 • numéro 138 311
autrement atteints que les autres
patients car ils perdent tout dou-
cement, à petit feu, ce qui fait le
propre de l’homme : la pensée et
la parole.
N’a-t-on pas encore plus besoin
dans la vie d’intuition, d’amour
et d’inspiration que d’intelli-
gence ?
A-t-on encore le droit d’appe-
ler déments des patients qui
ont un affaiblissement, même
considérable, de leurs capacités
intellectuelles ; les grands car-
diaques sont des insuffisants
cardiaques ; les emphysémateux
des insuffisants respiratoires.
DÉFICIENCE SERAIT
PLUS JUSTE…
Comme le disait le Pr Desroue-
né dans un article sur alcool et
vieillissement : « la régression ou
la stabilisation des déficits co-
gnitifs après sevrage distinguent
Quant à moi, j’assume et je
signe : il n’y a pas de déments
dans mon service.
Nos patients ne seraient-ils pas
plutôt des insuffisants ou des
déficients cognitifs. Ne peut-on
pas leur redonner leur dignité en
bannissant à jamais ce terme de
démence, remplacé par celui de
déficience cognitive.
Il n’y aura plus une DTA signi-
fiant démence de type Alzhei-
mer, mais une “déficience de
type Alzheimer”.
Il faut reconnaître à chaque pa-
tient son statut, sa souffrance
dans la maladie, ce qui est es-
sentiel ; la déficience cognitive
sera quantifiable et traitable au
même titre que l’insuffisance
cardiaque.
De plus, la reconnaissance par
la médecine de ce statut de ma-
talier, on ne parle plus d’unités
Alzheimer, mais d’unités pro-
tégées avec des patients déso-
rientés et déambulants, terme
parfaitement adapté à la réalité
quotidienne et dénué de toute
connotation péjorative, évitant
de penser à un ghetto ou à une
discrimination.
EN CONCLUSION
La démarche éthique passe par
la considération et le respect
de l’autre, autant par le regard
qu’on lui jette, par l’expression
du visage (qu’y a-t-il de plus na-
turel qu’un sourire ?), par le ton
de la voix, que par la parole et
l’écriture, sans oublier le toucher
et la gestuelle.
Si la Morale représente le devoir
d’appliquer les Règles, définies
par la société et/ou la religion,
l’Ethique est un sentiment per-
sonnel, une intériorité profonde,
qui va nous permettre de mettre
en pratique notre intime convic-
tion et d’être en paix avec notre
Conscience et notre Moi inté-
rieur.
Rappelons-nous que les mots
ont un extraordinaire pouvoir de
construction de l’individu, mais
aussi de déconstruction, et que
la richesse de la langue française
nous permet et nous invite à uti-
liser, après l’ordre juste, le mot
juste. n
Le mot “démence” est un mot barbare,
qui nie toute la capacité restante
du patient.
nettement la démence alcoo-
lique des autres démences dégé-
nératives ou vasculaires (…) de
remplacer le terme de démence
alcoolique, à la fois trop restrictif
et trop ambigu, par celui de défi-
cit cognitif alcoolique ».
Il faut en fait aller beaucoup
plus loin et proposer la sup-
pression définitive d’un terme
beaucoup plus dévalorisant
qu’ambigu, utilisé à tort et à
travers par certains médecins
comme par les médias.
ladie permet à chacun de savoir
qu’il s’agit d’une pathologie
réelle du cerveau et non pas de
l’esprit : ce n’est pas une mala-
die mentale ; c’est une maladie
neurologique - au même titre
qu’une maladie de Parkinson,
par exemple - qu’on peut classer
dans le cadre de maladies neuro-
dégénératives.
Dans bon nombre d’établisse-
ments, dont certains hôpitaux
locaux par exemple qui sont à
la base de notre système hospi-
Mots-clés :
Maladie d’Alzheimer, Démence,
Déficience cognitive, Ethique,
Sémantique
1
/
3
100%