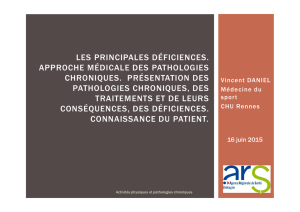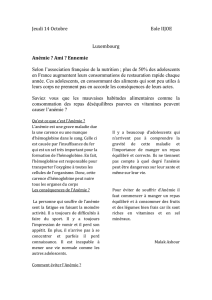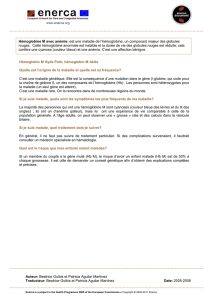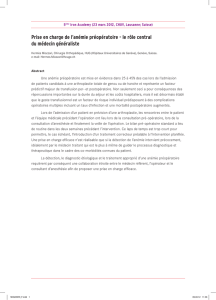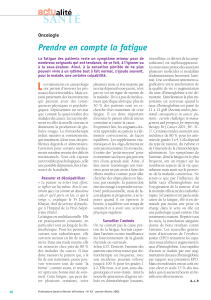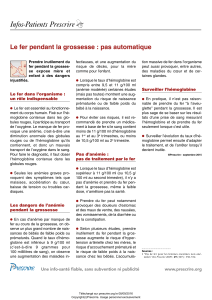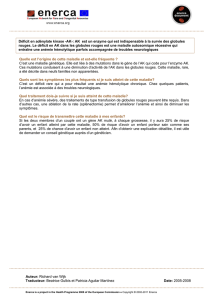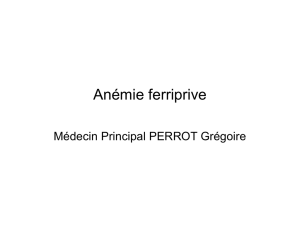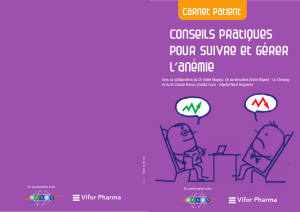Télécharger le document au format PDF

De manière générale, 50 à 60% des patients atteints de cancer pré-
sentent une anémie au cours de l’évolution de leur maladie, toutes
localisations confondues [9]. L’incidence de l’anémie dépend
essentiellement de la maladie, du stade, de l’âge du patient et de la
thérapeutique instituée [44].
Dans la pratique clinique courante, l’anémie est définie par une
hémoglobine inférieure à 11g/dl (échelle OMS) ou à 12g/dl (échel-
le EORTC).L’anémie sévère se définit par une hémoglobine infé-
rieure à 8g/dl [24].
L
’anémie semble être souvent sous-estimée. Ainsi ,dans une étude
européenne prospective l’ECAS (European Cancer Anaemia Sur-
vey ) [33] ,15367 patients cancéreux ont été évalués pour l’anémie
avec un suivi de six mois .On comptait environ 39% de patients
anémiques à la base et 67% au cours du suivi. Seulement près de
39% des patients étaient pris en charge pour leur anémie.
L’installation d’une anémie au cours de l’évolution d’un carcinome
prostatique est souvent multifactorielle. Si l’anémie dépend de la
thérapeutique instituée et de l’évolution de la maladie au cours du
temps, sa prévalence semble dépendre étroitement du stade tumo-
ral. DUNPHY amis en évidence une corrélation entre le stade tumo-
ral et la prévalence de l’anémie dans une série de 651 patients [20].
Si celle-ci n’est pas significative pour les stades localisés, elle
devient nette pour les tumeurs T4. Elle passe de 20% environ pour
les T0-T3 à 60% pour les T4.
Mais, dans ce contexte quel intérêt doit-on accorder à l’anémie
lorsque celle-ci est diagnostiquée ? A t-elle un impact pronostique
particulier ? Constitue t-elle un facteur prédictif de la réponse au trai-
tement ? Quel est par ailleurs l’intérêt d’une prise en charge spéci-
fique de l’anémie notamment dans les situations évoluées palliatives
?
LES DIFFERENTES SITUATIONS D’ANEMIE LORS D’UN
CANCER DE LA PROSTATE
Anémie et privation androgénique
L’hémoglobine moyenne est plus élevée chez les hommes que chez
les femmes .On s’accorde à retenir l’hypothèse d’une association
androgènes-érythropoïèse [5].
Des perturbations hématologiques liées à un blocage hormonal ont
été décrites quelque soit la modalité de ce blocage (castration chi-
rurgicale ou chimique). A l’inverse, les insuffisances rénales chro-
niques et les insuffisances médullaires étaient traitées à petites
doses d’androgènes avant l’avènement de l’érythropoïétine recom-
◆
MISE AU POINT Progrès en Urologie (2005), 15, 604-610
Anémie et cancer prostatique
Rania BOUSTANY (1),Marc ZERBIB (2)
(1) Département de Radiothérapie, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France, (2) Service d’Urologie, Hôpital Cochin, Paris, France
RESUME
Les perturbations des paramètres biologiques sont fréquentes au cours de l’évolution du cancer de la prostate.
L’anémie, souvent d’origine multifactorielle, s’installe progressivement et dépend essentiellement du stade de la
maladie et de la stratégie thérapeutique.
La privation androgénique est responsable d’une baisse de l’hémoglobine pouvant être sévère, notamment en cas
de blocage hormonal complet.
Al’heure où l’extension des indications du blocage hormonal en association avec la radiothérapie externe dans
les cancers localisés semble se confirmer, les effets secondaires à long terme devraient être plus étroitement sur-
veillés.
La radiothérapie externe est également responsable d’une baisse de l’hémoglobine. Celle-ci dépend de l’impor-
tance du champ d’irradiation et du volume de moelle osseuse inclus.
L’évolution des techniques d’irradiation devrait toutefois aller dans le sens d’une meilleure tolérance hématolo-
gique.
L’anémie affecte incontestablement la qualité de vie du patient. Elle semble également avoir un impact péjoratif
sur le contrôle local des maladies localisées traitées par radiothérapie externe.
Des indications de prise en chargeprécoce et préventive de l’anémie devraient être définies . De plus, dans la
mesure où le traitement de la maladie avancée repose sur le traitement symptomatique et l’amélioration de la
qualité de vie, la correction de l’anémie devra être également envisagée dans un contexte palliatif.
Mots clés : Anémie, cancer, prostate.
604
Manuscrit reçu : janvier 2005, accepté : juin 2005
Adresse pour correspondance : Dr. R.E. Boustany, Département de Radiothérapie, Institut
Gustave Roussy, 39, rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif.
e-mail : boustan[email protected]
Ref : BOUSTANY R.E., ZERBIB M. Prog. Urol., 2005, 15, 604-610

binante humaine [43].
D’après MODDER [36], la testostérone et la 5β-DHT stimuleraient la
production et la maturation des précurseurs érythroides dans des
modèles animaux .De plus, la testostérone et la 5α–DHT stimule-
raient en parallèle la production d’érythropoïétine.
Orchidectomie
En1949, HAMILTON avait décrit une baisse de l’hémoglobine chez
des personnes incarcérées ayant eu une orchidectomie. Cette baisse
était parallèle à la chute de testostérone mais était différée. Quaran-
tejours après l’intervention chirurgicale, le taux moyen de l’hémo-
globine était de 10g/l. Les globules rouges étaient diminués de 9%,
l’hématocrite de 6% et l’hémoglobine de 7% [26]. Cette observa-
tion a été confirmée par celle de FONSECA [23], qui a comparé les
taux d’hémoglobine pré et post opératoires chez 64 patients ayant
eu une orchidectomie bilatérale avec fonction rénale normale et a
décrit une baisse de 1-2g /dl de l’hémoglobine dans les suites chez
ces patients sans qu’un autre facteur intercurrent d’anémie ne soit
mis en évidence. Ce phénomène concerne également les autres for-
mes de castration.
Blocage hormonal androgénique
L’anémie induite par les agonistes de la LH-RH a fait l’objet d’une
évaluation, mais les études sont limitées aux patients suivis pour
une hyperplasie bénigne de la prostate.
En 1991, WEBER aobservé une baisse significative de 7.3% en
moyenne de l’hémoglobine, 6 mois après début d’un traitement par
agoniste de la LH-RH (nafarelin acétate) chez des patients traités
pour une hyperplasie bénigne de la prostate et a noté un retour aux
taux de base 6 mois après arrêt du traitement [52]. Les taux sériques
d’érythropoïétine étaient normaux. Les études in vitro sur des moel-
les osseuses humaines normales n’ont pas montré de toxicité parti-
culière des agonistes sur les cellules précurseurs de la lignée éry-
throide ou myéloïde, laissant suggérer une action androgénique
indirecte. La même observation a été faite par ERI [22] avec un trai-
tement par leuprolide acétate à la dose de 3.75mg/mois pendant 24
semaines, la baisse d’hémoglobine était significative par rapport au
bras placebo (baisse de 0.8g/dl ; p=0.0052).
Ce problème de toxicité hématologique devrait être reconsidéré à
l’heure où les agonistes sont utilisés dans les stades initiaux en néo
adjuvant avant radiothérapie externe ou en traitement adjuvant.
La monothérapie par anti androgènes non stéroïdiens ne semble pas
être associée à une anémie significative probablement en raison du
maintien de taux élevés de testostérone plasmatique. DECENSI [19]
n’a pas observé de baisse significative de l’hémoglobine chez 24
patients métastatiques traités par nilutamide. En revanche, l’étude
de ORNSTEIN [38] infirme ces données puisqu’une baisse significa-
tive de l’hémoglobine (en moyenne de 1,6g/dl) est rapportée dans
une série de 19 patients en échappement biologique après prosta-
tectomie radicale ou radiothérapie externe et traités à la fois par flu-
tamide 250mgx3/j et un inhibiteur de la 5α-réductase (finastéride
5mg/j) pendant au moins 6 mois. La baisse de l’hémoglobine dans
cette série n’était pas corrélée à la testostéronémie de base, ni à ces
variations. La contribution de chaque médicament à l’installation de
l’anémie n’a pu être évaluée.
Qu’en est-il du blocage androgénique complet
STRUM [47] a observé une baisse significative des taux d’hémoglo-
bine. Cent trente trois patients ont été traités par leuprolide acétate
(n=121/133) à la dose de 7.5mg IM 1x/mois et flutamide à la dose
de 250mgx3/j (n=116/133). Quatre vingt-treize patients avaient une
maladie localisée (22 T1c; 61 T2a-c et 10 T3a-c) et 40, une maladie
métastatique mesurable ou un échappement biologique avec éléva-
tion du PSA (2 D0 ,14 D1 et 24 D2). Certains patients avaient eu
une orchidectomie au préalable. La testostéronémie n’était pas cor-
rélée au taux d’hémoglobine dans la série étudiée. Un mois après
début du traitement, il était noté une baisse moyenne de 1g/dl du
taux d’hémoglobine. Après 5,6 mois de traitement, l’hémoglobine
moyenne était passée d‘un taux initial de 14.9g/dl à 12.3g/dl. La
toxicité a été plus importante et moins réversible chez les patients
âgés de plus de 68 ans, ayant reçu un traitement hormonal pour une
durée supérieure à un an. L’anémie observée par STRUM [47] dépas-
se de loin celle décrite plus haut par WEBER [52] et ERI[22].
L’effet semble donc être additif avec le blocage combiné. Il est
important de noter que 13% des patients avaient présenté une ané-
mie sévère avec une baisse d’hémoglobine supérieure à 25% (bais-
se de l’ordre de 4.3g/dl en moyenne). Dès lors, les auteurs recom-
mandent un contrôle de la numération formule sanguine tous les 1
à2mois après le début d’un traitement hormonal.
BOGDANOS [8] a évalué 42 patients (26 au stade C T3N0M0 et 16 au
stade D1 T3N1M0) ayant reçu un traitement hormonal combiné
associant leuprolide acétate 3.75mg IM /28 jours et flutamide
250mgx3/jour.Les paramètres hématologiques ont été mesurés à
l’état basal puis à 1, 2, 3 et 6 mois. La durée du traitement a été de
6mois.
Le taux d’hémoglobine moyen est passé de 14,2 g/dl à14 g/dl puis
à13,5 g/dl, 13,2g/dl et 12,7 g/dl à 1, 2,3 et 6 mois après initiation
du traitement. Six patients ont présenté une anémie importante qui
se traduisait par une hémoglobine inférieure à 11 g/dl (14.3%). Ces
mêmes patients ont répondu à un traitement par érythropoïétine
recombinante en 1mois (augmentation de l’hémoglobine supérieu-
re à 2g/dl).Une diminution de l’hémoglobine supérieure à 2.5 g/dl
au bout de 3 mois de traitement a été prédictive de l’installation
d’une anémie sévère avec un nadir inférieur à 11 g/dl. Dans la
mesure où cette anémie conditionne la qualité de vie des patients,
les auteurs recommandent un traitement par érythropoïétine recom-
binante humaine pour une durée d’un mois pour les patients ayant
présenté une baisse de l’hémoglobine supérieure à 2.5 g/dl après un
mois de l’initiation du traitement .
Al’heure actuelle où l’indication d’un blocage hormonal combiné
commence à s’étendre aux stades précoces de la maladie ou même
encore aux stades avancés en association à la radiothérapie, une
étiologie hormonale à l’installation d’une anémie ne doit pas être
écartée. L’équipe soignante devra ainsi être vigilante quant à la pres-
cription d’un traitement hormonal de longue durée et prévoir des
contrôles réguliers de la numération formule sanguine.
Anémie et chirurgie
La prostatectomie radicale peut s’accompagner de pertes sanguines
per opératoires nécessitant une transfusion.
Aussi, CHUN [16] a testé l’utilisation de l’érythropoïétine recombi-
nante humaine avant une chirurgie prostatique radicale. Cent quat-
re patients ont été inclus dans l’étude, 52 ont eu une autotransfusion
et les autres patients ont reçu des injections d’érythropoïétine à la
dose de 600UI/kg 14jours avant et même parfois également une
semaine avant le geste chirurgical. Les besoins transfusionnels hété-
rologues se sont avérés être les mêmes dans les 2 groupes (malgré
l’autotransfusion), concernant 9.6% des patients. L’utilisation d’é-
rythropoïétine semble donc être une alternative intéressante à l’au-
R.E. Boustany et M. Zerbib, Progrès en Urologie (2005), 15, 604-610
605

totransfusion.
L’étude de ROSENBLUM confirme ces constatations [41]. L’effet de
l’érythropoïétine administrée selon les mêmes modalités a été éva-
lué dans une étude prospective chez 305 patients présentant un can-
cer prostatique localisé et devant subir une prostatectomie radicale.
Une amélioration significative de l’hématocrite a été observée et
seulement 7% des patients ont eu besoin de transfusion. On notera
l’absence de bras contrôle, mais on rapportera dans la littérature un
taux de transfusion de l’ordre de 21% [53].
Anémie et radiothérapie pelvienne
De manière générale, 50% des patients atteints d’un cancer et trai-
tés par radiothérapie sont anémiques avant ou pendant le traitement
[21, 27].L’anémie dépend essentiellement de l’importance du
champ d’irradiation et du volume de moelle osseuse compris dans
ce champ.
Une étude effectuée au Beth Israel Medical Center /St Luke’s –Roo-
sevelt Hospital Center [27] a évalué la prévalence de l’anémie chez
574 patients traités par radiothérapie externe pour des cancers
variés. Concernant le cas particulier du carcinome prostatique
(n=90), 9% des patients étaient anémiques et 26% le sont devenus
en cours de traitement. Toutefois, il s’agissait souvent d’une anémie
modérée ne nécessitant pas une prise en charge particulière.
Mais que se passe-t- il lorsque la radiothérapie est associée à un blo-
cage hormonal ?
Tout comme pour l’essai du RTOG 8610 [39], l’essai de BOLLA
ayant inclus 415 patients [10] a montré un avantage en survie et un
meilleur contrôle local en faveur du bras associant la radiothérapie
àun traitement hormonal par rapport à une radiothérapie externe
seule. Une anémie sévère a été constatée dans 3% des cas dans le
bras combiné.
ASBELL [2] a observé l’installation d’une anémie chez 141 patients
dans une étude multicentrique. Ces patients ont eu un blocage hor-
monal combiné par flutamide (250mgx3/j p.o.) et goséréline
(3,6mg/mois) deux mois avant le début de la radiothérapie externe
pelvienne (65-70 Gy en 7-8 semaines). Le traitement a été poursui-
vi pendant toute la durée de l’irradiation. A quatre mois, une baisse
de l’hémoglobine supérieure ou égale à 2g/dl a été observée chez
81% des patients (baisse moyenne de 3.1 g/dl). Le taux d’hémoglo-
bine n’était pas corrélé au taux de PSA mais plutôt au taux sérique
de testostérone.
Anémie et chimiothérapie
Le rôle de la chimiothérapie et sa contribution dans l’apparition
d’une anémie ont été mal évalués. Si la mitoxantrone a longtemps
été utilisée après échappement hormonal, l’intérêt porté à la chi-
miothérapie vaen grandissant avec les réponses observées actuelle-
ment avec le docétaxel. On retiendra l’essai de phase III de
Tannouck [48] qui a inclus 1006 patients randomisés entre 3 bras,
le premier traité par mitoxantrone 12mg/m2toutes les trois semai-
nes, le deuxième traité par docétaxel 75mg/m2toutes les trois
semaines et le troisième par docetaxel hebdomadaire à la dose de
30mg/m2.Une anémie de grade III ou IV a été observée dans 5% des
cas dans le bras docetaxel et 2% des cas dans le bras mitoxantrone,
la différence n’étant pas significative. Toutefois on gardera à
l’esprit que les toxicités de ces chimiothérapies souvent adminis-
trées chez des patients fragilisés par de multiples traitements et pré-
sentant une maladie évoluée viendront s’ajouter à d’autres facteurs
d’anémie.
Anémie et maladie évoluée
D’origine multifactorielle, l’anémie peut résulter de différents fac-
teurs : de la maladie, de la thérapeutique adoptée ainsi que de fac-
teurs associés tels les infections, la carence nutritionnelle ou les
maladies chroniques sous-jacentes.
Ladurée de vie des hématies [1] est souvent diminuée probable-
ment sous l’influence des cytokines inflammatoires activées par la
tumeur. Il y aurait un effet de la tumeur sur la fonction médullaire
[45], la cinétique des hématies et leur métabolisme.
En l’absence d’une bonne compensation médullaire, l’anémie s’instal-
leinsidieusement. Il s’agit d’une anémie normo chrome normocytaire
ou microcytaire. Elle est parfois profonde et peut être plus ou moins
bien tolérée. La maturation des hématies se poursuit de façon normale
mais leur survie semble réduite.Au moment du diagnostic, 30% des
patients métastatiques au niveau osseux ont déjà une anémie avec une
hémoglobine inférieure à 12g/dl [1]. L’anémie sévère [7] est fréquente
et multifactorielle (chimiothérapie, radiothérapie, envahissement
médullaire ou hémolyse, traitement hormonal).
Malgré les efforts de dépistage [45] pour une détection précoce, le
diagnostic du cancer de la prostate se fait parfois à un stade métas-
tatique. Les localisations osseuses métastatiques siègent élective-
ment au niveau des corps vertébraux, du pelvis et des os longs sites
de production importants des hématies. Ainsi favorisent-elles l’ané-
mie. A l’envahissement médullaire, peuvent s’ajouter des facteurs
alimentaires ainsi que l’anorexie qui conduisent l’organisme à pui-
ser dans les réserves en fer [45].
Les patients métastatiques ont souvent une radiothérapie à visée
antalgique .Dans cette situation, l’antalgie est obtenue chez 77%
des patients pour une durée de 6 mois environ [4]. Les doses cumu-
latives liées aux irradiations successives de localisations multiples
concourent à l’installation de l’anémie.
L’irradiation corporelle totale ou hémi corporelle [42] en dose
unique présente un risque de complications sévères telles une pan
cytopénie ou une pneumopathie. La radiothérapie métabolique
comportant strontium ou samarium est indiquée pour les métastases
disséminées inaccessibles à un traitement localisé [12].L’améliora-
tion sur le plan antalgique concerne 50% des patients environ mais
la durée du bénéfice reste limitée et décevante. Les indications
d’une radiothérapie métabolique doivent être bien pesées en raison
de l’effet délétère sur les réserves médullaires qui risque de com-
promettre l’administration ultérieure d’une chimiothérapie.
IMPACT DE L’ANEMIE SUR LA QUALITE DE VIE, ET SUR
LE CONTROLE LOCAL ET A DISTANCE DE LA MALADIE
Symptomatologie et association anémie/qualité de vie
La sévérité des symptômes est conditionnée par la rapidité de l’ins-
tallation de l’anémie. Celle-ci dépend de la maladie, de la théra-
peutique instituée et de la fonction cardio-respiratoire du patient.
Outre la symptomatologie cardio-respiratoire qu’on connaît (dysp-
née d’effort, tachycardie, nausée, anorexie, vertiges, troubles de
mémoire, troubles cognitifs) [34], l’asthénie touche environ 78%
des patients [50].
Cette asthénie s’accompagne de nombreux symptômes et peut pren-
dre plusieurs aspects : apathie, découragement, indifférence,
dépression, anxiété, troubles du sommeil, faiblesse, et retentisse-
ment sur la vie quotidienne (travail, bien-être physique et psy-
chique) [50].
R.E. Boustany et M. Zerbib, Progrès en Urologie (2005), 15, 604-610
606

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’asthénie est un facteur
invalidant important (60%) affectant la vie de tous les jours loin devant
la nausée (22%) la dépression (10%) ou la douleur (6%) [18].
L
’asthénie n’est pourtant pas directement corrélée à l’anémie mais
reste un indicateur important. Par ailleurs, le taux d’hémoglobine
semble être corrélé à l’incidence de la fatigue et à la qualité de vie.
Ceci a été noté dans une étude portant sur 50 patients présentant des
tumeurs solides ou des hémopathies malignes. Les patients ané-
miques ayant une hémoglobine inférieure ou égale à 12 g/dl étaient
enplus mauvaise condition physique et avaient en général une qua-
lité de vie moins bonne que ceux qui avaient une hémoglobine supé-
rieure ou égale à 12 g/dl [15].
Une autre étude chez 4382 patients anémiques sous chimiothérapie a
trouvé une corrélation entre le taux d’hémoglobine et la qualité de vie,
celle-ci devenant optimale pour une hémoglobine entre 11-13 g/dl [17].
Parmi les échelles de mesure disponibles, deux méritent d’être men-
tionnés: le FACT-An questionnaire (functional assessment of cancer
therapy-anemia) [15] conçu pour les patients cancéreux anémiques
quelque soit la localisation du cancer et le FACT-F (échelle pour l’é-
valuation de la fatigue) sont des outils de mesure de plus en plus uti-
lisés et permettent une évaluation simple et rapide des situations
d’anémie.
L’importance de la qualité de vie dans les stades localisés aussi bien
que les stades évolués des cancers de la prostate est telle, qu’il est
important de l’évaluer et de prendre des mesures afin de l’amélio-
rer.
Anémie et réponse au traitement
L’activité anti tumorale de la radiothérapie repose sur l’interaction
des rayons avec l’oxygène, interaction conduisant à la formation de
radicaux libres. Le taux d’oxygène intra tumoral aurait un impact
sur l’effet anti tumoral et sur les lésions ADN radio induites [27].
Ainsi, l’anémie pourrait modifier l’efficacité d’un traitement par
radiothérapie comme le montrent plusieurs études réalisées dans le
cancer du col utérin et la sphère ORL, en occasionnant une diminu-
tion de l’oxygénation intra tumorale et en créant des conditions
d’hypoxie [3, 30].
La relation entre l’hémoglobine d’une part et l’hypoxie intra tumo-
rale et un pronostic péjoratif d’autre partaété documentée dans
plusieurs études où la pression partielle en oxygène (pO2) a été
mesurée dans le tissu tumoral. Dans les tumeurs prostatiques consi-
dérées habituellement comme non hypoxiques, les taux de pO2
étaient plus bas et de façon significative dans les tissus patholo-
giques par rapport au tissu prostatique adjacent normal ou aux mus-
cles environnants plus particulièrement chez les patients ayant un
stade avancé (T2/T3) ou les patients âgés (> 62ans) [37].
En réduisant l’oxygénation sanguine tissulaire, l’anémie peut indui-
re ou majorer une hypoxie tumorale et avoir une influence péjorati-
ve sur la radiothérapie pour diverses tumeurs même les petites qui
sont normalement non hypoxiques [21, 27]. En effet, pour l’obten-
tion du même effet thérapeutique, il est estimé que la dose d’irra-
diation en conditions d’hypoxie correspond au double ou même le
triple de celle requise dans un milieu normoxique [27]. L’hypoxie
peut également stimuler l’angiogenèse et favoriser le potentiel
métastatique.
Aussi, la correction de l’anémie avec obtention d’une oxygénation
tissulaire optimale peut avoir un effet favorable sur le contrôle loco-
régional et l’incidence des métastases à distance.
La plupart des études concerne les cancers de la sphère ORL et
associe l’anémie à un mauvais contrôle local. Mais, s’agit-il d’un
facteur péjoratif indépendant ou semble-t-il lié à l’évolution de la
maladie en rapport avec les caractéristiques propres de la tumeur ?
Il est en effet important dans ce contexte d’évaluer les patients en
fonction du stade qui constitue un facteur pronostique. Dunphy [20]
n’a pas montré d’association significative entre anémie et contrôle
local après ajustement au stade tumoral et au score histologique de
Gleason. Par contre MATZKIN [35] a isolé plusieurs facteurs péjora-
tifs influant sur la PFS lors de l’initiation d’un traitement par hor-
monothérapie : hémoglobine basse, VS élevée, élévation des
phosphatases alcalines, testostéronémie, PSA .Mais il s’agissait
d’une analyse uni variée qui ne permet pas de tirer des conclusions
(l’anémie reflétant possiblement le degré d’envahissement médul-
laire).
Anémie et survie
La plupart des études vont dans le sens d’une corrélation inverse
anémie et survie.
Ainsi, trois cent quarante huit patients présentant un carcinome pro-
statique hormono résistant) ont été évalués par VOLLMER [51]. L’hé-
moglobine sérique était associée à la mortalité liée à la maladie
(tout comme le poids et le PSA) même en analyse multi variée.
Par ailleurs, CARO[13] a repris 60 articles traitant de la survie des
patients corrélée à l’anémie et au taux d’hémoglobine et trouve une
augmentation de 47% du risque relatif de décès chez les patients
anémiques suivis pour carcinome prostatique.
Cette hypothèse est confirmée par celle de VAN BELLE [49] qui,
reprenant les données de la littérature, considère que l’anémie est
un facteur pronostique péjoratif dans le traitement des cancers
même s’il ne s’agit pas du facteur le plus important. L’hypoxie cel-
lulaire résultant de l’anémie est associée à une instabilité génétique
des cellules cancéreuses. De plus les conditions d’hypoxie sont sou-
vent associées à une résistance à la radiothérapie ou à la chimiothé-
rapie, un potentiel métastatique plus important, une diminution de
l’apoptose et une stimulation de l’angiogenèse.
Toutes ces données tendent à confirmer le rôle pronostique péjora-
tif de l’anémie sur la survie dans les carcinomes prostatiques. Seul,
DUNPHY n’a pas trouvé d’association significative anémie-mortali-
té après ajustement au stade tumoral et au score de Gleason [20].
PREVENTION ET CORRECTION DE L’ANEMIE
Si une prise en charge spécifique de l’anémie paraît ainsi indispen-
sable, l’équipe soignante a, à sa disposition, plusieurs outils qui per-
mettent de la corriger.
L’étape principale consiste à évaluer l’anémie d’après les paramèt-
res hématologiques, la symptomatologie physique et les indicateurs
de qualité de vie.L’évaluation devrait tenir compte des thérapeu-
tiques instituées et celles envisagées et porter sur la symptomatolo-
gie du patient qui affecte directement sa vie.
Par la suite, la correction de l’anémie devrait dépendre de la sévéri-
té des symptômes ressentis par le patient et comporter un traitement
parallèle spécifique des autres causes potentiellement impliquées
(déficit nutritionnel, infections) et des causes d’asthénie (troubles
électrolytiques, hypothyroïdie).
La transfusion reste indiquée pour la correction rapide des anémies
R.E. Boustany et M. Zerbib, Progrès en Urologie (2005), 15, 604-610
607

sévères .Elle est efficace pour tous les patients, mais le bénéfice
n’est que transitoire tant que persistent les causes, avec les risques
infectieux qu’on connaît et les effets indésirables dont on énumére-
ra certaines : réactions hémolytiques, surcharge circulatoire et sur-
charge en fer, allo immunisation. Elle n’est donc pas indiquée en
deçà de 6-7g /dl d’hémoglobine en l’absence de symptômes. Une
dépendance transfusionnelle peut également s’installer liée à l’état
demaladie chronique et de la productivité médullaire sub-optimale.
Erythropoiétine recombinante humaine (rHu epo) :
Les protéines epoetin alfa et beta et darbepoetin alfa miment le rôle
de l’érythropoïétine endogène et stimulent le développement des
cellules érythroides précurseurs.
La tolérance au traitement est bonne et l’érythropoïétine permet
d’augmenter les taux d’hémoglobine et de diminuer les besoins
transfusionnels (28, 32, 46) chez les patients ayant ou non une chi-
miothérapie même si celle-ci ne comporte pas des sels de platine.
Plusieurs études ont noté une amélioration de la qualité de vie [7]
avec l’utilisation de l’érythropoïétine.
Dans les carcinomes prostatiques, l’érythropoïétine [6] constitue
une alternative intéressante à la transfusion dans les stades avancés
hormono réfractaires.
Al’instar de BESHARA [6] qui a observé plusieurs réponses dans une
série limitée de patients métastatiques, BOGDANOS [7] a également
évalué l’intérêt de l’utilisation de l’erythropoïétine chez des
patients suivis pour un cancer prostatique hormono réfractaire,
métastatique au niveau osseux et présentant une anémie avérée. De
l’epoetin beta à la dose de 10.000UI x3/semaine a été administrée
en S/C avec supplémentation en fer et augmentation des doses au
besoin jusqu’à un maximum de 60.000 UI /semaine. Les patients
répondeurs (augmentation de l’hémoglobine supérieure ou égale à
12 g/dl sans transfusion) poursuivaient le traitement pendant 24
semaines à la dose de 10.000UI 1x/semaine. Les 29 patients éva-
luables ont eu une amélioration des paramètres hématologiques.
Une absence de besoin transfusionnel et une amélioration de la qua-
lité de vie évaluée selon le questionnaire EORTC QLQ-C 30 ont été
constatées .Les patients ont gardé une réponse malgré la dose d’en-
tretien réduite et une radiothérapie antalgique localisée ou métabo-
lique. Les taux sériques d’érythropoïétine n’étaient pas corrélés à la
réponse au traitement. L’essai multicentrique de JOHANSSON [31]
confirme également le bénéfice potentiel de ce traitement dans les
maladies avancées bien que les réponses observées soient moins
bonnes que celles décrites par BESHARA [6] et BOGDANOS [8] pro-
bablement en raison d’une dose d’administration plus réduite. En
revanche, l’étude confirme une amélioration significative de la qua-
lité de vie observée chez les patients bons répondeurs.
Le bénéfice de l’érythropoïétine a également été démontré chez les
patients non métastatiques au niveau osseux et traités par blocage
androgénique hormonal.
Dans l’étude de STRUM,l’anémie a été corrigée par l’administration
sous-cutanée d’érythropoïétine humaine recombinante humaine.
L’arrêt de l’hormonothérapie a également permis une régression
très lente de l’anémie qui pouvait durer près d’un an [47].
Une autre étude par BOGDANOS [8] confirme également l’efficacité
de l’érythropoïétine chez les patients ne présentant pas d’envahis-
sement osseux.
L’utilisation de l’érythropoïétine peut être discutée dans les cas sui-
vants [1] :
-maladie localisée avant le geste chirurgical pour réduire les
besoins transfusionnels
-patients anémiques avec stade avancé hormono réfractaires ou
métastatiques au niveau osseux :
Ladose peut être administrée une fois par semaine, ce qui peut
améliorer la compliance du malade [14].
-Le blocage hormonal intermittent [29] est une alternative intéres-
sante proposée pour prévenir et retarder le développement d’une
hormono dépendance. L’approche est faisable et permet de rédui-
re les effets secondaires potentiels (ostéoporose, perte osseuse et
musculaire, impuissance, bouffées de chaleur) [11,25].
Des essais prospectifs à grand effectif sont en cours pour évaluer le
bénéfice potentiel de ce type de traitement qui sans compromettre
l’efficacité, présenterait un meilleur profil de toxicité. Mais l’effet
précis du blocage intermittent sur l’anémie n’est pas encore correc-
tement évalué.
-Concernant le traitement par radiothérapie, plusieurs outils ont été
ou sont en cours d’évaluation [27] .Si les cytotoxiques pour sensi-
biliser les cellules hypoxiques à l’effet de la radiothérapie et l’oxy-
gène hyperbare ont été utilisés, l’intérêt pourrait également se diri-
ger vers l’utilisation de l’erythropoiétine.
-Compte-tenu de l’origine souvent multifactorielle de l’anémie, il
est important de souligner l’intérêt d’une supplémentation en fer
et vitamines en cas de carence avérée.
CONCLUSION
Cette revue de la littérature permet d’identifier les situations parti-
culières qui prédisposent à l’installation de l’anémie chez les
patients suivis pour un cancer prostatique.
S’il est admis que les androgènes stimulent l’érythropoïèse, le blo-
cage hormonal thérapeutique présente une toxicité hématologique
souvent méconnue qui ne doit pas être négligée. Ceci est particuliè-
rement vrai pour le blocage androgénique complet. Le blocage hor-
monal associé à une radiothérapie externe peut également avoir
également un effet délétère sur les réserves médullaires.
L’anémie dans le cancer prostatique avancé est souvent multifacto-
rielle .Si l’utilisation de l’érythropoïétine permet de corriger au
moins partiellement certaines situations d’anémie, il n’existe pas de
consensus clair concernant les indications. Celle-ci mérite d’être
évaluée notamment en périopératoire, avant une radiothérapie méta-
bolique, en association avec un double blocage androgénique ou
même dans un contexte palliatif.
Toutes ces études soulignent la nécessité d’une meilleure recon-
naissance des situations d’anémie, une évaluation du poids que cela
représente pour le patient et la compréhension des bénéfices des
thérapeutiques et de leurs limites.
REFERENCES
1. ALBERS P., HEICAPPEL R., SCHWAIBOLD H., WOLFF J.M. : Erythro-
poietin in Urologic Oncology .Eur. Urol., 2001 ; 39 : 1-8.
2. ASBELL S.O., LEON S.A., TESTER W.J., TESTER W.J., BRERETON
H.D., AGO C.T., ROTMAN M. : Development of anaemia and recovery in
prostate cancer patients treated with combined androgen blockade and radio-
therapy. Prostate, 1996 ; 29 : 243-248.
3. BECKER A., STADLER P., LAVEY R.S., HANGSEN G., KUHNT T., LAU-
TENSCHLAGER C., FELDMANN H.J., MOLLS M., DUNST J. : Severe ane-
mia is associated with poor tumor oxygenation in head and neack squamous cell
carcinomas. Int. J.Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2000 ; 46 : 459-466.
R.E. Boustany et M. Zerbib, Progrès en Urologie (2005), 15, 604-610
608
 6
6
 7
7
1
/
7
100%