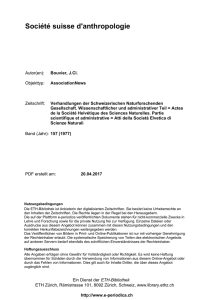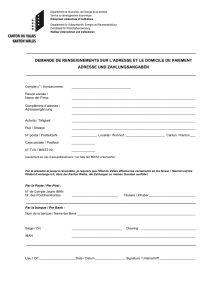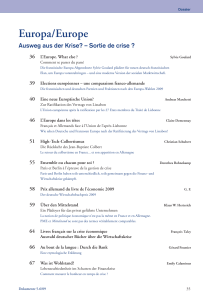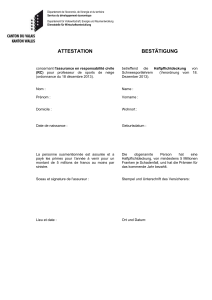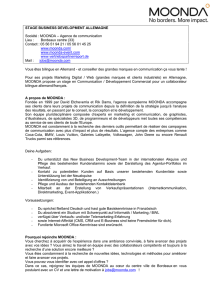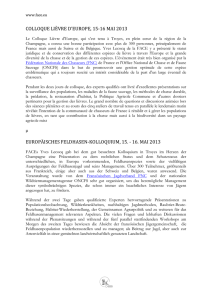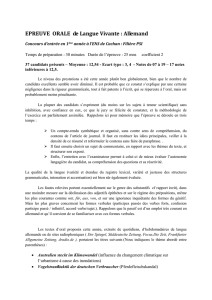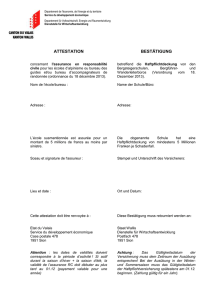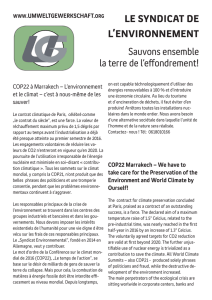Médecine et sciences humaines.

1
Médecine et sciences humaines.
Sciences humaines en médecine: formation et
collaboration
Colloque de printemps de l’Académie suisse des sciences
humaines et sociales
Lausanne, 4 et 5 mai 2006

2
Cette publication a été réalisée avec l’aide de:
Diese Publikation entstand unter Mithilfe von:
Nadja Birbaumer
Gabriela Indermühle
Delphine Quadri
Martine Stoffel
© 2006 Schweizerische Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften, Hirschengraben 11,
Postfach 8160, 3001 Bern
Tel. 031 313 14 40, Fax 031 313 14 50
sagw@sagw.ch
http://www.sagw.ch
ISBN 3-907835-54-9

3
Table des matières
Introduction
Anne-Claude Berthoud 5
Etat des lieux
L’enseignement des sciences humaines
et sociales en médecine: éléments pour
un panorama de la situation en France
Christian Bonah 9
Aspects institutionnels des sciences
humaines en médecine
Comment faire de la place pour les sciences
humaines en medecine? Expérience genevoise
Charles Bader 21
Sciences humaines, fondamentales en médecine
Fred Bosman 29
Expériences de l’interdisciplinarité:
enjeux épistémologiques
Production et usage des sciences
humaines en médecine
Vincent Barras 39
La médecine à l’épreuve du social
Ilario Rossi 47

4
Les sciences humaines au coeur de
la relation clinique et thérapeutique
Face à la fragmentation des savoirs
et des pratiques: l’apport de
l’anthropologie clinique
Nicolas Duruz 57
Das Arzt-Patienten-Verhältnis im Wandel
Peter Stulz 65
Les sciences humaines et les enjeux
contemporains de la santé
Understanding «access» to appropriate health
care: An anthropological view from
international health
Brigit Obrist 73
Perspectives et mise en oeuvre
Les sciences humaines au coeur de
la relation clinique et thérapeutique
Lazare Benaroyo 83
Les sciences humaines et les enjeux
contemporains de la santé
Raymond Massé 93
Biographies
Les auteurs 107
L’ASSH en bref 114
L’ASSM en bref 115

5
Introduction
Anne-Claude Berthoud
Le colloque de printemps «Médecine et sciences humaines.
Sciences humaines en médecine: formation et collaboration»,
organisé conjointement par l’Académie suisse des sciences
humaines (ASSH) et sociales et l’Académie suisse des sci-
ences médicales (ASSM), s’inscrit dans la continuité directe
du colloque d’automne 2004 «La médecine comme science
culturelle – les sciences culturelles de la médecine», qui a
posé un premier jalon vers un nouveau type de dialogue et
de collaboration entre ces deux champs scientifiques. Deux
champs scientifiques particulièrement sensibles et concernés
par les mutations profondes qui touchent notre société et les
nouvelles questions qui en émergent, et auxquelles nos deux
académies voudraient ici apporter une contribution originale,
sous le signe d’une nouvelle connivence au sein de la science,
pour engager un nouveau type de partenariat avec la société
et le monde de l’éducation, et de la formation universitaire en
particulier. Une façon pour nous de rendre hommage au nou-
veau pacte signé le 6 juillet 2006, visant à mieux définir la
place des Académies suisses des sciences au sein du champ de
la science et de la société. Un pacte qui invite les institutions
scientifiques à répondre à l’exigence ô combien paradoxale
de devoir s’adapter à l’évolution du contexte tout en restant
visionnaire. Des questions que les Académies doivent prendre
à bras le corps, en se situant tout à la fois avant, dans et après
le processus de recherche. «Avant» pour en saisir l’émergence,
«dans» pour l’accompagner, «après» pour en favoriser la
transmission.
Il n’est certainement pas un hasard que ce soit les Acadé-
mies de médecine et des sciences de l’homme qui en ouvrent la
voie. La médecine qui a institué la maladie comme objet de sci-
ence et d’applications technologiques les plus sophistiquées et
qui tente aujourd’hui d’en restaurer la dimension humaine, en
considérant le malade comme sujet de la prise en charge théra-
peutique, comme acteur social, avec les représentations qui y
sont associées, comme interlocuteur dans une nouvelle forme
de communication médecin-patient. Une façon de prêter à la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%