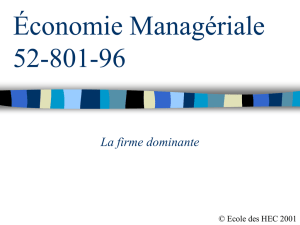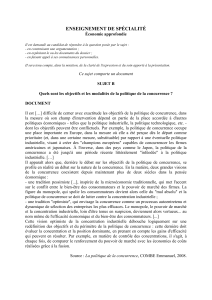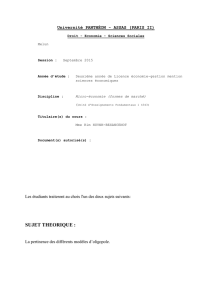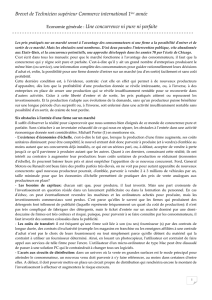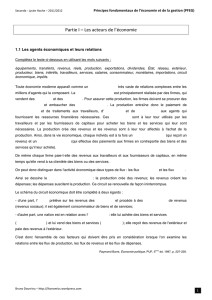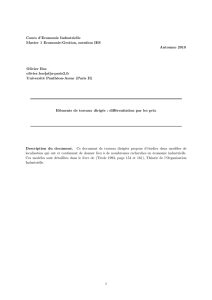La politique de la concurrence


Emmanuel Combe
La politique
de la concurrence
Éditions La Découverte
9bis, rue Abel-Hovelacque
75013 Paris

À Floriane et Aurélien…
Je remercie vivement Jérôme Gautié, Hervé Hamon, Thierry
Mayer, Annie Médina, Anne Méjane, Jean-Paul Piriou, ainsi que
les rapporteurs anonymes pour leur relecture attentive et leurs
remarques critiques. Je reste bien sûr seul responsable des éven-
tuelles erreurs qui pourraient subsister.
Catalogage Électre-Bibliographie
COMBE, Emmanuel
La politique de la concurrence. – Paris : La Découverte, 2002. – (Repères ; 339)
ISBN 2-7071-3703-0
Rameau : concurrence : politique gouvernementale : États-Unis
concurrence : politique gouvernementale : pays de
l’Union européenne
Dewey : 338.5 : Économie de la production. Organisation et éco-
nomie de la production. Microéconomie
Public concerné : 1er et 2ecycles
Le logo qui figure au dos de la couverture de ce livre mérite une explication. Son
objet est d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour l’avenir de l’écrit,
tout particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales, le déve-
loppement massif du photocopillage.
Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expres-
sément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or cette
pratique s’est généralisée dans les établissements d’enseignement supérieur, pro-
voquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même
pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est
aujourd’hui menacée.
Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, du présent
ouvrage est interdite sans autorisation de l’auteur, de son éditeur ou du Centre
français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins,
75006 Paris).
Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos parutions, il vous suffit
d’envoyer vos nom et adresse aux Éditions La Découverte, 9 bis, rue Abel-Hove-
lacque, 75013 Paris. Vous recevrez gratuitement notre bulletin trimestriel Àla
Découverte.
Éditions La Découverte & Syros, Paris, 2002.

Introduction
Le 18 mai 1998, le Département américain de la Justice et dix-
neuf États annoncent le dépôt d’une plainte pour pratiques anti-
concurrentielles à l’encontre de Microsoft, géant mondial de
l’industrie du logiciel : l’« affaire Microsoft » — qui suscite un
large intérêt dans l’opinion et dont les médias se font largement
l’écho — nous rappelle que les stratégies des firmes en éco-
nomie de marché sont encadrées par des règles de concurrence et
des autorités chargées de les mettre en œuvre.
Ces règles encadrant le jeu concurrentiel sont toutefois dif-
ficiles à établir, sans doute parce que la notion de concurrence
repose elle-même sur un paradoxe. En effet, on peut considérer
que la concurrence constitue un processus de sélection pouvant
conduire à l’élimination de concurrents, au profit des firmes les
plus efficaces : les règles de concurrence ne visent alors pas à
empêcher en tant que telle la disparition de concurrents mais
plutôt à contrôler les moyens utilisés par les firmes pour parvenir
à leurs fins. Il s’agit alors de déterminer à partir de quel moment
un comportement ne résulte plus du jeu « normal » de la concur-
rence et les controverses sur les pratiques utilisées par Microsoft
illustrent la difficulté d’un tel exercice.
Le présent ouvrage s’interroge précisément sur les fon-
dements économiques qui sous-tendent la politique de la concur-
rence ; il ne s’agit pas d’un ouvrage de droit de la concurrence,
ni d’une analyse institutionnelle du fonctionnement des autorités
antitrust. Nous mobilisons dans un premier temps les ins-
truments de la science économique (principalement l’économie
industrielle) pour comprendre les objectifs, les instruments et
3

l’efficacité de la politique de la concurrence, en prenant comme
exemples principaux la politique de la concurrence américaine,
européenne et française (chapitre I).
Un premier volet de la politique de la concurrence porte sur la
formation et l’exercice d’une position dominante. La question de
la formation d’une position dominante par alliance ou par
fusion-acquisition est développée dans le chapitre II :pourquoi
les autorités de concurrence exercent-elles un contrôle préventif
sur les opérations de concentration industrielle et selon quels
critères ? Lorsqu’une firme dispose d’une position dominante,
on peut craindre qu’elle n’en abuse : la politique de la concur-
rence vise à empêcher les comportements dits de « monopolisa-
tion d’un marché » (chapitre III):comment caractériser un abus
de position dominante et quels indices utiliser pour le détecter ?
Un second volet de la politique de la concurrence concerne la
coordination des comportements entre firmes, au travers des
accords horizontaux et verticaux. Les accords horizontaux peu-
vent avoir pour seul objet de restreindre la concurrence au détri-
ment des consommateurs (chapitre IV):comment les autorités
de concurrence parviennent-elles à détecter ces pratiques ?
Pourquoi les accords entre concurrents permettant de promou-
voir le progrès technique font-ils l’objet d’un traitement diffé-
rent ? De même, les « restrictions verticales », tels les accords de
franchise, exercent des effets ambigus sur la concurrence : à
quelles conditions ces accords verticaux sont-ils considérés
comme licites ? (chapitre V).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
1
/
129
100%