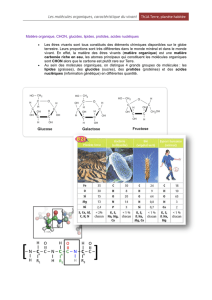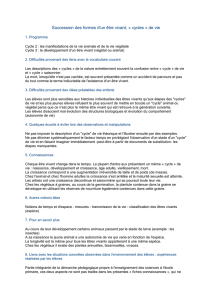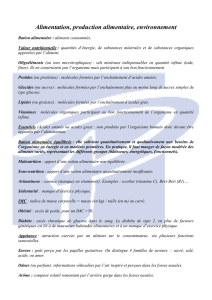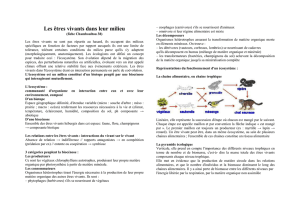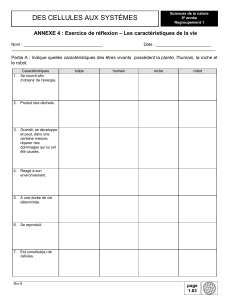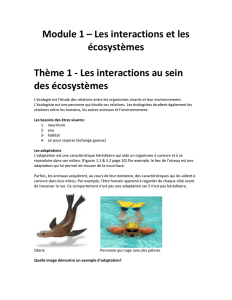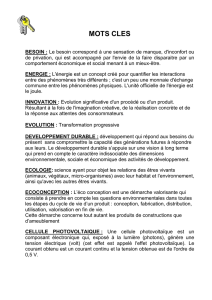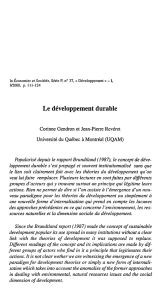environnement

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. LA NUTRITION DES VÉGÉTAUX VERTS
75
Introduction
L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est un domaine intégré
à la formation des élèves tout au long de leur scolarité, depuis l’école primaire. Elle les amène
à prendre conscience des questions environnementales, et elle leur montre la nécessité
d’adopter des comportements responsables. Les élèves sont particulièrement sensibles à
ces questions. Nous apporterons ici des connaissances scientifiques indispensables au futur
professeur des écoles pour aborder l’EEDD avec ses élèves.
Les connaissances acquises en histoire/géographie contribuent également à l’EEDD. En effet,
le croisement des regards disciplinaires est une caractéristique même de l’EEDD.
Nous commencerons par montrer les étroites relations existant entre les êtres vivants et
leur environnement. Pour cela, nous nous appuierons sur le thème de la nutrition : tous les
organismes quels qu’ils soient ont besoin de construire leur propre matière pour grandir et se
développer. Ils ont donc des besoins nutritifs, qu’ils peuvent satisfaire à partir des ressources
disponibles dans leur environnement.
La recherche de nourriture par les animaux implique également qu’ils soient capables de
se repérer dans leur milieu de vie, et de s’y déplacer. Nous étudierons donc comment les
organes des sens apportent des informations permettant aux animaux d’interagir avec
leur environnement, et nous présenterons les divers modes de déplacement dans le milieu
de vie.
Pour finir, nous illustrerons la fragilité de notre environnement en nous appuyant sur le thème
de l’eau.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
76
LA NUTRITION DES VÉGÉTAUX VERTS
La nutrition des végétaux verts
Les végétaux verts doivent leur coloration à un pigment présent dans leurs cellules. Ce pigment
est la chlorophylle (@GL.). On utilisera donc préférentiellement le terme de végétaux
chlorophylliens pour désigner les végétaux verts.
1.1. Les besoins nutritifs des végétaux chlorophylliens
1.1.1. Les substances indispensables à la nutrition des végétaux chloro-
phylliens
La croissance et le développement d’un organisme impliquent la production de
matière.
On appelle matière organique la matière produite par les êtres vivants. Elle est
composée de molécules organiques (@GL.) : les glucides, les lipides et les protides.
- les glucides sont les « sucres », au sens très large du terme : glucose, amidon, saccharose,
fructose, etc.
- les lipides sont les « graisses », au sens très large du terme : acides gras, triglycérides,
cholestérol, etc.
- les protides, dont font partie les protéines, sont des molécules aux rôles très variés dans les
cellules.
Les végétaux chlorophylliens ne prélèvent pas directement ces molécules
dans leur milieu de vie (contrairement aux animaux qui les trouvent dans les aliments qu’ils
consomment). Ils prélèvent seulement des substances minérales dans leur environnement :
- grâce aux racines, ils puisent l’eau et les sels minéraux (azote, potassium,...) du sol ;
- grâce aux feuilles, ils puisent le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique.
Les végétaux chlorophylliens doivent alors transformer ces substances minérales
en molécules organiques, pour subvenir à leurs besoins. Cette transformation s’opère au
niveau des feuilles.
1.1.2. Le transfert de l’eau et des sels minéraux vers les feuilles
L’eau et les sels minéraux sont transportés jusqu’aux feuilles grâce à la sève
brute (@GL.). La sève brute est un liquide formé au niveau des racines et distribué vers les
parties aériennes de la plante, composé principalement d’eau et de sels minéraux.
La circulation de la sève brute permet d’existence d’un véritable flux d’eau
traversant la plante, depuis les racines jusqu’aux feuilles. Une partie de cette eau sera d’ailleurs
perdue au niveau des feuilles et rejetée sous forme de vapeur dans l’environnement : ce
phénomène s’appelle la transpiration. Il est facilement observable en disposant un sac en
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA NUTRITION DES VÉGÉTAUX VERTS
77
plastique autour d’une plante verte : la vapeur d’eau transpirée se condense sur le plastique
et forme des gouttelettes.
1.2. La transformation des substances minérales en molécules organiques au
niveau des feuilles
1.2.1. Le processus impliqué
La transformation des substances minérales en molécules organiques au niveau
des feuilles ne s’effectue qu’en présence de lumière : cette dernière apporte en effet l’énergie
nécessaire aux réactions chimiques impliquées dans le processus. La chlorophylle est tout
aussi indispensable, puisque c’est elle qui est chargée de capter l’énergie lumineuse.
Cette fabrication (synthèse) de molécule organique à la lumière est appelée
photosynthèse. Elle produit aussi du dioxygène (O2) qui sera libéré dans l’environnement. On
peut résumer la photosynthèse de la façon suivante :
1.2.2. Quelques précisions
Remarque 1 - Comme la lumière est indispensable à l’obtention des molécules
organiques, on comprend pourquoi une plante verte privée de lumière meurt rapidement :
dans l’incapacité de fabriquer ces molécules indispensables, elle finit par mourir.
Remarque 2 - Le dioxygène libéré par photosynthèse pourra servir à la respiration
de la plante ou d’autres êtres vivants. Attention : il est important de noter que les végétaux
chlorophylliens respirent eux aussi !
Leur respiration a lieu en permanence (jour et nuit, donc aussi bien à la lumière qu’à
l’obscurité). Cependant, on ne peut mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires qu’à
l’obscurité : à la lumière, ils sont masqués par les échanges gazeux de la photosynthèse.
À l’obscurité, uniquement la respiration : la plante rejette du CO2 et consomme
de l’O2.
À la lumière, respiration et photosynthèse :
- la plante consomme beaucoup de CO2 pour la photosynthèse, ce qui masque les rejets de
CO2 de la respiration ;

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
78
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
- la plante rejette beaucoup d’O2 par photosynthèse, ce qui masque la consommation d’O2
pour la respiration.
1.3. Notion d’autotrophie et d’hétérotrophie
Le mode de nutrition des végétaux chlorophylliens est donc très différent du mode de
nutrition des animaux.
On utilise les termes d’autotrophie et d’hétérotrophie pour désigner ces deux modes
de nutrition.
Les végétaux chlorophylliens sont des organismes autotrophes (@GL.) : ils sont
capables de fabriquer leurs propres molécules organiques, à partir des substances minérales
puisées dans leur milieu de vie, grâce à la photosynthèse. Ces molécules organiques leur
serviront à construire leur propre matière organique (@GL.).
Les animaux (mais aussi les champignons) sont des organismes hétérotrophes
(@GL.) : ils se procurent les molécules organiques dont ils ont besoin en consommant la
matière organique d’autres êtres vivants. Ils fabriquent ensuite leur propre matière organique
à partir de ces molécules.
Nous avons défini ici l’autotrophie des végétaux chlorophylliens, en raisonnant à l’échelle
d’une plante entière. Ce n’est pas aussi simple lorsqu’on raisonne au niveau des différents
organes d’une plante.
En effet, les organes verts (contenant donc de la chlorophylle) peuvent réaliser la
photosynthèse et produire leurs molécules organiques. Mais les organes non-verts, comme
les racines, sont incapables de faire la photosynthèse. Les molécules organiques leur sont
apportées depuis les organes verts, grâce à la sève élaborée (@GL.). La sève élaborée est
un liquide contenant de l’eau et des molécules organiques produites au niveau des feuilles
et distribuées vers les autres organes. Les organes verts sont donc des organes autotrophes
alors que les organes non-verts sont des organes hétérotrophes.
Au moment de la germination, les végétaux chlorophylliens ont un mode de nutrition
hétérotrophe : la jeune plantule consomme les molécules organiques stockées dans la graine
par la plante mère, pour assurer sa croissance et son développement. Elle deviendra ensuite
autotrophe lorsque ses organes verts seront assez nombreux et développés pour assurer une
photosynthèse efficace.
(@AI. Nutrition des plantes ; @AI. QCU Nutrition végétale) N
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
2. LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS
79
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’étude des relations alimentaires (relations trophiques) entre les êtres vivants s’envisage à
l’échelle d’un écosystème (@GL.).
2.1. Qu’est-ce qu’un écosystème ?
2.1.1. Quelques définitions
On appelle écosystème un ensemble formé par :
- tous les êtres vivants du milieu étudié, et les relations qu’ils vont tisser les uns avec les
autres. Cette composante de l’écosystème est appelée la biocénose (@GL.) ;
- le milieu de vie de ces êtres vivants, et l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques
de ce milieu. Cette composante de l’écosystème est appelée le biotope (@GL.).
Les caractéristiques physico-chimiques d’un milieu de vie sont par exemple sa
luminosité, sa température moyenne, la qualité de l’eau... Tous ces facteurs non biologiques
sont qualifiés de « facteurs abiotiques ».
Les relations tissées entre les êtres vivants de l’écosystème sont qualifiées de
« facteurs biotiques ».
2.1.2. Les niveaux d’étude d’un écosystème
La notion d’écosystème peut s’envisager à différentes échelles :
- l’écosystème global (la Terre dans son ensemble) ;
- les grands écosystèmes (la forêt équatoriale, l’océan atlantique...) ;
- les écosystèmes plus réduits (un étang, une mare, une haie, une prairie...) ;
- les micro-écosystèmes (un tronc d’arbre, un mur...).

80
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS
Quelle que soit l’échelle considérée, il est toujours possible de définir le
biotope et d’étudier la biocénose : liste des espèces, adaptations de celles-ci, abondance des
populations de chaque espèce...
Ainsi, l’étude d’un écosystème revient à analyser :
- les éléments qui le constituent (éléments du biotope et de la biocénose) ;
- sa structure : la distribution spatiale de ses éléments ; la taille et les limites de cet
écosystème ;
- son peuplement : quantité de chaque type d’organisme peuplant l’écosystème ;
- son fonctionnement : interactions entre les divers éléments qui le composent.
Parmi ces interactions, on peut citer celles que nouent entre eux les êtres vivants
de l’écosystème. Ces relations sont essentiellement basées sur la nutrition.
2.2. Les relations alimentaires au sein d’un écosystème
2.2.1. Une organisation en chaînes alimentaires
Dans un écosystème, certains êtres vivants sont mangés par d’autres. Des êtres
vivants qui se nourrissent d’autres êtres vivants forment une chaîne alimentaire.
Chaque être vivant est un maillon de cette chaîne, ou « niveau trophique »
(@GL.).
Quelque soit la chaîne considérée, elle débute toujours par un organisme
autotrophe.
En effet, ces organismes sont capables de fabriquer leurs propres molécules
organiques et ne sont tributaires d’aucun autre organisme pour les produire.
Par contre, les maillons suivants sont composés d’organismes hétérotrophes : ils
consomment d’autres êtres vivants pour obtenir leurs molécules organiques, et les utilisent
ensuite pour fabriquer leur propre matière.
Ainsi, les organismes autotrophes sont les initiateurs d’un flux de molécules
organiques qui vont se transmettre tout le long de la chaîne alimentaire, de niveau trophique
en niveau trophique.
Pour cette raison, les organismes autotrophes sont qualifiés de producteurs
primaires.
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS
81
Légende :
Un maillon de la chaîne (niveau trophique)
« est mangé par »
Chêne (feuilles)
Un exemple de chaîne alimentaire
Les organismes hétérotrophes sont quant à eux qualifiés de consommateurs
(primaires, secondaires, tertiaires... selon leur place dans la chaîne alimentaire). Ils forment
une « chaîne de consommateurs ».
Les organismes hétérotrophes sont aussi des producteurs, puisqu’ils utilisent les
molécules organiques obtenues dans leurs aliments pour fabriquer leur propre matière.
On leur donne donc aussi le nom de producteur secondaire, tertiaire, quaternaire...
selon leur position dans la chaîne alimentaire.
2.2.2. Des connections entre les chaînes alimentaires
La litière (@GL.) du sol est composée de déchets et les cadavres de divers
êtres vivants (matière organique morte). Ces matériaux peuvent être consommés par des
organismes du sol comme certains vers et arthropodes. Ce sont des détritivores (@GL.). Ils
fournissent alors une matière organique résiduelle qui peut à son tour être consommée par
des organismes décomposeur (@GL.) : des champignons et des bactéries. L’action de ces
décomposeurs transforme la matière organique résiduelle en diverses substances minérales,
formant l’humus (@GL.) du sol.
Les détritivores et les décomposeurs sont des organismes hétérotrophes
qui forment de véritables chaînes alimentaires (chaînes de détritivores et décomposeurs).
Les différentes chaînes de consommateurs peuvent être connectées à ces chaînes de
décomposeurs-détritivores, puisque chaque niveau trophique d’une chaîne est susceptible
d’alimenter ces organismes du sol.

82
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS
De plus, les consommateurs d’une chaîne alimentaire ont souvent des régimes
alimentaires très variés : ils peuvent se nourrir de divers types d’êtres vivants.
Ainsi, un animal omnivore peut tantôt être un consommateur primaire lorsqu’il
mange des végétaux, tantôt consommateur secondaire ou tertiaire lorsqu’il utilise de la
nourriture animale.
Pour ces différentes raisons, les différentes chaînes alimentaires d’un écosystème
ne sont pas isolées les unes des autres : elles sont interconnectées, et forment de véritables
réseaux : les réseaux trophiques.
Remarque
Dans ces relations trophiques, nous pouvons aussi évoquer deux cas particuliers,
liés à des modes de vie singuliers : la symbiose et le parasitisme.
- La symbiose (@GL.) est une relation à bénéfice réciproque, et chaque espèce ne peut
vivre harmonieusement sans l’autre (Ex. : les lichens). Dans le cas des relations alimentaires,
l’un des partenaires (ou les deux) apporte à l’autre les éléments nutritifs dont il a besoin.
- Le parasitisme (@GL.) est le cas de figure où deux espèces sont intimement associées et
l’espèce parasite vit aux dépens de l’espèce hôte (gui, ténia, tique, sangsue, etc.). Dans le cas
des relations trophiques, le parasite prélève une partie des éléments nutritifs de l’autre, sans
aucune contrepartie : il se nourrit à ses dépends.
(@DOC. Une compétition pour la survie)
2.3. L’équilibre des écosystèmes
2.3.1. Une régulation du nombre d’individus
Dans un niveau trophique donné, une partie seulement des molécules organiques
consommées est réellement utilisée pour construire de la matière. Une partie de ces molécules
est en effet dégradée, et une autre partie est éliminée dans l’environnement. Donc seule une
petite portion des molécules organiques d’un niveau trophique sera utilisable pour le niveau
trophique suivant.
Ainsi, pour obtenir suffisamment de molécules organiques, les consommateurs
d’un niveau trophique doivent ingérer une plus grande quantité de matière que les
consommateurs du niveau précédent. Cela impose donc dans les écosystèmes des
consommateurs de moins en moins nombreux au fil des niveaux trophiques successifs.
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS
83
Par exemple, dans un étang, les algues chlorophylliennes microscopiques
(autotrophes) se comptent par milliards. Les protozoaires (animaux unicellulaires) qui s’en
nourrissent par millions. Les petits animaux qui s’en nourrissent atteignent la dizaine de
mille alors qu’il n’y a que des centaines de petits poissons. Les gros poissons se comptent
seulement par dizaines.
On peut représenter cette organisation des écosystèmes par des pyramides des
nombres. On superpose des rectangles de même hauteur dont la longueur est proportionnelle
au nombre d’individus à chaque niveau. Le nombre d’individus décroît généralement du
premier au dernier niveau.
On peut aussi utiliser une pyramide des biomasses. (@DOC. Exemples de
pyramides des biomasses)
La biomasse (@GL.) correspond à la quantité de matière présente dans
un niveau trophique (ou dans l’écosystème entier) à un moment donné. La pyramide des
biomasses indique donc pour chaque niveau trophique la quantité de matière présente. Elle
diminue de niveaux trophiques en niveaux trophiques, en relation avec la diminution du
nombre d’individus.
2.3.2. Le maintien de cet équilibre au cours du temps
Toute variation de production dans un niveau trophique a forcément des
répercutions dans les niveaux trophiques supérieurs.
Par exemple, une diminution du nombre de lièvres dans un écosystème aura pour
conséquence une diminution du nombre de renards dans ce même écosystème, puisqu’ils
auront moins de nourriture pour subvenir à leurs besoins.
En contrepartie, la diminution du nombre de renards favorisera ensuite
l’augmentation du nombre de lièvres car ces derniers auront moins de prédateurs.
Il se crée ainsi un équilibre dynamique entre les niveaux trophiques, qui permet
de maintenir l’équilibre de l’écosystème.
(@AI. Chaîne alimentaire ; @AI. QCU Chaîne alimentaire) N
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%