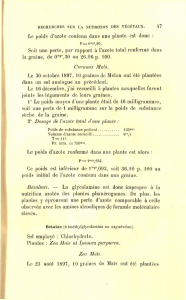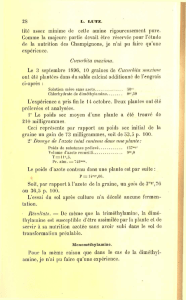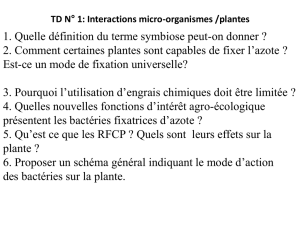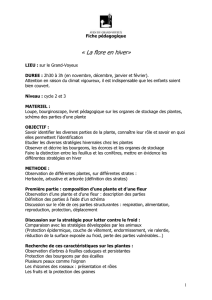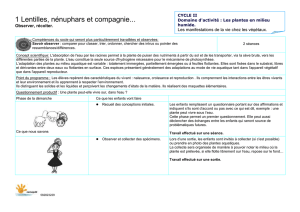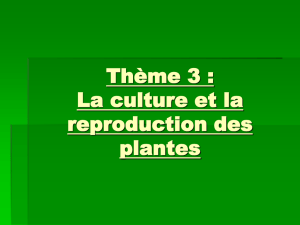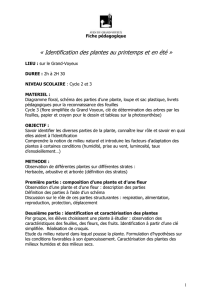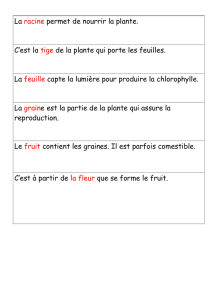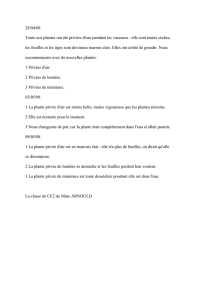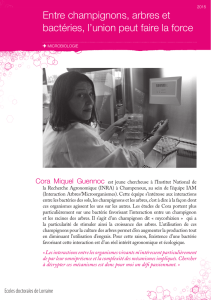Diversité des Interactions plantes-microorganismes

Par Krys3000 (Groupe « The Trust » - http://www.cours-en-ligne.tk/) Page 1
BIOLOGIE DES INTERACTIONS
CHAPITRE I : DIVERSITÉ DES INTERACTIONS PLANTES/MICROORGANISMES
Les interactions de types symbiotiques se retrouvent sous plusieurs types parfois difficile à différencier :
- Commensalisme : interaction unilatérale qui n’est pas négative pour l’espèce.
- Mutualisme : interaction à deux bénéficiaires. Dans le mutualisme, les deux organismes sont bénéficiaires mais pas
forcément en contact direct (roseau avec Beggiatoa, qui transforme le H
2
S en SO
4
2-
, libérant du peroxyde d’hydrogène
qui pourra être transformé en eau par la catalase de la plante). On distingue donc une catégorie de bactéries de classe
PGPB promouvant la poussée de la plante. D’autres encore favorisent le fitness de celle-ci en tuant par exemple les
autres bactéries.
- Pathogénie : interaction négative pour une espèce
Nous allons étudier les symbioses licheniques, les symbioses fixatrices d’azote, les mycorhizes, et les interactions pathogènes.
D’autres types d’interactions, souvent commensales, ont lieu entre les endophytes fongiques (champignons) et les plantes.
Parfois, ce type d’interaction n’est pas commensal, mais est mutualiste ou pathogénique.
Lorsque le rôle de l’interaction n’est pas nutritionnel, il peut être protecteur (Epipogium aphylum, orchidée non-
photosynthétique, survit à l’aide des arbres auxquels elle est reliée).
I – LES SYMBIOSES LICHENIQUES
Un lichen est une symbiose entre :
Un champignon mycobionte et une algue unicellulaire (exposée à l’oxygène)
Un champignon mycobionte et une cyanobactérie photobionte (dans une niche protectrice)
Un champignon mycobionte, une algue unicellulaire et une cyanobactérie photobionte. Dans de tels cas, on se retrouve
avec deux systèmes de carbone en même temps, la cyanobactérie formant alors des hétérocystes qui ne
photosynthétisent pas.
Ce mélange, permettant de photosynthétiser dans des conditions impossible, permet au lichen de survivre à des milieux
extrêmes. La colonisation est extracellulaire, le champignon contrôlant la multiplication du photobionte.
Les échanges entre les divers symbiontes passent par des hyphes spécialisés. L’algue fournit 90 % du CO
2
sous forme de polyols,
le champignon lui attaque le substrat et la roche pour récupérer les acides minéraux.
Deux types de reproduction des lichens :
- Asexuée par dissémination des sorédies ou isidies, propagules déjà différenciées en lichen le photobionte part avec.
Lorsque la bactérie se retrouve en carence d’azote, il y a synthèse d’HIF, qui déclenche la formation d’hormogonies très
mobiles, qui par chimioattraction, se dirigent vers le champignon et, à l’aide d’un signal émit au champignon, ouvrent
l’entrée dans l’hôte, avant de faire synthétiser l’HRF à l’aide d’un nouveau signal.
- Multiplication sexuée ou végétative du champignon seul
II – LES ASSOCIATIONS PLANTES/BACTÉRIES FIXATRICES D’AZOTE
La nitrogénase (Dinitrogénase + Dinitrogénase Réductase) est conservée chez les différents fixateurs d’azote. Les cyanobactéries
vivent en symbioses avec tous types de végétaux :
• Lichens
• Bryophytes
• Fougères flottantes (Azolla – reproduction synchrone avec la cyanobactérie nostoc qui vit dans une cavité de sa feuille)
• Angiospermes avec colonisation intracellulaire – formation de glandes symbiotiques immatures, qui deviennent
matures au contact de la bactérie, dont les hormogonies doivent pénétrer à l’intérieur de la glande, constituant ainsi un
niveau de spécificité supplémentaire.
• Gymnospermes, cycadales avec la encore des structures spéciales, les cycades colonisées par les bactéries, dans le
cortex.

Par Krys3000 (Groupe « The Trust » - http://www.cours-en-ligne.tk/) Page 2
Dans le cas de la symbiose entre Rhizobium et une légumineuse, la plante synthétise des flavonoïdes captés par les bactéries,
qui vont de ce fait exprimer le gène à l’origine du facteur Nod, un composé reconnu par une protéine de la membrane du poil
absorbant. Cela aboutit à la synthèse par la plante d’une nodosité, organe permettant de transformer le N
2
en NH
4
+
, et à
l’activation d’une voie de signalisation permettant l’infection via une spécificité très étroite. La coopération est donc parfaite,
mais la plante reste en contrôle car peut éjecter à tout moment les bactéries devenues inefficaces. Ces organes induits par la
bactérie sont composés de 4 zones :
1. Zone I méristématique sans bactéries
2. Zone II d’infection
3. Zone III de fixation, remplie de bactéries
4. Zone IV de sénescence où les bactéries sont sur le point de mourir ou sont mortes.
Outre les échanges trophiques d’azote (venant de la bactérie) contre du malate (venant de la plante), la colonisation confère
une meilleure protection aux stress biotiques et abiotiques : en effet, si elle est déjà infectée, la plante peut bloquer les attaques
des autres pathogènes. En contrepartie, la bactérie se maintient dans un milieu suffisant en oxygène à l’aide de la
leghémoglobine.
Chez certaines plantes ligneuses comme l’argousier, la bactérie Frankia induit des nodosités géantes partant du cortex interne
au lieu de la simple racine, ce qui nourrit beaucoup le sol en azote quand les feuilles tombent. Cette bactérie est incultivable
sans hôte, et là encore, c’est la plante qui dirige : lorsqu’il y a suffisamment d’azote dans le sol, on n’a pas besoin de beaucoup
de bactéries, donc envoi d’un facteur S1 de verrouillage. La plante effectue alors sa fixation d’azote, et quand elle est sure qu’il
n’y a aucun besoin d’infection, elle envoie le facteur S2 pour inhiber définitivement l’infection.
III – LES SYMBIOSES MYCORHIZIENNES
90 % des plantes sont mycorhizées, y’en a dans tout les écosystèmes. La spécificité, de ce fait, est beaucoup plus large. On
retrouve deux types de mycorhizes :
Endomycorhizes : A l’intérieur des cellules. Le champignon ne peut pas vivre sans arbre, il forme des spores en
attendant. 70 % des plantes non ligneuses sont concernées par ce genre de symbiose, dont la reproduction du
champignon est asexuée.
Ectomycorhizes : A l’extérieur des cellules. Apparues très longtemps après, chez les basidiomycètes essentiellement
mais parfois chez les ascomycètes comme les truffes. Ce genre de symbiose dispose d’un champignon qui se reproduit
sexuellement.
Les échanges entre ces deux symbiontes favorisent l’absorption des phosphates et des sources azotées, la tolérance aux stress,
et la résistance biotique. La plante fournit 20 à 40 % du carbone. Ils stabilisent également les sols.
IV – LES INTERACTIONS PATHOGÈNES
La spécificité parasitaire est généralement très élevée. Les interactions sont toutefois elles très diversifiées : on retrouve du
parasitisme facultatif et du parasitisme obligatoire, et plusieurs types d’installations :
- Epiphyte
- Intercellulaire
- Intracellulaire
Sans compter que les parasites peuvent être des bactéries, mais aussi des virus, des champignons, des nématodes… ou même
d’autres plantes !
On distingue deux classes de parasites :
Holoparasites qui n’ont aucune capacité chlorophyllienne, et sont obligés de parasiter.
Hémiparasites qui cherchent des composés azotés et des sels minéraux, s’accrochant aux racines (épirhize) ou à la
partie externe (épiphyte).
Il y a un échange de signaux entre le parasite et l’hôte : la plante envoie un signal indiquant au parasite qu’il doit former son
haustorium. La résistance d’une plante dépend du génotype des plantes.
1
/
2
100%