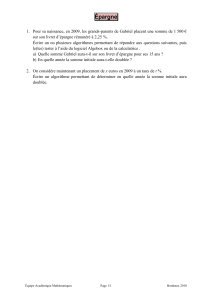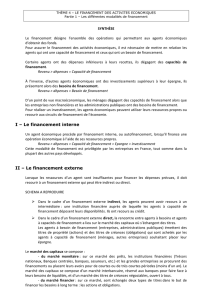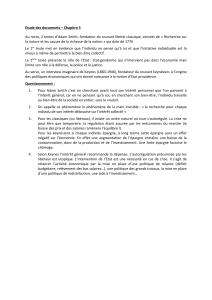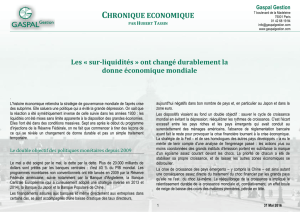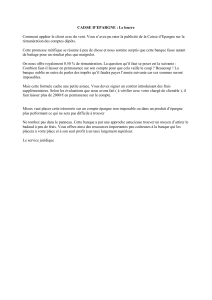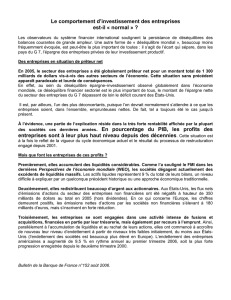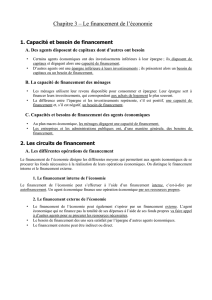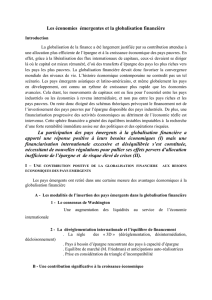on_comprend_mieux_le_monde_-_travers_l - prepa-bl

Lise Collomb
On comprend mieux le monde à travers l'économie, Patrick ARTUS et Marie-
Paule VIRARD (2008)
I. La globalisation et ses effets
1. Globalisation : le monde peut-il se refermer ?
Historique
Première manifestation de la globalisation : intégration des marchés de
produits, de capital et de travail en Méditerranée sous l'empire romain.
Au XV° siècle, avec les grandes découvertes, prémices de l'économie-
monde.
« Première mondialisation » de l'ère moderne : 1870-1914. Elle fut
transatlantique. Ouverture de routes maritimes (Suez, Panama),
extension du chemin de fer, flotte marchande x2, échanges x6,
migrations...
9 novembre 1989 : chute du Mur. Victoire du libéralisme. Le nombre
d'acteurs de l'économie de marché passe de 1 à 5 milliards d'individus.
Révolution des communications au XX° siècle.
Décembre 2001: entrée de la Chine à l'OMC.
Constat
Depuis une dizaine d'années, transfert d'activités productives vers les
pays émergents ; les grands pays développés perdent des emplois industriels
(zone euro : -8% depuis 1995, USA : -20%, GB : -25%) et des parts de
marché dans la bataille avec les pays émergents (exportations et importations)
dont la part des importations dans la demande intérieure des pays développés
ne cesse de progresser. D'où un fort impact sur l'emploi et la production en
Occident et la nécessité de repenser le modèle économique.
Sur le plan financier, baisse des prix des biens dont la croissance est la
plus rapide et des produits de consommation courante fabriqués dans les pays
émergents. Avec la mondialisation accélérée de l'épargne, cette désinflation a
provoqué la baisse des taux d'intérêt nominaux et réels.
Mais le niveau de vie global s'élève avec l'ouverture des échanges
internationaux, l'échange crée la croissance et favorise la division du travail
puisque les pays ont tendance à se spécialiser dans les domaines où ils ont un
avantage comparatif. L'intégration des marchés permet aux producteurs et aux
consommateurs de bénéficier d'économies d'échelle. La pression
concurrentielle accrue incite les producteurs à s'attaquer aux sources
d'inefficacité et à investir dans l'innovation, d'où la baisse des prix et
l'augmentation de la production et de l'emploi.

Quand la globalisation bouscule la hiérarchie des places
Entre pays émergents et pays développés : nouvelle division
internationale du travail, pour l'industrie comme pour les services. Dans la
zone OCDE, 20% des salariés réalisent des prestations qui peuvent être
délocalisées, 16% des travailleurs de l'industrie produisent des biens qui
pourraient être importés.
Entre citoyens du monde :
Gagnants : working rich de certains pays pauvres, entreprises
mondialisées, consommateurs.
Perdants : les plus pauvres des pays pauvres, bénéficiaires de l'Etat-
Providence, salariés peu qualifiés et « non protégés » des pays riches.
Vérité globale, mensonge local ?
Approche optimiste : la mondialisation comme un mouvement créateur
d'avantages et d'opportunités (accélération de l'innovation, création
d'entreprises et d'emplois), ne lésant pas les économies avancées (ex :
réussite industrielle de l'Allemagne qui a su se spécialiser efficacement).
Mais les effets de la mondialisation sont jugés de plus en plus
négativement par les Européens et les Américains (course aux bas salaires,
délocalisations, chômage).
Enjeux
Les facteurs qui ont, depuis le milieu des années 90, amorti le choc de la
globalisation pourraient progressivement disparaître :
« effets richesse » (hausse des bourses, de l'immobilier) : en
augmentant la valeur des patrimoines, ils ont permis un supplément de
dépense et d'endettement.
les déficits publics ont joué un rôle stabilisant pour la croissance dans les
pays développés.
les politiques monétaires accommodantes et l'abondance de la liquidité
mondiale ont favorisé l'endettement et la hausse du prix des actifs.
l'activité a été fortement stimulée par la construction de l'immobilier
résidentiel.
Les inégalités de revenus dans les pays développés risquent de
s'approfondir. Les créations d'emplois pourraient eux se polariser entre les
emplois très qualifiés d'un côté et les emploi peu ou pas qualifiés de l'autre.
Les pays émergents seraient en position d'acquérir de grandes firmes
occidentales pour optimiser l'utilisation de leurs énormes réserves d'épargne.
D'où un retour des tentations et tensions protectionnistes.
Mise en perspective historique :
Avant 1820, les économies émergentes (Asie) représentaient l'essentiel
du PIB mondial.
Entre 1820 et 1913, les pays avancés (Triade) ont repris l'avantage avant
d'imposer leur puissance économique dans la seconde moitié du XX°
siècle.
Aujourd'hui : nouveau « grand croisement » ? Selon les experts, ce
serait d'ici à 2025...

2. L'explosion des inégalités de revenus en France est-elle
inévitable ?
Les classes moyennes à la dérive, Louis Chauvel (2006) : tandis que
nous nous inquiétons de ses marges, c'est peut-être en son coeur que la
société française se désagrège.
Au XX° siècle (travaux de Th. Piketty)
Les inégalités de revenu se sont réduites en France, mais cette tendance
ne fut pas linéaire, variant selon les événements politiques mondiaux jusqu'à
1950 (guerres, inflation, crise de 29) puis français (augmentation de 1968 à
1968 puis baisse jusqu'à 1983 et augmentation légère ensuite).
Cette réduction tendancielle des inégalités tient pour l'essentiel aux
chocs subis par les très hauts revenus du capital (effondrement à la suite des
crises de 1914 à 1945), notamment à cause de l'impôt progressif sur la
reconstitution et l'accumulation des gros patrimoines et des périodes
d'inflation.
Mais l'inégalité des salaires est restée sensiblement la même et si le
pouvoir d'achat a été multiplié par 5, la hiérarchie n'a pas été bousculée. C'est
cette extraordinaire stabilité qui est remise en cause aujourd'hui.
Aujourd'hui (travaux de C. Landais)
La dernière décennie est marquée par un approfondissement des
inégalités de revenus en France comme dans la plupart des pays développés,
confirmant un mouvement déjà amorcé aux USA au cours des 40 dernières
années (cf The Conscience of a Liberal de Paul Krugman sur la « révolution
inégalitaire » américaine) et de plus en plus virulent au Japon.
Depuis 8 ans, les inégalités de revenus s'accroissent fortement en France
: les revenus des Français les plus riches explosent, tandis que les bas et
moyens revenus augmentent très modestement.
Le temps des working rich
C'est avant tout la très rapide augmentation des inégalités de salaires qui
explique l'explosion des écarts. Partout l'écart se creuse entre une sorte
d'hyperclasse mondialisée et la grande masse des salariés : aux USA le salaire
des dirigeants est passé de 30 fois le salaire moyen en 1980 à 180 fois en
2005. En France, les working rich supplantent désormais les rentiers. Parmi le
top 20 des dirigeants européens les mieux payés en 2005, 10 étaient français.
Les rémunérations des opérateurs de marché et traders ont littéralement
explosé.
Cette explosion des inégalités est désormais une caractéristique des
économies développées pour les hauts salaires, mais aussi pour l'ensemble de
la hiérarchie des salaires. Deux explications sont privilégiées : la globalisation
et le progrès technique.
La classe moyenne au purgatoire
Double mouvement dans nos pays :
hausse du salaire relatif des plus qualifiés par rapport aux qualifications
intermédiaires

resserrement de la hiérarchie des salaires entre les moins qualifiés et les
moyennement qualifiés.
Les effets de la globalisation et progrès technique s'additionnent le plus
souvent pour creuser les écarts de rémunération dans nos pays. On observe
aussi une forte progression de certains revenus (salarié très qualifié d'une
grande entreprise opérant dans un secteur favorisé par la mondialisation) et
l'écrasement de la hiérarchie des revenus entre les salariés moyennement et
peu qualifiés qui sont tirés vers le bas.
La France au modèle anglo-saxon ?
La question des inégalités n'est pas seulement un problème politique et
social mais aussi économique, comme semble le suggérer l'exemple anglais.
Lorsqu'une minorité riche détient une partie importante du revenu et de
la richesse nationale, sa consommation d'actifs, de biens et de services est peu
sensible au niveau des prix ou des taux d'intérêt (élasticité faible). La
consommation continue donc à augmenter, même lorsque les autorités
monétaires augmentent les taux d'intérêt. Ce fut le cas en GB.
Comment alors contrôler une économie par la politique monétaire dès
lors que la hausse des taux d'intérêt a peu d'effet sur l'endettement et la
demande d'une partie certes minoritaire mais agissante des ménages?
En France, la tendance à la très forte hausse des revenus les plus élevés
se poursuit, tout comme les revenus du patrimoine. La fiscalité évolue
clairement dans le sens de l'approfondissement des inégalités au niveau du
revenu disponible des ménages (bouclier fiscal à 50%, forte baisse des droits
de succession sur les hauts patrimoines).
Enjeux
Lutter contre les inégalités, c'est poser la question des politiques
redistributives, donc du mélange optimal entre équité et efficacité. Les Anglo-
Saxons laissent pour l'essentiel au marché le soin de se charger des inégalités
de revenus, même si a été créé aux USA l'Earned Income Tax Credit (crédit
d'impôt réservé aux foyers les plus modestes dans lequel au moins une des
personnes travaille et donnant lieu à une réduction d'impôts ou à un versement
direct aux ménages) pour lutter contre la pauvreté sans exposer l'économie
aux effets indésirables des systèmes de revenu minimum.
En France, le modèle est loin d'être optimal car il fait prendre en charge
aux entreprises une grande partie de la redistribution (salaire minimum élevé).
La redistribution par les bas salaires détruit des emplois peu qualifiés et
fabrique en réalité de plus en plus de précarité.
Il faut doser la pression fiscale et éviter le plus possible de taxer le
travail. L'Allemagne, le Japon et la Suède montrent qu'il est possible de
sauvegarder et de développer des activités industrielles compétitives, ce qui
permet de soutenir emplois et niveaux de salaires dans tous les secteurs. Une
sophistication croissante des secteurs protégés favorise aussi une meilleure
rémunération.

3. Comment partager les ressources rares ?
L'accélération de la croissance mondiale depuis 2003 a entraîné celle de
la consommation de matières premières. En Chine la consommation de pétrole
augmente de 10% par an.
L'exemple de la Chine : si les Chinois consommaient autant d'énergie que les
Américains, les ressources de 5 planètes seraient nécessaires.
La consommation d'énergie y est encore faible en raison de la proportion
élevée de paysans et de la modestie du niveau de vie. Mais on estime qu'en
2016 elle aura plus que doublé et que leur consommation de pétrole aura elle
plus que triplé.
Le problème des émissions de CO2 y est encore plus inquiétant.
L'essentiel de l'électricité y est produite à partir du charbon (77%) en raison de
la rareté des autres ressources et de la vitesse de croissance de la demande.
D'où l'explosion des émissions de CO2. En 2006, ils représentaient 70% de plus
que la zone euro et peut-être 6 fois plus dans 10 ans.
La rareté de l'eau : 2500 êtres humains meurent chaque jour faute d'eau en
quantité suffisante
1 milliard d'êtres humains n'ont pas encore accès à l'eau potable, 2,6
milliards vivent sans système d'évacuation des eaux usées. L'eau insalubre est
la première cause de mortalité devant la malnutrition.
Cependant, la question est moins celle du gaspillage de l'eau par les pays
riches que celle de l'agriculture, qui consomme pratiquement 75% de l'eau
douce, et celle du non-traitement des eaux usées.
Les ressources alimentaires peuvent elles aussi venir à manquer. La FAO
recense déjà 39 pays affectés par les crises alimentaires, dont 25 en Afrique.
La surface cultivable mondiale stagne depuis 2000, et diminue même en Asie
et en Amérique du Nord.
Les Etats pourraient avoir un rôle important à jouer à l'avenir. En
encourageant le progrès agricole et la propriété, la diffusion de connaissances,
l'accès au crédit, la stabilisation des prix, ils pourraient stimuler fortement la
production agricole, qui plafonne depuis quelques années.
Second type de ressources rares -les « productibles »- i.e. ce que
l'homme fabrique mais en quantité insuffisante ou dont l'allocation est loin
d'être optimale.
L' exemple de l'épargne : au niveau global, il n'y a aucune rareté de
l'épargne mondiale. Mais elle est siphonnée par les pays riches pour financer la
consommation des ménages, l'investissement logement, les déficits publics...
qui sont des dépenses improductives. D'où la question d'une meilleure
allocation de cette ressource rare qu'est l'épargne.
La rareté du travail qualifié
Il n'y a aucune pénurie mondiale de travail mais il y a pénurie de travail
qualifié, de chercheurs, de recherche et d'innovation. La main d'oeuvre est en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%