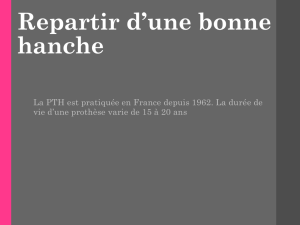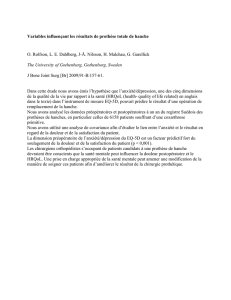AK1983_10_4_129-134

Ann. Kinésithér., 1983, t. 10, nO 4, pp. 129-134
©Masson, Paris, 1983 MEMOIRE
Intérêt et rééducation de l'arthroplastie
cervico-céphalique dans le traitement
des fractures cervico-trochantériennes du sujet âgé
H. ZREIK (1), P. HEISSLER (1), E. NAHON (2)
(1) Chirurgiens, Centre Hospitalier de Creil, Chirurgie orthopédique et traumatologie, (2) Médecin-rééducateur, attachée au Centre
Hospitalier de Creil, F 60100 Creil.
J
J
it
Le lever immédiat des personnes âgées,
évitant les complications du décubitus, est
toujours le but du rééducateur a qui les
chirurgiens demandent de dynamiser leur
patient, tout en donnant des conseils de
prudence (les deux attitudes étant anti-
nomiques, bien quejustifiées). Cette expérience
clinique rend compte d'un programme de
kinésithérapie adapté qui commence par des
résistances manuelles raisonnées en fonction
des attitudes éventuellement luxantes. L'utili-
sation des contractions par «débordement
d'énergie », le travail controlatéral, les syner-
gies croisées utilisées pour ces rééducations
contribuent pour une grande part àl'intérêt
de ce travail d'actualité.
L'arthroplastie cervico-céphalique s'utilise de
préférence dans Je cas où les interventions
classiques type clou-plaque semblent faire courir
un risque sérieux à un malade âgé. Son principal
intérêt est de permettre un appui précoce qui
évite toutes les complications du décubitus.
Notre étude intéresse 32 malades opérés au
Centre Hospitalier de Creil, de septembre 1978
à octobre 1979, tous ces malades ayant bénéficié
d'une prothèse cervico-céphalique type Merle
d'Aubigné-Leinbach non scellée.
Caractéristiques de la prothèse
Il s'agit d'une prothèse àappui trochantéro-diaphysaire
étendu, avec un angle de 135° de valgus (fig. 1). Un pivot
Tirés à part: E. NAHON, à l'adresse ci-dessus.
long de taille unique (200 mm) présente une surface
latérale de contact solide, avec une grande résistance aux
rotations. Deux trous en position transverse sont prévus
pour la fixation du grand trochanter ..
Il a été démontré que l'assise horizontale de ces
prothèses fémorales leur donne un appui réel, stable et
maximum au niveau de la corticale postérieure (fig. 2).
Cet appui est beaucoup plus résistant que sur les prothèses
àassise oblique et àqueue courte (fig. 3), qui très vite
lors des contraintes verticales, vont d'une part trop
solliciter la zone cervicale supéro-interne avec comme
conséquence une résorbtion du moignon cervical et
d'autre part entraîner une aggravation des contraintes au
niveau de l'extrémité diaphysaire de l'implant, ce qui peut
donner lieu à des fractures de fatigue.
Analyse de la série
L'âge des patients va de 65 à 92 ans avec une moyenne
de 81 ans. On trouve habituellement, dans ce type de
fracture, une majorité de patients du sexe féminin (84 %).
La moyenne d'âge des femmes (84 ans) est supérieure à
celle des hommes (76 ans). Il s'agit de femmes âgées, dont
l'équilibre psychique et somatique est souvent précaire et
dont la déambulation avant la fracture est parfois difficile
àaffirmer. Les renseignements fournis, quant àla
possibilité de marche du patient, sont souvent contradic-
toires et le bilan clinique avec l'interrogatoire et l'examen
initial (11) nous démontrent qu'il n'est pas facile de
connaître les critères exacts de la marche avant la fracture.
Le bilan radiologique comprend un bassin de face, une
radiographie de la hanche de la face et de profil. Ce bilan,
fondamental pour porter l'indication d'arthroplastie,
permet d'une part de trouver des lésions associées (maladie
de Paget, ostéoporose, ostéomalacie, coxa-vara, coxa-
valga, fracture ancienne sur la hanche contro-latérale),
d'autre part de classer la fracture dans l'une des deux
catégories, stable ou instable (8, 13):
- Les fractures présumées stables sont celles où le trait
est généralement simple. Le déplacement une fois réduit

130 Ann. Kinésithér., 1983, t. la, nO4
1
--
,
1/~\
1
(
11
1
iV1
\\\\{
\\\ 1 1
\1
\
1
\ 1 {
\
1
\ 1 1 1
\
1
\
1
\Il!
1
1
1
1\ 1 1
1
1\ 1 1 r
1
1
\ 1 Il
1
1
,Il 1 \
FIG. 1
FIG.2
FIG. 3
FIG. 1. - Prothèse cervico-céphalique non scellée de Merle
d'Aubigné -Leinbach.
FIG. 2. - L'assise horizontale de la prothèse cervico-céphalique
non scellée lui donne un appui réel, stable et maximum.
FIG. 3. - Prothèse à assise oblique et à queue courte qui va
solliciter la zone cervicale supéro-interne et aggraver les
contraintes de l'extrémité diaphysaire.
n'a plus tendance à se reproduire et la fixation par
ostéosynthèse est relativement aisée et possède une bonne
prise. Il n'y a pas de vide osseux.
- Les fractures instables sont celles à plusieurs fragments,
où souvent le petit trochanter est détaché. Il existe une
zone de comminution postérieure (fig. 4) ou antéro-interne
difficile à réduire et où l'ostéosynthèse n'aura qu'un appui
médiocre.
Dans notre série, nous avons 10 fractures stables et 22
fractures instables. Parmi ces dernières, on note 18
fractures pertrochantériennes complexes et 4fractures
trochantéro-diaphysaires. On remarque ainsi la prédomi-
nance des fractures instables (2/3) sur les fraCtures stables
(113) ; cela se justifie par le fait que l'instabilité a été un
argument majeur dans la décision d'opter pour cette
technique; quant aux cas avec fractures stables, l'état
physiologique a été le facteur majeur de cette décision.
FIG. 4. - Fracture instable avec:
1 - fragment cervico-céphalique,
2 - fragment diaphysaire,
3 - Zone de comminution postérieure.
A. Vue externe; B. Vue postérieure.
Traitement chirurgical
Les délais entre le traumatisme et l'interven-
tion ayant une importance vitale, les 3/4 des
patients sont opérés dans les 24 heures qui
suivent la fracture.
La voie d'abord est postéro-externe, elle
mesure 20 cm et elle est àcheval sur la région
du grand trochanter.
Dans le cas de fractures per-trochantériennes
simples, sans détachement du grand trochanter,
après ouverture de la capsule, le fragment
comportant ce qui reste du col et de la tête
fémorale est retiré. La mise en place de la
prothèse est aisée et rapide. Elle n'est pas scellée.
Il faut surtout veiller àlui donner une bonne
antéversion. En fin d'intervention, la stabilité de
la prothèse est testée par des mouvements de
flexion avec rotations externe et interne.
La rééducation
Elle a un but essentiellement fonctionnel,
tendant à redonner au malade son autonomie.
Elle doit être adaptée à chaque patient. Elle a
comme principe de ne jamais forcer sur les
amplitudes articulaires, d'effectuer toute mobili-
sation avec douceur en assurant des séances
courtes et fractionnées et de tenir le plus grand
compte de la voie d'abord de façon à éviter les
attitudes luxantes et les mouvements combinés.
Notre schéma type de rééducation est le
suivant:
PENDANT LES DEUX PREMIERS JOURS
Immédiatement après l'intervention, le ma-
lade est installé dans son lit, le membre inférieur
opéré placé en abduction, en évitant la rotation
interne du fait de la voie d'abord postéro-
externe, grâce à un système de sacs antirotations.
Ceci diminue les risques de luxation par
mouvements combinés de flexion-adduction-
rotation interne. Un cerceau est placé sous le
drap. Les pieds du lit sont surélevés.
Dès le lendemain de l'intervention, on fait une
rééducation respiratoire, un massage des mem-

bres inférieurs contre la stase, un travail statique
du quadriceps et des fessiers du côté opéré. On
mobilise la rotule latéralement et de haut en bas.
Si un travail isométrique n'est pas possible du
fait de la sidération musculaire, on a recours à
un mouvement imaginé par débordement d'éner-
gie à partir du membre controlatéral (fig. 5, 6
et 7).
FIG.5. - Le travail du quadriceps côté sain entraîne une
contraction côté opéré par débordement d'énergie.
Ann. Kinésithér., 1983, t. 10, nO4 131
à tous les sujets âgés concernant l'appui sur le
membre opéré.
Au début, on effectue des parcours brefs.
La flexion est travaillée en position de
décubitus dorsal pour obtenir 60°. L'abduction
n'ira pas au-delà de 20°. L'adduction n'est pas
à rechercher pendant cette période. Les stabilisa-
teurs de hanche (psoas, moyens fessiers, grands
fessiers) sont travaillés en statique; le quadriceps
sera travaillé en dynamique (fig. 8et 9). Il ne
faut jamais faire de travail actif contre résis-
tance, ni de mobilisation passive forcée, ni
surtout de mouvements combinés.
Il ne faut pas non plus chercher à décoller
la jambe tendue du plan du lit.
Fra. 7 FIG. 8
FIG. 6. - Le travail du moyen fessier côté sain entraîne une
contraction du moyen fessier côté opéré.
Du TROISIEME AU HUITIÈME JOUR APRÈS
L'OPÉRATION
Dès l'ablation des drains de redons, le malade
sera assis dans un fauteuil. La marche avec appui
est toujours progressive et commence par la
station assise. On effectueensuite une verticalisa-
tion, si possible sur le plan incliné, qui est utilisé
non pas dans un but de musculation statique
du moyen fessier mais pour résoudre les
éventuels problèmes circulatoires liés à l'orthos-
tatisme et pour vaincre l'appréhension commune
Fra. 7. - Le travail des rotateurs externes de hanche du côté
sain entraîne une contraction du côté opéré.
FIG. 8. - Travail symétrique dynamique des quadriceps.
APRÈS LE HUITIÈME JOUR
On entreprend une rééducation précoce en
recherchant l'indolence, la mobilité et la stabi-
lité. Si flexion et abduction sont satisfaisantes,
on abandonne les béquilles et le déambulateur
pour adopter les cannes anglaises. La montée
et la descente des escaliers sont commencées. En
ce qui concerne la récupération de l'amplitude,
on doit «laisser venir la mobilité sans violence
et savoir l'exploiter» (14). On commence par
le travail actif qu'il faudra répéter un grand
nombre de fois, soit à mains libres, soit dans
l'eau si l'état de la cicatrice le permet.
-~
U 1IiiI,o;m__

132 Ann. Kinésithér., 1983, t. 10, nO 4
VERS LE 21eJOUR Comparaisons avec d'autres séries d'intervention
FIG. 9. - Travail en synergie croisée ischio-jambiers côté sain-
quadriceps côté opéré.
FIG. 10. - Le travail du grand fessier côté sain entraîne une
facilitation de la contraction du quadriceps côté opéré.
Après l'ablation des fils et un bilan complet
de la hanche, on peut, àcette période, essayer
de récupérer la force musculaire, progressive-
ment, par un travail fractionné: quadriceps et
moyens fessiers en isométrique, psoas et exten-
seurs de cuisse en dynamique. On peut utiliser
différents moyens de facilitation (fig. 10). Toute-
fois, la rééducation ne doit pas avoir pour but
une musculation intensive; des possibilités fonc-
tionnelles suffisentamplement pour ces malades.
S'il n'y a pas de piscine, on peut, àcette phase,
instituer un travail en poulie avec des charges
faibles, tout en préservant la bonne position du
sujet en ce qui concerne la hanche et le bassin
et en évitant toute fatigue. La progressivité de
l'appui et une certaine indépendance demandent
environ 3 semaines après lesquelles on fait un
bilan. Une prothèse entraîne un allongement ou
un raccourcissement du membre que l'on
corrigera par une talonnette placée du côté opéré
ou du côté contro-latéral.
La poursuite de la rééducation dans un centre
ou à domicile nous paraît très utile chez ces
patients âgés si !,autonomie n'est pas acquise
rapidement ou si les automatismes de la marche
ne sont pas revenus.
FIG.9 FIG. 10
AUTRES ARTHROPLASTIES
Nous rapportons la série du Professeur
G. Lord (9) (clinique de l'APAS). Trente-sept
arthroplasties cervico-céphaliques ont été posées
de 1971 à 1975 avec 60 % de bons résultats,
16 % de mauvais résultats (malades grabataires)
et 24 % de mortalité. En ce qui concerne les
résultats obtenus par intervention sur les frac-
tures stables ou instables, ils sont identiques à
ceux obtenus à l'hôpital de Creil.
L'OSTÉOSYNTHÈSE PAR CLOU-PLAQUE
Il ne sera jamais question de substituer aux
ostéosynthèses une arthroplastie de principe
dans le traitement des fractures cervico-trochan-
tériennes du patient âgé, dont le traitement est
essentiellement chirurgical. Le problème est
celui de l'indication opératoire qui nous semble
actuellement bien codifiée.
Toutefois, l'utilisation du clou-plaque a posé
un certain nombre de problèmes techniques (5)
qui sont la qualité du montage, surtout dans les
fractures instables, l'appui plus ou moins tardif,
la nécessité de transfusions, la durée de l'acte
opératoire, le démontage, le sepsis, la
pseudarthrose ...
Vingt-quatre malades ont été traités par
clou-plaque de Staca au Centre Hospitalier
Général de Creil, entre le mois de septembre
1978, date de l'ouverture de l'hôpital et le mois
d'octobre 1979. On ne constate dans cette série
aucun décès, mais 20 bons résultats soit 84 %
et 4 mauvais résultats soit 16 %. A la lecture
de ces résultats, l'ostéo-synthèse par clou-plaque
monobloc peut donc paraître préférable; cepen-
dant, il faut souligner le fait que, dans cette
double série, les malades ont été sélectionnés
avant l'intervention, soit sur des critères anato-
miques pour des fractures peu commiriutives,
peu déplacées, du 3e et non du 4e âge, soit sur
. des critères généraux (meilleur état général des
patients) et sur des critères d'âge (âge moyen:
59 ans).
Il existe une variante, l'ostéosynthèse avec
pénétration cervico-diaphysaire qui permet un

appui quasi immédiat. Toutefois, notre expé-
rience est trop récente pour que nous puissions
en tirer une conclusion valable. Les premiers
résultats sont cependant très encourageants.
LE CLOU ÉLASTIQUE DE ENDER
Le clou élastique de Ender est une méthode
de traitement à foyer fermé des fractures de la
région trochantéro-diaphysaire des sujets
âgés (6). Sous contrôle télévisé, avec amplifica-
teur de brillance, la fracture est réduite par
abduction et rotation interne. Trois clous sont
introduits dans la diaphyse fémorale par une
ouverture de 10 cm placée en avant du condyle
interne qui ne touche pas le cercle artériel
péri-articulaire. Cette intervention respecte donc
l'articulation de la hanche et celle du genou et
ne sectionne aucun élément musculaire ni
ligamentaire. Elle assure l'ostéosynthèse par un
triple appui au niveau de la tête où les clous sont
en éventail. Dès le 1er jour après l'intervention,
la mobilisation active est permise, progressive-
ment, en flexion et en extension. La mise en
charge est très rapide. Dès le lendemain, le blessé
peut être assis dans un fauteuil. L'appui complet
est ici permis entre le 4e et le Se jour. Il est très
difficilede rétablir l'antéversion du col fémoral,
lors de la marche, ce qui entraîne une rotation
externe du membre inférieur, inconvénient que
l'on ne retrouve pas après une prothèse cervico-
céphalique de Merle d'Aubigné. On s'efforcera
donc de faire travailler les rotateurs internes de
hanche et de veiller à maintenir le membre
inférieur allongé au lit en position neutre.
Cette méthode présente aussi certains autres
inconvénients comme la descente du clou, sa
migration transcéphalique ou cotyloïdienne avec
menace de l'articulation de la hanche, le varus
avec cal vicieux. Les risques sont d'autant plus
importants que le malade est âgé et ostéoporoti-
que. Utilisant peu cette technique, nous rappor-
tons la série de J-M Le Goarant de Tromelin,
service du Professeur Nordin. Sur 65 cas, la
moyenne d'âge étant de 79 ans, les résultats
globaux au 4e jour sont les suivants: 56 % de
patients autonomes, 24 % de patients non
autonomes et 20 % de décès. Les résultats sont
assez superposables à notre série d'arthroplastie
quant aux pourcentages.
Ann. Kinésithér., 1983, t. 10, n° 4 133
Résultats
Le lever avec pas simulé et reprise immédiate
de la marche sans appui du côté opéré est une
performance que bien peu de personnes âgées
réussissent. C'est la raison pour laquelle, en cas
d'ostéosynthèse classique, la déambulation est
presque toujours différéejusqu'à ce que l'appui
soit autorisé.
Dans le cas d'une intervention avec prothèse
cervico-céphalique de Merle d'Aubigné, la re-
prise de la marche est fonction des possibilités
propres à chaque individu. Il s'agit davantage
d'une réadaptation à la marche que d'une
rééducation proprement dite. Il faut, bien sûr,
conserver les mobilités existantes par un travail
actif aidé au lit, mais lorsque l'appui est autorisé,
il est total et non partiel. Les délais d'appui sont
variables et vont de moins d'une semaine (4 cas)
à moins de 15jours (15 cas). Quatre cas ont pu
avoir un appui entre le 15e et le 30e jour, 4 cas
entre le 30e et le 90e jour et aucun au-delà de
90 jours.
Nous avons appuyé nos résultats, qui peuvent
être considérés comme définitifs, sur un recul
de 90 jours :
- la douleur se manifeste rarement: 3 cas de
douleur inguinale, 1 cas de gonalgie, 1 cas de
douleur diaphysaire;
- le périmètre de marche est semblable à l'état
antérieur à la fracture;
- la mobilité de la hanche a été comparée à celle
de la hanche contro-Iatérale en groupant les
diverses données suivant le bilan fonctionnel de
la hanche et la cotation de Merle d'Aubigné (11).
Toutefois, si le malade peut retrouver son
autonomie, il entre dans les bons résultats.
Globalement, sur 32 patients opérés, 21 sont
autonomes, soit 65 %, 5 ne sont pas autonomes
(grabataires) soit 16 %et 6 sont décédés soit
19 %. Si l'on compare les résultats en fonction
du type de fracture, les bons résultats dans les
deux groupes sont pratiquement identiques et
nous remarquons que l'arthroplastie diminue le
pourcentage de mauvais résultats constatés dans
le groupe des fractures instables dans les séries
traitées par clou-plaque ou par clous de Ender.
Conclusion
Les résultats fonctionnels obtenus par arthros-
 6
6
1
/
6
100%
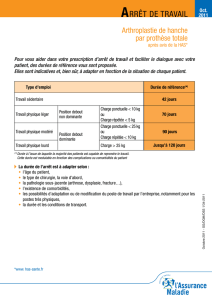




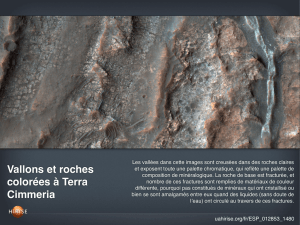


![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)