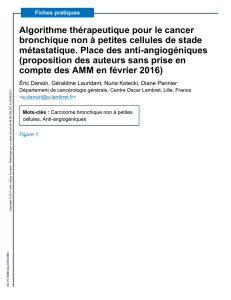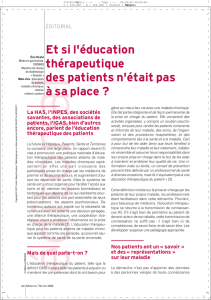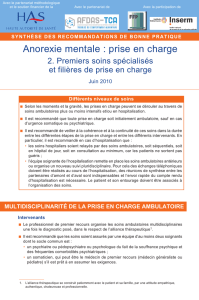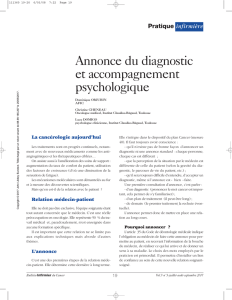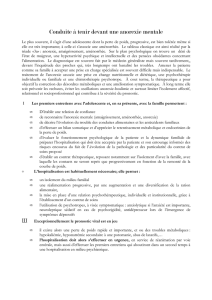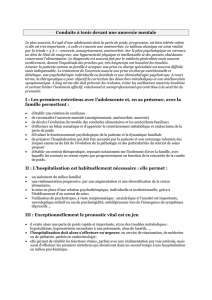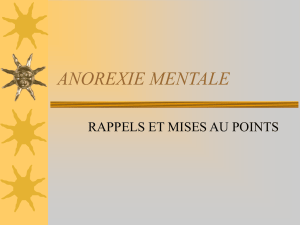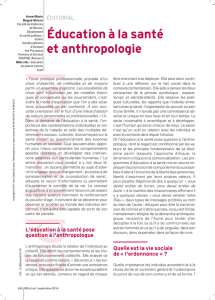Recommandations - John Libbey Eurotext

334 mt, vol. 17, n° 4, octobre-novembre-décembre 2011
doi:10.1684/met.2011.0346
Recommandations
Avec le partenariat méthodologique,
et le soutien financier de la
Avec le partenariat de Avec la participation de
Recommandations de bonne pratique
Anorexie mentale : prise en charge
Recommandations. Juin 2010
L’argumentaire scientifi que de ces recommandations est téléchargeable sur
www.has-sante.fr
Haute Autorité de Santé
Service communication
2 avenue du Stade de France-F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX
Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 Fax : +33 (0)1 55 93 74 00
Ce document a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en juin 2010.
© Haute Autorité de Santé – 2010
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

mt, vol. 17, n° 4, octobre-novembre-décembre 2011 335
Sommaire
Abréviations .............................................................................................................................................336
Recommandations ..................................................................................................................................337
1 Introduction ...................................................................................................................................337
1.1 Thème et objectifs des recommandations 337
1.2 Patients concernés 338
1.3 Professionnels concernés 338
1.4 Gradation des recommandations 338
2 Repérage, diagnostic et fondements de la prise en charge .......................................................338
2.1 Intérêt du repérage précoce 338
2.2 Populations à risque 338
2.3 Modalités du repérage ciblé de l'anorexie mentale 338
2.4 Diagnostic et fondements de la prise en charge 340
3 Premiers soins spécialisés et fi lières de prise en charge ...........................................................340
3.1 Différents niveaux de soins 340
3.2 Multidisciplinarité de la prise en charge ambulatoire 341
3.3 Évaluation de la gravité 341
3.4 Prise en charge thérapeutique 341
3.5 Prises en charge particulières 346
3.6 Information du patient et de son entourage 346
4 Prise en charge hospitalière de l'anorexie mentale ...................................................................346
4.1 Hospitalisation de jour 346
4.2 Hospitalisation à temps plein 348
4.3 Structures d’hospitalisation 348
4.4 Objectifs de soins 349
4.5 Modalités de soins 350
4.6 Durée de l'hospitalisation 352
4.7 Cas particuliers 352
Annexe 1. Défi nition de l'anorexie mentale ........................................................................................353
Annexe 2. Anorexie mentale chronique ...............................................................................................354
Annexe 3. Actions ou recherches futures.............................................................................................355
Méthode Recommandations pour la pratique clinique .......................................................................356
Participants ..............................................................................................................................................358
Sociétés savantes et associations professionnelles 358
Comité d'organisation 358
Groupe de travail 358
Groupe de lecture 359
Remerciements 360
Fiche descriptive .....................................................................................................................................360
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

336 mt, vol. 17, n° 4, octobre-novembre-décembre 2011
Recommandations
Abréviations
ALAT alanine aminotransférase
ASAT aspartate aminotransférase
ASP abdomen sans préparation
DFTCA défi nition française des troubles du comportement alimentaire
ECG électrocardiogramme
HDT hospitalisation à la demande d’un tiers
IMC indice de masse corporelle
OPP ordonnance de placement provisoire
PMA procréation médicalement assistée
RBP recommandations de bonne pratique
SCOFF Sick, control, one stone, fat, food
SCOFF-F version française du SCOFF
TCA trouble du comportement alimentaire
TCC thérapie cognitivo-comportementale
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

mt, vol. 17, n° 4, octobre-novembre-décembre 2011 337
1 Introduction
1.1 Thème et objectifs des recommandations
Thème des recommandations
Ces recommandations de bonne pratique (RBP)
ont été élaborées par l’Association française pour le
développement des approches spécialisées des trou-
bles du comportement alimentaire (AFDAS-TCA) avec
la participation de la Fédération française de psychia-
trie (FFP) et de l’unité 669 de l’Inserm, dans le cadre
d’un partenariat méthodologique, logistique et fi nan-
cier avec la Haute Autorité de Santé (HAS). Ce travail a
été fait à l’initiative de l’AFDAS-TCA et de la Direction
générale de la santé qui avaient saisi la HAS pour rédi-
ger des RBP sur ce thème.
L’anorexie mentale est un trouble du comporte-
ment alimentaire (TCA) d’origine multifactorielle :
facteurs personnels de vulnérabilité psychologique,
biologique et génétique, et facteurs d’environnement,
familiaux mais également socioculturels (importance
de l’image du corps dans nos sociétés). Cette maladie
est défi nie selon les critères diagnostiques des clas-
sifi cations internationales (CIM-10 et DSM-IV-TR ; cf.
annexe 1).
Les cas d’anorexie mentale répondant aux critères
diagnostiques du DSM-IV-TR sont relativement ra-
res : prévalence en population générale de 0,9 à 1,5 %
chez les femmes et de 0,2 à 0,3 % chez les hommes. La
forme subsyndromique, ne répondant pas strictement
aux critères diagnostiques (CIM-10 et DSM-IV-TR), est
plus fréquente.
Les critères diagnostiques font actuellement l’ob-
jet de nombreuses discussions concernant en par-
ticulier la place des formes mineures et l’association
de plusieurs troubles alimentaires. Les conduites
anorexiques et boulimiques sont souvent associées,
simultanément ou successivement. Cependant, si
près de la moitié des patients anorexiques réunissent
à un moment ou un autre les critères diagnostiques
de la boulimie, la réciproque n’est pas vraie. Compte
tenu de la complexité du champ, ces RBP sont cen-
trées sur l’anorexie mentale, avec crises de boulimie
et/ou conduites de purge ou sans (type restrictif).
Ces RBP concernent également l’anorexie mentale
subsyndromique qui mérite une prise en charge
similaire.
L’anorexie mentale se caractérise par la gravité po-
tentielle de son pronostic :
– risque de décès (suicide, complications soma-
tiques) : il s’agit de la maladie psychiatrique qui en-
gendre le taux de mortalité le plus élevé, jusqu’à
10 % dans les études comportant un suivi de plus de
10 ans ;
– risque de complications somatiques et psychiques
nombreuses : défaillance cardiaque, ostéoporose,
infertilité, dépression, suicide, etc. ;
– risque de chronicité, de rechute et de désinser-
tion sociale (cf. annexe 2).
La guérison est possible même au bout de plusieurs
années d’évolution.
L’approche pluridisciplinaire justifi ée par la né-
cessité d’aborder les dimensions nutritionnelles,
somatiques, psychologiques et familiales pose le
problème de l’articulation des différents interve-
nants au sein d’un projet de soins global au long
cours.
Objectifs des recommandations
Les objectifs de ces RBP sont d’aider à :
– repérer plus précocement l’anorexie mentale ;
– améliorer l’accompagnement du patient et de
son entourage ;
– améliorer la prise en charge et l’orientation ini-
tiale des patients ;
– améliorer la prise en charge hospitalière
lorsqu’elle est nécessaire et la prise en charge post-
hospitalière.
Les axes prioritaires d’amélioration de la qua-
lité des soins défi nis pour ce travail, en lien direct
avec les préoccupations des professionnels et des
représentants d’associations de patients, sont les
suivants :
– repérage et diagnostic précoces, prenant en
compte les populations les plus à risque, les signes
d’alerte et les critères diagnostiques les plus perti-
nents, ainsi que la recherche d’alliance avec le patient
et son entourage, souvent diffi cile du fait des mécanis-
mes de déni1 ;
– modalités d’orientation et de prise en charge am-
bulatoire des patients (adressage, nécessaire pluridis-
ciplinarité et dispositifs spécialisés, en particulier en
termes d’hospitalisation de jour) ;
– indications et modalités d’hospitalisation à temps
plein (critères de gravité, contrats thérapeutiques et
place de l’hospitalisation sous contrainte).
1 Déni : refus par le sujet de reconnaître la réalité d’une perception
traumatisante.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

338 mt, vol. 17, n° 4, octobre-novembre-décembre 2011
Recommandations
1.2 Patients concernés
Ces RBP concernent les enfants, les préadolescents,
les adolescents et les jeunes adultes. Les nourrissons
et les adultes ayant une anorexie mentale à démarrage
tardif sont exclus du champ des RBP.
1.3 Professionnels concernés
Ces RBP sont destinées à tous les professionnels de
santé et travailleurs sociaux susceptibles d’être impli-
qués dans la prise en charge des patients ayant une
anorexie mentale, notamment : médecins généralistes,
pédiatres, médecins et infi rmiers scolaires, gynéco-
logues, pédopsychiatres, psychiatres, psychologues,
médecins du sport, médecins du travail, internistes,
réanimateurs, endocrinologues, gastro-entérologues,
nutritionnistes, diététiciens.
1.4 Gradation des recommandations
Les recommandations proposées ont été classées
en grade A, B ou C selon les modalités suivantes :
– une recommandation de grade A est fondée sur
une preuve scientifi que établie par des études de fort
niveau de preuve, comme des essais comparatifs ran-
domisés de forte puissance et sans biais majeur ou
méta-analyse d’essais comparatifs randomisés, analyse
de décision basée sur des études bien menées (niveau
de preuve 1) ;
– une recommandation de grade B est fondée sur
une présomption scientifi que fournie par des études
de niveau intermédiaire de preuve, comme des es-
sais comparatifs randomisés de faible puissance, des
études comparatives non randomisées bien menées,
des études de cohorte (niveau de preuve 2) ;
– une recommandation de grade C est fondée sur
des études de moindre niveau de preuve, comme des
études cas-témoins (niveau de preuve 3), des études
rétrospectives, des séries de cas, des études compa-
ratives comportant des biais importants (niveau de
preuve 4).
En l’absence d’études, les recommandations sont
fondées sur un accord professionnel au sein du grou-
pe de travail réuni par l’AFDAS-TCA après consultation
du groupe de lecture. Dans ce texte, les recomman-
dations non gradées sont celles qui sont fondées sur
un accord professionnel. L’absence de gradation ne
signifi e pas que les recommandations ne sont pas per-
tinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à en-
gager des études complémentaires. Des propositions
sont réunies en annexe 3.
2 Repérage, diagnostic et fondements
de la prise en charge
2.1 Intérêt du repérage précoce
Le repérage et la prise en charge précoces de l’ano-
rexie mentale sont recommandés pour prévenir le ris-
que d’évolution vers une forme chronique et les compli-
cations somatiques, psychiatriques ou psychosociales,
en particulier chez les adolescentes (grade C). Ils per-
mettent une information sur l’anorexie mentale et ses
conséquences et facilitent l’instauration d’une véritable
alliance thérapeutique avec le patient et ses proches.
2.2 Populations à risque
Un repérage ciblé est recommandé :
– sur les populations à risque, où la prévalence est
maximale :
• adolescentes,
• jeunes femmes,
• mannequins,
• danseurs et sportifs (disciplines esthétiques ou
à catégorie de poids : sports valorisant ou nécessitant
le contrôle du poids ; disciplines à faible poids corpo-
rel tels les sports d’endurance), notamment de niveau
de compétition,
• sujets atteints de pathologies impliquant des
régimes telles que le diabète de type 1, l’hypercholes-
térolémie familiale, etc. ;
– ou en présence de signe(s) d’appel (cf. paragra-
phe 2.3).
Ceci concerne notamment les médecins délivrant
les certifi cats de non-contre-indication à la pratique
sportive (médecins généralistes, pédiatres, médecins
du sport), les médecins scolaires, de l’université, du
travail, etc. Il est à noter que les personnes atteintes de
TCA consultent plus fréquemment leur médecin gé-
néraliste que la population générale dans les années
précédant le diagnostic pour des plaintes somatiques
diverses.
2.3 Modalités du repérage ciblé de l’anorexie
mentale
Questions à poser
Pour les populations à risque, il est recommandé à
l’entretien de :
– poser systématiquement une ou deux questions
simples sur l’existence de TCA telles que : « avez-vous
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%