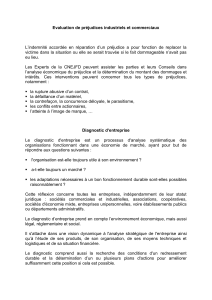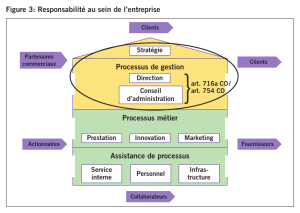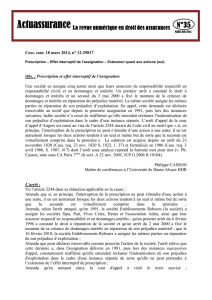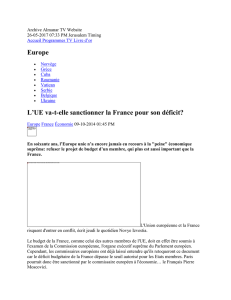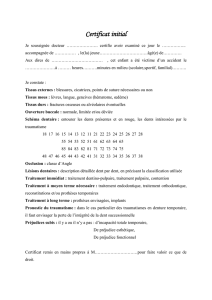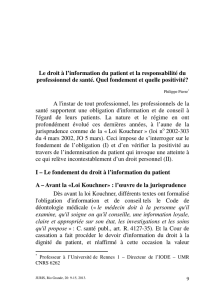Le réveil tardif des victimes de la débâcle du - Gredeg

GROUPE DE RECHERCHE EN ECONOMIE, DROIT ET GESTION
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS
Le réveil tardif des victimes de la débâcle du Crédit Lyonnais
fait évoluer la notion du préjudice propre
Ingeborg Krimmer
Octobre 2005
Document de travail n° 2005 - 7
G.R.E.D.E.G.
250, rue Albert Einstein.
06560 Valbonne – Sophia Antipolis, France.

Le réveil tardif des victimes de la débâcle du Crédit Lyonnais fait évoluer la notion du pré-
judice propre
Cass. com. 28 juin 2005
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’à l’automne 1992, la société Banque financière pari-
sienne (la société BAFIP), contrôlée par la société Altus finance, filiale de la société Crédit lyon-
nais, directement et par l’intermédiaire de sa filiale, la société Calciphos, a fait l’objet d’opérations
de restructuration à l’issue desquelles elle a pris le nom de banque Colbert ; qu’au titre de ces opéra-
tions, la société BAFIP a absorbé les sociétés Saga et Altus patrimoine et gestion et reçu par voie
d’apport partiel d’actif les activités bancaires de la société International bankers SA (la société IB-
SA) et de la société Alter banque, ainsi que les titres Alter banque détenus par la société Altus fi-
nance ; qu’en 1998, la société Total Fina Elf (la société Total) et la Société financière d’Auteuil (la
société SFA), actionnaires minoritaires de la société BAFIP, alléguant avoir subi un préjudice du
fait de la surévaluation des actifs apportés à celle-ci, ont assigné en dommages-intérêts MM. Wind-
sor et Amata, commissaires aux apports et à la fusion, les sociétés ayant participé aux opérations de
restructuration ou leurs ayants cause, à savoir la société CDR créances, venant aux droits de la ban-
que Colbert, la société CDR entreprises, venant aux droits de la société Altus finance, la société
Calciphos, la société Crédit lyonnais et la société IBSA, ainsi que les sociétés de commissaires aux
comptes intervenues dans le contrôle des comptes de la banque Colbert ou des sociétés ayant parti-
cipé aux opérations de restructuration, à savoir la société Ernst et Young audit (la société Ernst et
Young), la société Cabinet Robert Mazars, devenue société Mazars et Guérard, la société Befec
Price Waterhouse (la société Befec), la société KPMG Fiduciaire de France (la société KPMG) et la
société Cabinet Guy Noël et associés (la société Cabinet Guy Noël) ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que les sociétés Total et SFA font grief à l’arrêt d’avoir dit n’y avoir lieu à surseoir à sta-
tuer, alors, selon le moyen :
1°/ que l’exception de sursis, tirée de l’article 4 du Code de procédure pénale, peut être soulevée
utilement après défense au fond ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé, par fausse
application, l’article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu’en toute hypothèse, le sursis à statuer prévu par l’article 4 du Code de procédure pénale doit
être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur
celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu’en l’espèce, la cour d’appel se borne à relever
1

qu’elles avaient eu connaissance au plus tard le 11 octobre 1999 de la procédure pénale ouverte à
l’encontre de certains anciens dirigeants d’IBSA ; que de tels motifs sont impropres à établir
qu’elles disposaient, à cette date, des éléments nécessaires pour apprécier si la décision à intervenir
sur l’action publique ainsi ouverte serait susceptible d’influer sur celle de leur propre action en res-
ponsabilité civile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 4 du Code
de procédure pénale et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que la prescription de l’action en responsabilité engagée par elles contre les sociétés de commis-
saires aux comptes dépendait, notamment, du point de savoir si les faits dommageables, à savoir la
certification des comptes des sociétés apporteuses pour l’année 1991 et le visa de leurs situations
arrêtées au 30 juin 1992, avaient été dissimulés ; qu’une telle dissimulation pouvait ressortir de la
procédure pénale ouverte en décembre 1994 du chef de présentation de comptes sociaux inexacts,
et que l’issue de cette procédure était ainsi de nature à exercer une influence sur la décision du juge
civil ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure pénale ;
4°/ qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a également violé les articles L. 225-242 et L. 225-254 du
Code de commerce ;
5°/ que le caractère intentionnel de la surévaluation des apports, allégué par elles, impliquait que les
sociétés du groupe Crédit lyonnais, déjà majoritaires au sein de la BAFIP au moment du vote des
opérations litigieuses, avaient cherché à s’avantager au détriment des actionnaires minoritaires, de
sorte que le préjudice souffert par elles présentait dans ces conditions un caractère individuel ; que
la démonstration d’une surévaluation intentionnelle était donc susceptible d’avoir une incidence sur
l’appréciation de la recevabilité de l’action en responsabilité intentée par elles ; qu’en estimant que
l’issue de la procédure pénale ouverte en décembre 1994, qui pouvait pourtant permettre d’établir le
caractère intentionnel des surévaluations, n’était pas de nature à exercer une influence sur la déci-
sion du juge civil, la cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure pénale ;
6°/ qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a également violé l’article 31 du nouveau Code de procé-
dure civile ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et
108 du nouveau Code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les disposi-
tions de l’article 4 du Code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance,
doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond, l’arrêt relève que les sociétés
Total et SFA ont soulevé pour la première fois dans leurs dernières conclusions d’appel, du 31 oc-
tobre 2002, l’exception de sursis à statuer tirée de la procédure pénale ouverte au mois de décembre
2

1994 et dont elles avaient eu connaissance au plus tard par une lettre du 11 octobre 1999 ; qu’en
l’état de ces énonciations et constatations et abstraction faite des motifs surabondants que critiquent
les quatre dernières branches du moyen, c’est à bon droit que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à
surseoir à statuer ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut pour le surplus
être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les sociétés Total et SFA font encore grief à l’arrêt d’avoir déclaré prescrite l’action en
responsabilité engagée contre les sociétés KPMG, Ernst et Young, Befec, Mazars et Guérard et Ca-
binet Guy Noël, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la dissimulation peut se faire par tous moyens, y compris par présomptions et
par indices ; qu’en l’espèce, elles faisaient valoir, dans leurs écritures d’appel, que les actifs appor-
tés à la banque Colbert par des sociétés du groupe Crédit lyonnais avaient perdu près de soixante
quinze pour cent de leur valeur dans les deux ans qui avaient suivi l’apport ; qu’elles ajoutaient que
la surévaluation des apports résultait d’une insuffisance de provisionnement couverte sinon encou-
ragée par le Crédit lyonnais ; qu’elles avaient produit des pièces à l’appui de ces allégations ;
qu’elles en déduisaient que les commissaires aux comptes des sociétés apporteuses ne pouvaient
ignorer que les états financiers qu’ils visaient ou certifiaient étaient faux ; qu’il appartenait aux ju-
ges du second degré d’apprécier la valeur probatoire de ces indices et présomptions ; qu’en
s’abstenant de le faire, sous prétexte qu’elles procédaient “par voie d’affirmations et de déduc-
tions”, la cour d’appel a violé l’article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 225-242 et L.
225-254 du Code de commerce ;
2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un
empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure ;
qu’en l’espèce elles soutenaient, se référant à une ordonnance du président du tribunal de commerce
de Paris en date du 18 mai 1998, avoir été dans l’impossibilité d’agir en raison de leur ignorance et
d’une erreur invincible ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a
violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu’elles faisaient valoir dans leurs conclusions que les sociétés KPMG et Ernst et Young avaient
reçu le 26 mars 1992 une mission de nature purement contractuelle, et que l’action en responsabilité
délictuelle qu’elles engageaient de ce chef à leur encontre se prescrivait par dix ans ; que la cour
d’appel a constaté que les sociétés KPMG et Ernst et Young ne pouvaient se prévaloir au titre de
leur mission d’évaluation des établissements destinés à constituer la banque Colbert, de la prescrip-
3

tion abrégée de l’article L. 225-242 du Code de commerce ; qu’en se fondant seulement, pour les
débouter de leurs demandes contre les sociétés KPMG et Ernst et Young, sur la prescription de
l’article L. 225-242 du Code de commerce, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a violé par fausse application les articles L. 225 -242 et L. 225-224-4°
du Code de commerce ;
4°/ qu’en statuant ainsi sans énoncer de motifs à l’appui de sa décision de les débouter de leurs de-
mandes formées contre les sociétés KPMG et Ernst et Young au titre de l’établissement par celle-ci
d’un rapport d’évaluation n’entrant pas dans le cadre de leur mission légale de commissaire aux
comptes, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel ayant retenu, par un motif adopté, que dans
l’hypothèse d’une dissimulation, il apparaît que la révélation de celle-ci résulte du procès-verbal du
conseil d’administration du 21 septembre 1994 faisant état de la nécessité de dotations en provisions
complémentaires d’un montant total de 314 000 000 francs, alors que les demandes ont été formées
par acte du 18 décembre 1998, la critique de la première branche s’adresse à un motif surabondant ;
Attendu, en deuxième lieu, que les sociétés Total et SFA se bornaient, dans leurs conclusions
d’appel, à faire valoir qu’elles avaient été empêchées d’agir par la dissimulation des faits domma-
geables, sans alléguer l’existence d’un événement de force majeure distinct de celle-ci ;
Et attendu, en troisième lieu, que si les sociétés Total et SFA prétendaient exercer, sur le fondement
de la mission d’évaluation confiée aux sociétés KPMG et Ernst et Young, une action en responsabi-
lité délictuelle soumise à la prescription décennale, elles n’alléguaient à l’encontre de ces sociétés
aucune faute dans l’exécution de ladite mission et se bornaient à invoquer des manquements com-
mis dans leur mission légale de certification des comptes ; que par suite, c’est vainement qu’il est
fait grief à la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur une demande que n’étayait au-
cune preuve ou offre de preuve, d’avoir surabondamment déclaré l’action prescrite ;
D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n’est pas
fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%