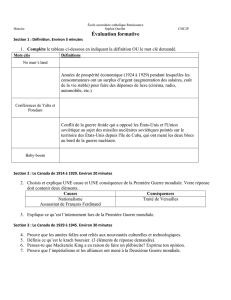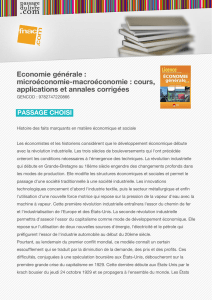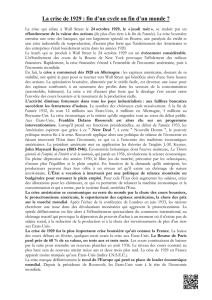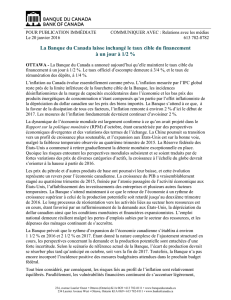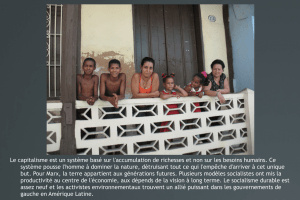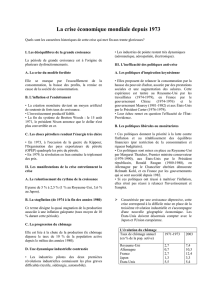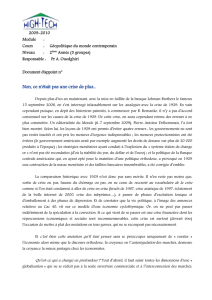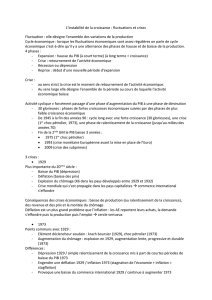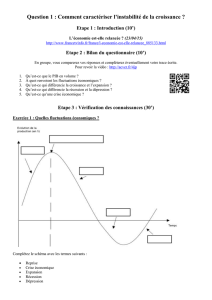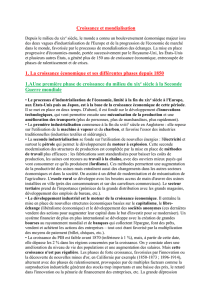1920-1933 Les crises économiques

!"#$%!"&&
'()*+,-)()*
.+/0/1-23()
d’une guerre à l’autre
Dossier réalisé par :
Nyssa Schlaefli, Lucas Innocenti, Célestine Rudaz ( 304 )
1

Table des matières
•Le monde après la guerre
◦L'inflation pendant la Première Guerre mondiale………………………………...p.3
◦la crise de 1921……………………………………………………………………....p.3
◦La situation économique en France………………………………………………..p.4
◦La situation économique en Russie………………………………………………..p.5
◦La situation économique en Grande-Bretagne…………………………………...p.6
◦La prospérité des États-Unis………………………………………………………..p.6
•L'Allemagne
◦Avant 1914 : Les stratégies économiques mises en place en cas de guerre....p.7
◦L'économie allemande durant la Première Guerre mondiale……………………p.7
◦L'économie sous la République de Weimar……………………………………….p.8
◦« La crise d'hyperinflation de 1923 » en trois phases
▪1ère phase : 1919-1921…………………………………………………………..p.8
▪2ème phase : 1922 – début 1923………………………………………………...p.9
▪3ème phase : 1923………………………………………………………………...p.9
•L'Italie
◦L'économie italienne après la Première Guerre mondiale……………………….p.9
◦L'économie sous gouvernement fasciste………………………………………...p.10
◦La crise de déflation de 1926 – 1927…………………………………………….p.10
•La crise de 1929....................................................................................................p.11
•Conclusion………………………………………………………………………………p.12
•Glossaire………………………………………………………………………………...p.14
•Chronologie……………………………………………………………………………..p.15
•Sources…………………………………………………………………..……….……..p.16
•Résumé………………………………………………………………………………….p.17
2

Le monde après la Guerre
L'inflation pendant la Première Guerre mondiale (1914-18)
Alors que la Première Guerre mondiale dure et que l'on remarque que l'on ne peut pas
gagner la guerre militairement, les nations belligérantes mettent en place une économie
de guerre pour servir l'effort de guerre. L’état se militarise, détourne les industries et gère
entièrement l'économie.
Ainsi, les industries qui servent à l'effort de guerre se développent (sidérurgie, chimie,
automobile…) et les autres secteurs s'atrophient (agriculture, industrie du luxe…).
Pour payer la guerre, l'état emprunte, notamment aux banques américaines qui
s'enrichissent. Il recourt aussi à l'impôt, mais dans une moindre mesure, car il pourrait
devenir excessif pour pallier les dépenses de guerre et le peuple se révolterait. Or, pour
garder une bonne entente avec l'arrière-front, qui est essentiel dans la guerre, et pour
maintenir un impôt assez élevé, l'état imprime des billets. Ainsi, la diminution d'argent en
circulation passe inaperçu (on a toujours l'impression durant un certain temps de faire les
mêmes dépenses et de gagner le même salaire) et l'argent continue à circuler plus ou
moins normalement. Cependant, en imprimant des billets, l'argent perd de sa valeur : il y a
un plus grand nombre de billets en circulation pour le même pouvoir d'achat1. C'est
l'inflation.
La crise de 1921
Au niveau européen, les gouvernements ont plusieurs tâches. Ils doivent tout d'abord
repousser l'inflation, puis rembourser les dettes de guerre, notamment les emprunts faits
aux États-Unis, ensuite financer la reconstruction pour réparer les dégâts causés par la
guerre, et enfin, cas particulier pour l'Allemagne qui doit payer ses réparations. En
somme, les pays doivent remanier leur économie vers une situation plus durable et saine.
Cependant, ces pays n'ont plus assez d'argent pour financer la reconstruction et relancer
l'économie. C'est pourquoi ils empruntent aux pays épargnés par la guerre, notamment les
États-Unis mais aussi le Japon, et les pays neufs comme le Canada, le Brésil et
l'Argentine2. Économiquement, il y a donc une très forte demande provenant d'Europe.
Dans les pays épargnés par la guerre, la production est industrielle, c'est-à-dire qu'on
produit en grande quantité et à bas prix. Par conséquent, la production européenne (qui
est retardée et amputée par la guerre) ne peut pas rivaliser avec la production de ces
pays ; on a du mal à exporter et on ne peut donc pas se faire assez de profit pour
rembourser les dettes.
Par conséquent, les États-Unis suspendent leurs prêts internationaux ; ils ont peur de faire
faillite.
L'Europe ne recevant plus d'argent, elle n'arrive plus à acheter de matières premières ni
d'actions. En d'autres termes, il y a moins de demande de la part de l'Europe. Ainsi, le
marché international se contracte : pour équilibrer la baisse de la demande, les
exportateurs (États-Unis, Japon…) répondent par une diminution de la production (de
l'offre) et donc une baisse des prix des produits3. Les profits diminuent, provoquant des
1 Le pouvoir d’achat se base sur deux choses : Premièrement, le salaire que l’on gagne et deuxièmement ce qu’on
peut acheter avec ce salaire.
2 Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, Tome 1 p.123
3 Provoquant l'inflation dans ces pays.
3

faillites et amplifiant la baisse de la demande : c'est la première crise économique après la
Guerre.
Les pays exportateurs sont très touchés car ils n'arrivent plus à vendre (des stocks
excédentaires se créent) et sont comme bloqués dans leur élan industriel.
En mai 1922, lors de la conférence de Gênes, les gouvernements décident de mettre au
point un nouveau système économique monétaire pour retrouver une meilleure situation
économique.
Tout d'abord, le « Gold Bullion Standard4» est crée. Les billets ne sont alors convertibles
qu'en lingots d'or et non plus en pièces d'or comme c'était le cas avant cette conférence.
Ainsi, la conversion d'argent liquide en or n'est permise qu'aux grosses sommes (tels les
prêts internationaux). Ensuite, le « Gold Exchange Standard5» apparaît. Les devises sont
convertibles en or seulement si elles possèdent une parité or fixe. Le « Gold Exchange
Standard » stabilise les devises et empêche les fluctuations rapides du cours de la
monnaie.
Par conséquent, après la conférence de Gênes, l'économie retourne progressivement à
un nouvel équilibre après résorption des stocks excédentaires.
La situation économique en France
Dans les années 20, en France foisonnent beaucoup de petites propriétés, de petites
entreprises familiales que la classe moyenne détient. Pour lutter contre l'hyperinflation qui
pourrait être fatale à leurs entreprises, et contre la concentration économique par l'état qui
enlèverait la propriété. Les Français de la classe moyenne soutiennent donc un
gouvernement d'extrême droite, conservateur, pour préserver ce qui existe : le franc
français et la propriété.
C'est pourquoi les Français investissent peu, mais épargnent plutôt. Or, le comportement
malthusien des Français provoque une stagnation économique qui est dangereuse lors de
la période de reconstruction et qui va peu à peu se transformer en crise économique.
En plus de la stagnation économique, la France connaît une période de stagnation
démographique, caractérisée par un manque de naissance.
Tout d'abord, la guerre a brisé beaucoup de couple, rendant les femmes veuves et ne
faisant donc pas d'enfants. De plus, aucune véritable politique nataliste ne poussent les
couples à faire des enfants, hormis une légère propagande anti-contraception et
anti-avortement. Enfin, à cause de la crise du logement, de l'absence d'allocations
familiales, et du manque d'aide pour les familles en général, avoir un enfant est un
fardeau.
En somme, le manque de naissance ne permet pas à la classe dirigeante de se
renouveler, réduisant encore une fois la croissance économique.
Ainsi, l'inflation qui a commencé avec la guerre se poursuit, et ce, jusqu'en 1926. Le franc
est donc faible face aux autres devises et la situation ne s'améliore pas vraiment car il n'y
a pas de réelle prise en main de l'économie française ; elle est mal gérée, notamment par
le Cartel des gauches.
Le Cartel des gauches est une coalition de partis de gauche (de la gauche modérée à
radicale) qui permet à la gauche de parvenir au gouvernement en 1924 alors que les
tendances politiques étaient plutôt de droite. Cependant, étant donné que le Cartel
4 En Français, « lingot d'or étalon »
5 En Français, « échange d'or standard »
4

possède une vision assez autoritaire de l'économie, en mettant notamment un impôt sur le
capital, plus personne n'ose investir en France pour éviter de subir cet impôt. La situation
dure jusqu'en juillet 1926 où le cours du franc s'effondre.
En 1926, la droite retourne au pouvoir avec Poincaré car la gauche semble, pour le peuple
et les députés, incapable de gérer un pays comme la France. Poincaré va alors tout
mettre en œuvre pour redresser la situation économique, par exemple en augmentant les
impôts indirects.
En 1928, le franc français peut ainsi être stabilisé avec un étalon-or (Gold Exchange
Standard) : 1 franc français vaut 65.5 mg d'or6.
C'est le début du grand capitalisme en France. Les industries se développent très
rapidement et la situation économique devient stable et solide : la France investit
beaucoup. En 1930, un quart des stocks d'or monétaires mondiaux lui appartiennent7.
Il faut pourtant garder en tête que cette croissance est ralentie par les problèmes des
entreprises familiales liées à la classe moyenne, de l'épargne et de la crise du logement.
La situation économique en Russie
En Russie, la guerre civile, la Première Guerre mondiale, le blocus économique et la
rigueur du communisme de guerre ôtent toute véritable économie. En effet, il n'existe plus
d'économie monétaire à l'intérieur du pays et l'on fonctionne par le troc. De plus, l'état
distribue des denrées gratuitement. Les paysans n'arrivant pas à faire fonctionner leurs
propriétés, les villes manquent de matières premières, et les usines ne fonctionnent plus :
il n'y a plus de production.
Par conséquent, à cause l'absence de circulation monétaire, et même de production, le
rouble est dévalorisé. La Russie est absente du marché international.
Pour Lénine, qui veut que la Révolution marxiste ait lieu, il faut relancer la Révolution
industrielle en Russie et redonner goût au communisme au peuple, qui était alors
synonyme de misère et de répression.
En mars 1921, lors du Xe Congrès, Lénine décide d'abandonner les méthodes brutales du
communisme de guerre et d'adopter une nouvelle politique économique. Il favorise donc le
secteur privé, avec des petites et moyennes entreprises, et met en place un secteur
socialiste où les activités économiques essentielles sont gérées par l'état (tels que les
transports, la banque, le commerce intérieur et les grande industries). Il rend aussi
possible la concurrence entre le secteur privée et le secteur socialiste.
De plus, les charges agricoles sont allégées et l'état propose des contreparties pour les
agriculteurs vendant leur surplus à l'état ou augmentant leur rendement. Ainsi, les riches
agriculteurs sont favorisés.
En Russie, on retourne progressivement à l'économie du marché avec un gouvernement
socialiste. Le commerce extérieur devient plus libre, par exemple, une usine Ford s'installe
à Gorki et une monnaie stable est crée en 1922, marquant un retour à une certaine
stabilité économique8.
De plus, le retour sur le marché international permet des accords, non seulement
commerciaux comme avec l'Angleterre et l'Allemagne, mais aussi diplomatiques qui se
mettent en place petit à petit.
6 Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, Tome 1 p.150
7 Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, Tome 1 p.152
8 Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, Tome 1 p.208-9
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%