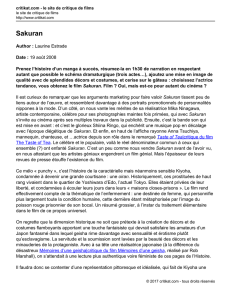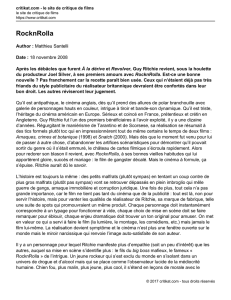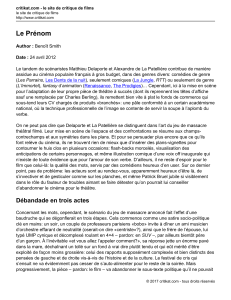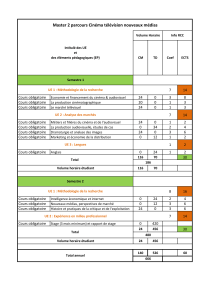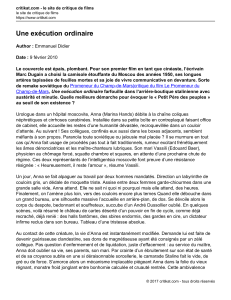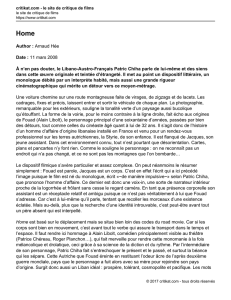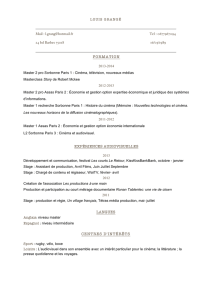Le Soulier de satin

critikat.com - le site de critique de films
le site de critique de films
https://www.critikat.com
Le Soulier de satin
Author : Mathieu Macheret
Date : 6 mars 2012
Quand Manoel de Oliveira met en boîte Le Soulier de satin de Paul Claudel, cela rend
service au cinéma comme au théâtre. Faisant feu de tous les artifices de figuration, le
cinéaste livre un rituel plein de fantaisie et de rigueur, de magie et d’escamotages, dont
l’aspect primitif renoue avec le cinéma de Méliès. À tous ceux qui ne croiraient pas encore
qu’il n’existe rien de plus beau que le théâtre filmé – et il peut l’être de mille manières –,
nous recommandons l’usage de ce DVD, dont la sortie constitue, à n’en pas douter, l’un
des événements de la semaine.
Au début du Soulier de satin, film-fleuve de près de sept heures, Lion d’or de la Mostra de Venise
en 1985, figure, avant même que l’action ne soit lancée, un bel avertissement à l’attention du
public : « C’est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, c’est ce qui est le plus long
qui est le plus intéressant, et c’est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. »
Façon élégante de nous prévenir qu’à l’entrée de ce monument, il convient de se dépouiller de
ses habitudes et d’aborder ce long tunnel avec un regard neuf. Quel monde étrange, en effet, que
celui où nous pénétrons, monde d’effigies contraintes dans leurs postures, monde coloré
d’artifices dont les rouages s’exhibent à nu, monde qui nous regarde sans effronterie et lance
vers nous ses mots de feu. Façon aussi d’éveiller en nous le sentiment d’aventure, nous qui
devons nous jeter en ce film comme sur une mer inconnue, à l’image de ses personnages
de conquistadores. Oliveira, par un anti-naturalisme tant radical qu’amusé, curieux de ses effets,
entend au sens le plus littéral le terme de mise en scène, subvertit les conventions du cinéma par
celles du théâtre et livre un film magnifique sur la conquête de soi et du monde.
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

Le Soulier de satin est une adaptation de la pièce réputée inadaptable de Paul Claudel, parue en
1929. Si l’on peut ne pas goûter à l’oeuvre de l’auteur, difficile d’échapper à la terrassante
beauté de ce texte-là – narrant l’amour contrarié de Rodrigue, vice-roi des Indes, et Doña
Prouhèze, mariée au vieillissant Don Pelage, sous la couronne espagnole de Philippe II. Texte
truffé de longs monologues, pétri de chagrin et de résignation, travaillé par de puissants appels
spirituels et la quête insatiable de personnages qui les conduit par-delà les mers, au-devant de leur
solitude. La pièce, œuvre monstre et inclassable, fascinante par ses excès, a donné du fil à retordre
à des générations de metteurs en scène. Relevant d’un baroque puissance dix, elle accumule les
difficultés – des centaines de personnages, décors vastes et variés, action éclatée qui s’étend aux
quatre coins du globe, un mysticisme déroutant, enfin, une lecture en continu qui avoisine les
douze heures – si bien qu’à ce jour, personne n’est encore parvenu à la monter dans son
intégralité. Ce statut d’Everest infranchissable n’est d’ailleurs pas étranger à sa légende.
Ce qui est beau dans l’adaptation qu’en donne Oliveira, c’est qu’à aucun moment il ne cherche à
suppléer, par les « moyens » du cinéma, aux prétendus empêchements du théâtre. Au contraire, il
rend le texte à sa destination première, aux planches, aux projecteurs, aux artifices, au maquillage,
aux oripeaux, à la déclamation, au théâtre, à ses conditions qu’il dévoile crument. Il s’agit moins,
pour le cinéaste, de filmer une représentation idéale que de plonger dans la représentation même,
dans sa matérialité, comme au plus près du texte, écrin des plus fidèles à l’histoire qu’il raconte.
On saisit ce qui, dans cette histoire, a pu captiver Oliveira, au-delà du défi cinématographique : une
coupe historique du génie explorateur portugais, la louange de ce petit bout de péninsule dont les
grand hommes ont démultiplié le monde connu, adossé à un drame de l’amour des plus curieux, à
une drôle d’histoire de lettre qui ne parvient que dix ans trop tard à son destinataire. Et ce qui
frappe le plus, dans ce film tourné en studio, c’est cette simultanéité des choses : on passe
comme de rien de l’Espagne à l’Afrique, puis de l’Italie à la Pologne, en un seul fondu, dans un
drame européen, puis mondial, grande mosaïque fragmentée qui surgit des multiples
configurations d’un même plateau. Même si le cinéaste n’a pu filmer la totalité du texte – pour
d’évidents problèmes d’exploitation – sa mise en scène se cale sur une fidélité maniaque à la
lettre de Claudel.
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

Dès la première scène, les noces du théâtre et du cinéma sont consommées. Certes, l’ouverture
dans le hall d’un théâtre, juste avant la représentation, alors que le public attend encore derrière
les portes, semble nous dire que le cinéma absorbe le théâtre. Mais c’est un ouvreur en livrée qui,
avant de laisser entrer les flots de spectateurs, entame le texte de Claudel face caméra : « L’ordre
est le plaisir de la raison. Mais le désordre est le délice de l’imagination » – la formule pourrait
d’ailleurs servir d’adage au cinéma d’Oliveira. Par la suite, une fois le public installé dans
l’orchestre, les comédiens, alignés au balcon, tous costumés, rejoignent la scène. Alors qu’un
digne gentilhomme, tout droit issu du Siècle d’or espagnol, posé sur le proscenium, contextualise
l’ouverture du drame, l’image animée d’un bateau sur mer s’affiche sur un écran blanc, posé à
ses côtés, comme la matrice de l’imagination dont il nous demande de faire preuve pour entrer
dans l’histoire. Au plan suivant, on découvre le projecteur en marche et le vaste faisceau du
lumière qui s’élance au-devant de lui. Un long travelling avant suit sa course, traverse l’orchestre
et fond sur l’écran blanc, jusqu’à en épouser le cadre. On se croyait assis sur un siège de théâtre,
mais c’est bien dans un film que nous venons de plonger.
À ce jeu de l’impureté, cinéma et théâtre ont tout à gagner. Le théâtre conquiert, par le montage,
une rapidité d’exécution inédite – pas le moindre des paradoxes pour un film aussi long : on passe
d’un tableau à l’autre par un simple fondu, qui aurait nécessité en live des heures d’installation.
L’usage du hors-champ, allié à certains angles de prise de vue, emporte la représentation
scénique vers des possibles qu’elle n’aurait pu se permettre, comme, par exemple, de
surplomber deux actrices à la nage ou, encore, de saturer l’espace d’un visage – celui de Marie-
Christine Barrault dans le magnifique monologue de la Lune. Le cinéma, quant à lui, en s’adaptant
à des codes étrangers, accueille une hétérogénéité revigorante : ici où rien ne va de soi,
l’immédiateté d’une composition frontale rend les choses perçues nouvelles et inédites. Chaque
scène correspond à un nouveau tableau et le film compte presque autant de plan que de scènes
(les coupes sont rares). Chaque tableau est organisé selon l’axe dessiné par le regard du
spectateur, vers lequel toute chose est orientée, et tend comme vers la limite du représentable.
Ainsi, les personnages, l’environnement, les objets, tous regardent vers nous, et nous sont plus
présentés qu’agencés par un découpage de l’espace auquel correspondrait l’évolution du récit.
Ici, l’espace n’est rien – le noir annihilant de la scène ou du studio – et, pourtant, il doit être tout,
car de ce vide (métaphysique du Borniol) naissent des mondes entiers, des pays, des continents,
par le statut unique que ce noir confère à chaque élément.
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

Manoel de Oliveira organise une véritable fête du regard. La picturalité des compositions évoque
les œuvres de Velasquez, du Greco, de Luis de Morales, peintres espagnols de la Renaissance,
comme si la meilleure porte d’entrée vers l’âge des conquistadores passait par les représentations
plastiques qu’il nous en reste. La peinture et le théâtre ont ceci en commun qu’ils font naître leur
monde d’une matrice vide, toile blanche ou noir de la salle. Les images planes, la mobilité
extrêmement contrainte des comédiens, l’arificialité revendiquée des décors et des mécanismes –
telle roue de moulin au loin est figurée par une hélice plantée sur une toile peinte, l’ondulation des
vagues est rendue par la rotation de gros cylindres peints en bleu – dessinent un ensemble de
formes sublimes, suite de tableaux vivants et parlants, où les couleurs éclatent, ou le texte
déclamé s’envole dans un rythme, une modulation propres à chaque comédien. Ici, c’est tout ce
qui choque l’effet de réel qui prend de la valeur ; c’est la déformation dans le mimétisme qui
assure le faux comme marchepied aux vérités invisibles ; et c’est justement toute la distance qui
sépare de la vie qui, dans le même geste, y renvoie. C’est tout le sens de l’avertissement placé
en début de film. Cette volonté de saisir la figuration dans ce qu’elle a de plus naïf, de plus primitif,
situe le geste du cinéaste quelque parte entre les toiles du douanier Rousseau et les
fantasmagories de Georges Méliès.
Il fallait bien ce magnifique écrin pour conter cette histoire d’êtres happés par leur désir, mais leur
opposant toujours un sens du devoir inébranlable, sauf en ces quelques instants fugaces où ils
cèdent – fuguant, fuyant, se dérobant, refusant un instant d’obéir. Et l’ange-gardien qui les
accompagne, devant ces pauvres marionnettes balancées par le destin, de leur lancer un regard
de pitié et d’envie mêlées.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© 2017 critikat.com - tous droits réservés
1
/
4
100%