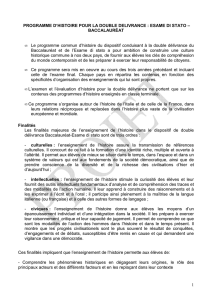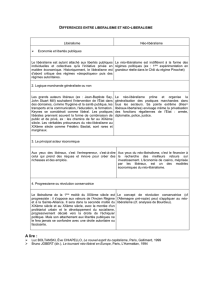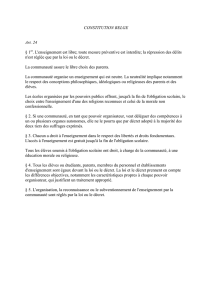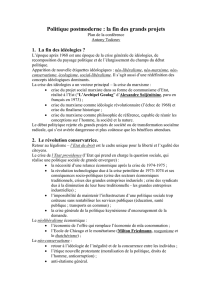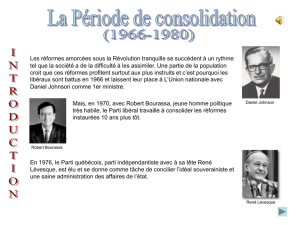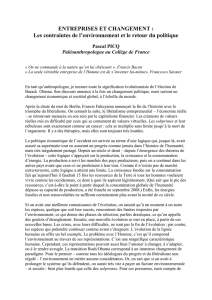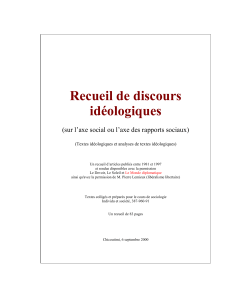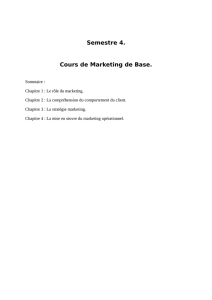Recueil de discours idéologiques - Jean

Recueil de discours
idéologiques
(sur l’axe social ou l’axe des rapports sociaux)
(Textes idéologiques et analyses de textes idéologiques)
Un recueil d’articles publiés entre 1981 et 1997
et rendus disponibles avec la permission
Le Devoir, Le Soleil et Le Monde diplomatique
ainsi qu'avec la permission de M. Pierre Lemieux (libéralisme libertaire)
Textes colligés et préparés pour le cours de sociologie
Individu et société, 387-960-91
Un recueil de 83 pages
Chicoutimi, 6 septembre 2000

Discours idéologiques, axe du social 2
Table des Matières
Table des matières
3
1. Par KOSTAS VERGOPOULOS, “ Le néo -libéralisme contre l'État ?” in LE MONDE
DIPLOMATIQUE, Paris, no 328, juillet 1981, page 30
4
2. Jules-Pascal Venne, “ Les défis actuels de la social - démocratie ” in LE DEVOIR, le 3 sep-
tembre 1983, page 13 —Idées
8
3. PIERRE LEMIEUX, “ LE NOUVEAU LIBÉRALISME — I- La souveraineté de l'indiv i -
du ”, LE DEVOIR, le 20 décembre 1984, page 9 — idées
11
4. PIERRE LEMIEUX, “ LE NOUVEAU LIBÉRALISME — II- Problématique de l’État li b -
éral ”, in LE DEVOIR, le 21 décembre 1984, page 9 — idées
1
4
5. YVES VAILLANCOURT, “ L’ILLUSION LIBÉRALE, ou la bonne exploitation d’une ph i -
losophie bon marché ”, in LE DEVOIR, 9 janvier 1985, page 8 —Idées
1
7
6. Jean Guay, Gilles Labelle et Daniel Lapointe, “ Un parti socialiste au Québec ? ”, in LE
DEVOIR, le 15 janvier 1985, page 9 —idées.
1
9
7. Rudy Lecours, “ Marcel Pepin croit être en mesure de séduire plusieurs orthodoxes
déçus ”, in Le Soleil, le 28 janvier 1985, page B-2
21
8. RUDY LE COURS, “ Pepin invite les péquistes orthodoxes à se joindre au Mouvement
socialiste ”, in Le Devoir, 28 janvier 1985, page 2
2
3
9. Denis Clerc, “ PLUS DE MARCHÉ, MOINS D'ÉTAT. Un programme pour la droite ? ”, in
Le Monde diplomatique, Paris, no 375, juin 1985, page 28
2
5
10. Réjean Lacombe, “ Pierre Marc Johnson et le virage socio - économique. Sortir de l'ère de
"l’ État-Providence"” , in Le Soleil, 14 août 1985, page B-3
2
9
11. Pierre LEMIEUX, “ L’individualisme renaît en Amérique ”, in La Presse, le 28 août 1985,
page A 7 — tribune libre
31
12. Jocelyn DUMAS, “ TABLE RONDE SUR L'ÉCONOMIE. Il faut libérer le citoyen et
l’entreprise d'un trop lourd joug fiscal et réglementaire pour régler le problème devenu
structurel de l'emploi ”, in Le Devoir, 20 novembre 1985, page 4
3
3
13. Claude Turcotte, “ Un virage dont les causes sont plus profondes qu'on le croit, e s -
time - t - on. Le monde des affaires se réjouit d'un discours économique qui valorise le rôle
du secteur privé ”, in Le Devoir, 23 novembre 1985, page 4
3
6
14. Jean-Bernard Robichaud, “ DE L’ÉTAT - PROVIDENC E À L’ÉTAT -INDIFFÉRENCE. —
“La Justice sociale ne peut pas être liée à notre capacité de produire la richesse”.”, in
Le Devoir, le 30 décembre 1985, page 7 — idées
3
9
15. René Beaudin, “ Libéralisme et néo-libéralisme. La querelle des anciens et des mode r -
nes ”, in Le Soleil, samedi 29 mars 1986, page B 3 DOSSIER
41
16. Alain Bonnin, “ Crise économique ou crise politique? Réduire le chômage tout en co m -
battant le déficit est à notre portée, mais demande du courage, ce qui manque le plus
dans nos classes politiques ”, in Le Devoir, mercredi 20 octobre 1993, page A 9 — Idées
4
3

Discours idéologiques, axe du social 3
17. Gilles Massé, “ Pierre Lemieux, anarchiste ”, in revue Jonathan, Avril 1986, pages 17 à
19. Montréal, une publication du comité Québec-Israël
4
6
18. Pierre BOULET, “ Fini l' État-Providence... le gouvernement investit dans le bénévolat.
—Des millions qui valent des milliards ”, in Le Soleil, 12 avril 1986, page B 1 Dossier
4
9
19. Pierre BOULET, “ Histoire d'une volte-face pour le moins révélatrice ”, in Le Soleil, sa-
medi 12 avril 1986, page B 1 Dossier
51
20. Pierre BOULET, “ Éviter le piège de la privatisation déguisée ”, in Le Soleil, samedi 12
avril 1986, page B 1 Dossier
5
2
21. Jean-Paul L’Allier, “ Les années qui viennent. — L’inévitable social-démocratie ”, in Le
Devoir, samedi 24 mai 1986, page A 9, des idées, des événements
5
4
22. Paul-andré COMEAU, “ BLOC-NOTES. Le débat sur le néo-libéralisme ”, in Le Devoir,
Jeudi 17 juillet 1986, page 6
5
7
23. MARCEL LÉGER, “ De L’État providence à I’État provigain... du moins pour certains ”,
in Le Devoir, vendredi 18 juillet 1986 • 7 des idées, des événements
5
9
24. Pierre-Y. LAURIN, “ Le miroir aux alouettes du libéralisme moderne ”, in Le Devoir, sa-
medi, 19 juillet 1986, page A 7 - Idées- événements
61
25. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC. — I. À l'époque où l’État
québécois jouait un rôle supplétif”, in Le Devoir, samedi 2 août 1986, A 1
6
3
26. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC. — II. Le retour du pendule:
l’attrait du recours à la privatisation ”, in Le Devoir, lundi 4 août 1986, A 1
6
6
27. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC.— III. Le modèle ontarien
vu de plus près. Le modèle ontarien: à suivre? ”, in Le Devoir, mardi 5 août 1986, A 1
6
9
28. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC.— IV. Un véritable test:
celui de l’aide sociale ”, in Le Devoir, mercredi 6 août 1986, A 1
7
2
29. PAULO PICARD, “ Compter sur ses propres moyens. — Pour le Congrès du travail du
Canada, le NPD est le seul à proposer un projet de société à tendance social-démocrate,
mais cette prise de position sera-t-elle profitable au parti le 25 octobre? ”, in LE
DEVOIR, le mardi 19 octobre 1993, page A 9 - idées
7
5
30. Bernard Élie, “ Les lois du marché ”, in Le Devoir, 11 avril 1996, page A 6 Éditorial 7
7
31. MICHEL VENNE, “ Comment le Canada tourne le dos à l'État providence ”, in Le De-
voir, Montréal, lundi 24 février 1997, page A1
7
9
32. Roch Côté, “ Perspectives — Néo-libéralisme, où es - tu ? ”, in Le Devoir, 13 décembre
1997, A1
8
2

Discours idéologiques, axe du social 4
Le Monde diplomatique, Paris, no 328, juillet 1981, page 30
Le néo-libéralisme
contre l'État ?
( Retour à la tdm )
Par Kostas Vergopoulos,
professeur de sciences économi-
ques à l'université de Paris-VIII-
Vincennes à Saint-Denis.
Les adeptes du courant dit
“néo-libéral” prétendent que cette
théorie ne s'épuise pas avec le
contrôle monétaire de l'économie:
elle comprend tout un programme
de politique économique positi-
vement concevable. Cependant,
leur interprétation de la réalité
économique et sociale se révèle
non seulement tendancieuse, mais
aussi pleine de contradictions.
Par exemple, pour M. Milton
Friedman, principal théoricien
“néo-libéral”, une société fondée
sur l'appât du gain est préférable à
une société fondée sur la faim du
pouvoir. Comme si, dans le syst-
ème capitaliste, les deux
phénomènes — gain et pouvoir—
n'étaient pas deux aspects du
même processus social ? En fait,
le profit est déjà une forme
concrète de pouvoir, de domina-
tion. La lutte pour le profit est
déjà en soi une lutte pour la do-
mination. Seuls les esprits naïfs
ou hypocrites peuvent, tout en
condamnant d'un côté la lutte
pour le pouvoir, glorifier de l'au-
tre la lutte pour le profit.
Le “néo-libéralisme” prétend
avoir un programme économique
positif. Pourtant, l’ensemble de
ses recommandations se résume
en quelques impératifs de caractère
éminemment négatif: réduire les
dépenses de l’État; réduire l'ex-
pansion de la monnaie; réduire
l'impôt sur l'entreprise, etc. Selon
son adage bien connu “tout va
bien dans l'économie tant que le
gouvernement ne s'en mêle pas”:
il paraît alors assez difficile d'ad-
mettre que les propositions “néo-
libérales” contiennent un quel-
conque élément de positivité, ou
qu'elles puissent offrir un pro-
gramme d'action économique po-
sitive.
Dans leur lutte contre l’État
keynésien, les “néo-libéraux”
développent une incroyable offen-
sive tous azimuts: tantôt ils
prétendent que cet État fonctionne
aux dépens des classes laborieuses
- et ils en appellent au peuple
pour lutter contre
l'État-providence, instrument des
riches; tantôt ils considèrent que
ce même État charge les entrepri-
ses à l’excès, compromettant ain-
si la incitations à investir - et ils
en appellent aux riches et aux pa-
trons pour lutter aussi contre cet
État. Autrement dit, face aux pau-
vres, les “néo-libéraux” présen-
tent l’État comme l'instrument
des riches, mais face aux riches,
ils le présentent comme une bu-
reaucratie parasitaire se dévelop-
pant à leurs dépens. Tous les
moyens sont bons pour susciter la
révolte générale des citoyens
“contre l'État”. Cependant, cette
révolte vise-t-elle vraiment l'État
en général ou, peut-être, seule-
ment certains de ses aspects tout
en renforçant par ailleurs certains
autres de ses aspects ?
Les “néo-libéraux” cherche-
raient à limiter, si non supprimer,
I' appareil d'État moderne tout en
gardant les structures fondamenta-
les de la société capitaliste. Or si
l'on prend un certain recul, on
constate que cet État a toujours
été la forme historique concrète
des compromis passés entre les
classes sociales. S'il y a aujour-
d'hui des lois imposant des char-
ges sociales aux entreprises ou
établissant un impôt progressif
sur le revenu, s’il y a des dépen-
ses au titre de la Sécurité sociale,
des allocations familiales, des in-
demnités contre le chômage, etc.,
il serait rigoureusement inexact de
conclure que tout cela est le fait
de l’État et de l'étatisme. En l'oc-
currence, l’État n'a fait qu'entéri-
ner les compromis passés entre
les classes sociales durant les cin-

Discours idéologiques, axe du social 5
quante dernières années. Pourtant,
les “néo-libéraux” ne veulent rien
savoir des classes, ni de la lutte
de classes, ni même de l'histoire.
Tous les acquis historiques des
travailleurs sont par eux pudi-
quement désignés comme des
“ingérences” de l’État dans l'éco-
nomie. La logique so-
cial-démocrate de l’État keynésien
qui a prévalu pendant un demi-
-siècle consistait à canaliser la
pression sociale des travailleurs
en des formes mettant en valeur la
fonctions sociales du capital et de
l'entreprise. Aujourd'hui les
“néo-libéraux”, prétendant vou-
loir libérer l'entreprise du “poids
écrasant” de l’État et de l'étatisme
ne visent en fait qu'à libérer l'en-
treprise de ses fonctions sociales
et à imposer la régression de
l'économie au royaume du despo-
tisme absolu du capital.
Le “néo-libéralisme” prône
encore les vertus du marché libre
et de la concurrence illimitée. Il
va même jusqu'à affirmer que le
marché libre constitue le seul es-
poir des pauvres pour améliorer
leur sort, contrairement au syst-
ème interventionniste actuel qui
fonctionnerait exclusivement au
bénéfice des couches supérieures.
Mais le véritable objectif de ceux
qui se réclament aujourd'hui du
“néo-libéralisme” n'est pas telle-
ment, on l'a vu, de libérer et de
renforcer la concurrence que de
libérer les entreprises en général
de leurs charges et fonctions so-
ciales. Autrement dit, le vocable
de “libéralisme” et l'éloge du
marché libre ne masquent qu'à
grand-peine une offensive généra-
lisée contre les acquis historiques
des classes laborieuses.
Ce “libéralisme” étonnam-
ment tronqué implique aussi —
contrairement aux abstractions
“néo-libérales”— une politique
étatique musclée pour assurer la
mobilisation du capital, compor-
tant notamment de multiples for-
mes de subventions à l'industrie à
l'aide des fonds de l’État. Ce n'est
sans doute pas par hasard que le
modèle de l’État despotique ja-
ponais, du temps de la dynastie
des Meiji (inaugurée en 1868)
jusqu'aujourd'hui, exerce une
séduction explicite sur Milton
Friedman, les milieux dirigeants
américains actuels et les cercles
du patronat français. Dans ces
conditions l'éloge du marché libre
ne serait qu'un simple euph-
émisme: la concurrence serait ap-
pelée à fonctionner uniquement au
niveau du marché du travail, tan-
dis que les entreprises seraient for-
tement subventionnées, directe-
ment ou indirectement, par l’État.
Enfin, lorsque le
“néo-libéralisme” présente le
marché libre comme une possibi-
lité pour la pauvres de s’enrichir,
il fait preuve d'une totale mécon-
naissance du problème de la pau-
vreté considérée sous sa dimen-
sion sociale. Il est bien évident
que la mobilité sociale des indi-
vidus ne pourra jamais supprimer
le problème des classes pauvres,
des classes qui, malgré tout, loin
d'être oisives, sont celles des pro-
ducteurs directs.
Le “néo-libéralisme” s'op-
pose aussi à la législation anti-
trust sous prétexte que le
phénomène du monopolisme ne
peut être combattu par des lois,
proposant comme solution de re-
change de renforcer les conditions
de la concurrence libre et illi-
mitée. Cependant, ce dilemme,
consistant à choisir entre les lois
antitrusts d'un côté et le renforce-
ment de la concurrence de l'autre,
est complètement fictif et imagi-
naire et, dans la meilleure des hy-
pothèses, il témoigne d’une
méconnaissance de la législation
antitrust. En effet, cette législation
n'a et ne peut avoir qu'un seul ob-
jet: la protection de la libre
concurrence. Faut-il en conclure
que les “néo-libéraux” assument
l'idée de marché libre jusqu'à ses
ultimes conséquences: jusqu'à la
cristallisation de la loi du plus
fort, la loi des monopoles ?
Dans les mêmes milieux, on
prétend expliquer l'inflation par la
quantité de la monnaie en circula-
tion. La hausse des prix dit-on,
est toujours un phénomène moné-
taire. Toutefois, il est évident que
cette “explication” se situe aux
limites de la tautologie triviale.
Si elle veut souligner que la
hausse générale des prix est un
phénomène monétaire, on obser-
vera que cette explication n'en est
point du tout une, la hausse du
niveau général des prix est un
phénomène absolument identique
à la croissance de la quantité de
monnaie en circulation. Dans la
meilleure des hypothèses, les va-
riations de la quantité monétaire
constituent tout simplement le
mécanisme technique par lequel
se réalise la hausse du niveau des
prix, mais dans tous les cas on
reste perplexe; le mécanisme est
connu, mais on ignore aussi bien
la nature que les causes de l'infla-
tion. Alors que l'inflation est, par
excellence, un problème brûlant,
avec des causes et des conséquen-
ces sociales extrêmement graves,
les “néo- libéraux” escamotent
ses véritables dimensions, se
contentant de présenter innocem-
ment le mécanisme technique de
l'inflation comme une cause.
Les tenants du “néo- libéra-
lisme” liquident la question poli-
tique et sociale; ils pensent que
ces aspects peuvent être réglés au-
tomatiquement par les mécanis-
mes du marché; M. Milton
Friedman affirme que le libéra-
lisme économique finit toujours
par rejaillir sur les structures poli-
tiques. Mais s'il en était ainsi,
comment devrait-on expliquer la
résurgence du phénomène autori-
taire qui se développe en associa-
tion avec les politiques économi-
ques “néo-libérales” dans les so-
ciétés occidentales ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%