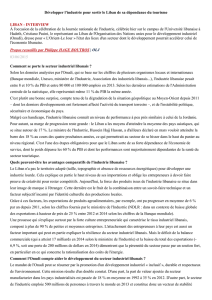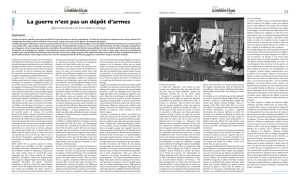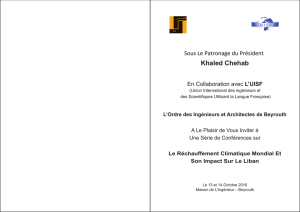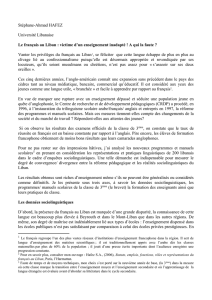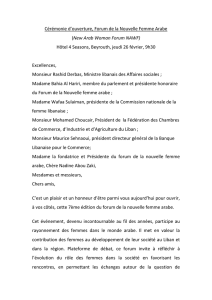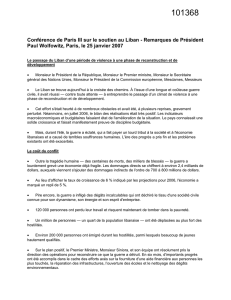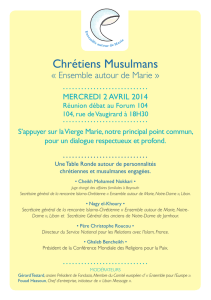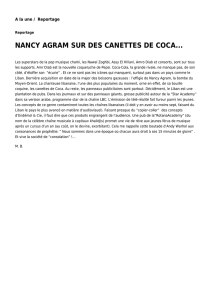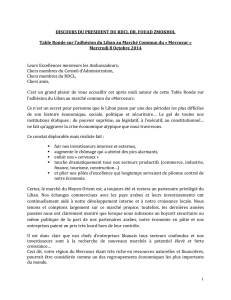Le Pouvoir économique

Le Pouvoir économique
Mohamed Choucair
EDITO
Directeur responsable Mohamad LAMAA Immeuble CCIA-BML,
Responsable de la coordination Elham RAHAL Rue 1 Justinien, Sanayeh
Rédaction Marilyne JALLAD PO Box 11 1801 Beyrouth, Liban
Conseiller économique Roger KHAYAT econews@ccib.org.lb
Maquette Integrated communications T: 01 353 390 ext: 162
Certaines vérités sont si simples, fonda--
mentales, que lorsqu’on les entend pour
la première fois on a l’impression de les
avoir toujours sues. Ainsi, «en se focali-
-
sant sur la dette publique, on s’intéresse
aux conséquences et on oublie de traiter
les causes… un compte courant forte-
-
ment (et structurellement) déficitaire si-
-
gnifie qu’il y a un problème de producti-
-
vité, et que l’économie perd les moyens
qui lui sont nécessaires pour croître, en-
-
granger des recettes publiques, et donc
à terme, sortir de la spirale de la dette».
(Alain Bifani, L’Orient-Le Jour, 15 août
2012). Pour en sortir, un seul moyen,
restaurer la productivité de l’économie.
Un pays qui importe des biens et ser-
-
vices au-delà de ce qu’il exporte, va
connaître un déficit. Peu importe si ce
déficit est comblé ou non au niveau de la
balance des paiements, il se traduit par
une réduction de la production locale et,
par conséquent, des opportunités d’em-
-
plois. Réciproquement, un pays qui re-
-
çoit un excès de transferts va en assurer
l’usage, ce qui augmente la propension
marginale à importer. Cela se traduit par
un plus grand déficit du compte cou-
-
rant. C’est ce cas qui caractérise surtout
l’économie libanaise.
Or une explication n’est pas nécessai-
-
rement une justification; et la faiblesse
de la productivité n’est pas fatalement
la conséquence de hauts salaires. La
productivité est définie en valeur de
production par unité de travail et/ou
capital affectée à cette production.
Autrement dit la productivité locale est
à la base de la compétitivité, de la de-
-
mande et de l’équilibre (ou du surplus)
du compte courant.
Restaurer la productivité au Liban est à
la fois une chose très complexe et très
possible. Très possible, car les Libanais
qui s’expatrient chaque année sont la
preuve de l’existence pléthorique de
compétences pour assurer la mutation
de l’économie libanaise. En revanche,
très complexe car les investissements
directs étrangers (environ 14% du PIB)
ainsi que l’épargne en quête de place-
-
ments ne trouvent d’emploi que dans
les projets fonciers et la promotion
immobilière. Ainsi, le pays n’a de ce
fait jamais pu canaliser les investisse-
-
ments vers l’économie de production.
Il est plus difficile d’en connaître la rai-
-
son que de constater les faits.
Le climat n’est pas favorable à l’inves-
-
tissement. Disons-le tout de suite, ce
ne sont pas les charges qui constituent
le principal handicap, l’Etat a fait beau-
-
coup d’efforts pour éviter la hausse
des taxes et des charges sociales mais
l’entreprise au Liban n’est pas renta-
-
ble, et l’entreprise qui choisit le Liban
comme centre régional n’est pas heu-
-
reuse non plus, et le désaffecte pour
des cieux plus cléments. Ce n’est pas
la sécurité non plus, ici ce n’est pas la
joie, mais ailleurs ça peut devenir une
véritable désolation. Depuis 2005, le
Liban a montré sa capacité hors du
commun à empêcher les dérives sécu-
-
ritaires. L’Europe l’a compris, et aucun
Européen n’hésite à venir aujourd’hui
au Liban.
L’annulation des taxes directes et in-
-
directes prévues dans le budget, qui a
largement satisfait l’opinion publique,
a eu un effet dévastateur sur l’investis-
-
seur qui ne vit pas au jour le jour mais
dans ses anticipations du futur. «Si on
a évité la surtaxe aujourd’hui, on n’y
échappera pas demain, trouvons un
climat plus favorable à nos investisse-
-
ments». De même pour la limitation du
financement de la holding. Le décret
est annulé, mais pas ses effets. La sta-
-
bilité fiscale est la clef de voûte de l’in-
-
vestissement. Est-il possible que cela
échappe au gouvernement?
Sur le plan de la rentabilité, il faut, je
pense, mieux écouter les secteurs éco-
-
nomiques et les organisations qui les
représentent. L’Etat écoute parfois un
investisseur privé, mais c’est la croix et
la bannière quand il s’agit d’un secteur
qui veut faire prévaloir ses intérêts ou
même ses nécessités pour produire ra-
-
tionnellement.
Une solution?
Confier le pouvoir économique au sec-
-
teur privé, i.e. les chambres de commer-
-
ces, les associations professionnelles, et
le Conseil économique et social.
L’ÉCONOMIE LIBANAISE &ARABE
ECO NEWS
Numéro 12
Septembre 2012
Publication
«CCIA-BML»
www.ccib.org.lb
tical stability. The lack of reliable elec--
tricity acts as a constraint on business
and prevents economic diversification.
The state-owned Electricité du Liban
(EDL) is heavily subsidized, claiming
20% of the annual state budget. Re-
-
ducing state transfers would therefore
free expenditures for other govern-
-
ment priorities, such as education,
social security, and debt servicing. A
better electricity supply would consi-
-
derably improve the daily life of citi-
-
zens. It would also avoid deepening
the social inequalities that the failing
electricity system exacerbates. Finally,
a meaningful reform would reduce oil
dependence and put the country on
a more environmentally sustainable
path. Improving the electricity supply
also has potential political implica-
-
tions. It could help strengthen the cre-
-
dibility of the state and its institutions
by delivering a critical public service.
It could also be conducive towards po-
-
litical consensus on the future of the
country’s political and economic re-
-
form. The lack of reform could result
in unrest similar to that occurring in
January 2008, when demonstrators
demanded better electricity service.
What is the lebanese electricity di--
lemma?
The costs of an inefficient electricity
system are a major burden for the
economy, the state, and its citizens.
However, the electricity issue is mar-
-
Electricity reform is one of Lebanon’s
greatest challenges. The failure to
ensure reliable electricity supply is a
symbol of the Lebanese state’s long-
standing crisis, and is closely linked
to the shortcomings of its political
system. An improvement in electricity
services would send a strong message
that the state is able to support the
economic development of the country
and positively impact the everyday life
of its citizens. Electricity reform is a
multi-dimensional process. In addition
to technical solutions, reform requires
building support coalitions among the
country’s political leadership and civil
society. Considerable investments are
necessary and would require the invol-
-
vement of the state, private sector, and
international donors. An ambitious re-
-
form program could set an example
for the rest of the region, also tackling
electricity challenges.
Why does electricity reform matter?
Electricity reform is a crucial part of
Lebanon’s economic, social, and poli-
-
ECO
NEWS est disponible sur: www.ccib.org.lb
Electricity Sector Reform in Lebanon:
Political Consensus in Waiting
Excerpt from the study “Electricity Sector Reform in Lebanon:
Political Consensus in Waiting” by Katerina Uherova Hasbani,
policy energy expert, CDDRL, Stanford, December 2011.
PROJET

Après cinq an--
nées passées
au Liban en
tant qu’am-
-
bassadeur de
l’Uruguay, Jor-
-
ge Luis Jure
Arnoletti nous
fait part de son attachement à
cette terre qu’il quittera dans
quelques mois pour un retour
aux sources uruguayennes à
la fin de sa mission diplomati-
-
que. C’est avec passion et sin-
-
cérité qu’il a bien voulu parta-
-
ger avec Econews son regard
sur les relations économiques
entre l’Uruguay et le Liban et
l’avenir de cette coopération
ancestrale.
L’Uruguay a célébré l’année der--
nière son bicentenaire. Son histoire
a été marquée par des moments
difficiles, avec notamment la crise
économique du début des années
2000. L’Uruguay affiche aujourd’hui
une croissance de près de 5%. Com--
ment maintenir cet indice dans le
contexte de récession économique
actuel?
En effet, l’Uruguay a traversé une cri--
se économique entre 2001 et 2002,
conséquence d’une crise régionale,
elle-même entraînée par la dévalua--
tion du real (la monnaie brésilienne)
et la grande crise de 2001 en Argen--
tine. En 2001, le commerce s’est
beaucoup réduit entre les pays du
MERCOSUR (marché commun entre
l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le
Paraguay), et cette année là, les dé--
pôts bancaires ont chuté de 50%.
L’ÉCONOMIE LIBANAISE &ARABE
ECO NEWS
demonstrate lack of confidence in their
government and its proposed measures.
Industry representatives are reluctant to
get involved in a more intensive dialogue
addressing the decision makers. The re-
-
gional geopolitical situation acts as an
aggravating factor for diversification of
Lebanon’s gas and electricity supplies.
Meanwhile, the country’s economy and
state finances are greatly exposed to vo-
-
latility of international oil prices.
What is the way forward?
Any meaningful steps towards practical
changes to the Lebanese electricity sec-
-
tor will require a combination of short-
term measures and long-term policy
planning by the Government of Leba-
-
non; participation of the private sector;
involvement by civil society; and assis-
-
tance from international donors. There
is a unique opportunity to build on the
agreement reached by the current go-
-
vernment based on the 2010 Policy Pa-
-
per for the Electricity Sector and deliver
concrete results in the implementation
of the proposed infrastructure projects
and reform measures.
In the short term, the scope of the Po-
-
licy Paper should be reduced to a res-
-
tricted number of immediate measures
that realistically lie within the reach of
the government. These should focus on
identifying financing options for building
up the country’s electricity generation
capacity over the next four years in line
with Law No. 181 of 5 October 2011,
bolstering the natural gas supply throu-
-
gh pipeline or LNG and implementing
supportive measures for energy efficien-
-
cy, and increasing the use of renewable
energy. In parallel, a consultative forum
should be created to guarantee an ade-
-
quate space for broader public consulta-
-
tion on the future energy strategy for the
country, including electricity reform.
In the long term, Lebanon requires a
comprehensive, national energy stra-
-
tegy. This should encompass electricity,
oil, gas, and renewable energy, and be
built around the principles of a diversi-
-
fied energy mix, environmental sustai-
-
nability, and social and economic de-
-
velopment. Such a strategy should be
based on solid statistical evidence and
the assessment of the country’s energy
landscape. It should outline a compre-
-
hensive legislative and regulatory fra-
-
mework and an adequate institutional
set-up, identifying medium- to long-
term energy policy objectives taking
into consideration other sectors’ energy
needs. The new energy strategy should
be developed through a process of pu-
-
blic consultation. With respect to electri-
-
city, the strategy should address the ma-
-
jor factors that have been hampering the
electricity reform process while building
on the 2010 Policy Paper for the Electri-
-
city Sector. In addition to addressing the
sector’s restructuring and the future of
EDL, it should also cover the situation of
backup generators, encourage more res-
-
ponsible energy-demand management
and improved energy efficiency, and fa-
-
cilitate use of renewable energy as per
international trends and standards.
ginalized in the public debate and
renders progress of the reform extre-
-
mely challenging. The level of electri-
-
city supply is inadequate for a country
classified as being upper-middle in-
-
come. On average, citizens experience
six hours of blackout per day. The sta-
-
te-run EDL provides only part (75%) of
the country’s electricity needs despite
its monopoly on state electricity pro-
-
duction. The rest is supplied through a
network of private backup generators.
EDL collects bills for only 60% of elec-
-
tricity production due to illicit practices
in its network. Furthermore, the state
budget transfers $1.5 billion annually
to EDL in order to maintain at least the
current level of service, while backup
generators cost the consumers $1.3
billion per year.
The status quo benefits a restricted
circle of intertwined economic and
political interests. These interests fur-
-
ther undermine the advancing of a
necessary reform that would improve
the electricity service for the econo-
-
mic benefit of Lebanon and its citi-
-
zens. The political situation, clouded
by disagreements among Lebanese
politicians, does not provide adequate
conditions for reform. More impor-
-
tantly, the extreme polarization of Le-
-
banese political life is such that core
economic and social issues, such as
electricity supply, are marginalized in
public debate. Given the primacy of
communitarian allegiances of Leba-
-
non’s citizens, bottom-up pressure is
reduced to a minimum and is insuffi-
-
cient for a substantive change to take
place.
What are the obstacles to be over--
come?
A successful reform needs to address
the roots of the failure and suggest
technical solutions that will gather
the support of all stakeholders. EDL
was created in the 1960s from a frag-
-
mented system of local and regional
electricity concessions. The outbreak
of the Civil War in 1975, however, pre-
-
vented the company’s consolidation
and resulted in deterioration of its ma-
-
nagement and infrastructure. Over the
past two decades, governments pre-
-
sented several reform plans. External
consultants identified technical recom-
-
mendation. New pieces of legislation
were adopted. Despite suggestions,
the government properly implemented
only few measures. Several obstacles
stand in the way of Lebanon’s electrici-
-
ty reform. Consensus is necessary but
difficult to reach given the permanent
state of deal making between politi-
-
cians. There is a broken link between
the political representatives and their
constituencies when it comes to un-
-
derstanding and accommodating the
necessary elements of reform. Infor-
-
med public debate about the challen-
-
ges and issues related to electricity re-
-
form, such as privatization, is lacking.
Local non-governmental organizations
(NGOs), usually very vocal, remain sur-
-
prisingly timid as Lebanese citizens
JURE:
«Le Moyen-Orient et l’Amérique latine ont besoin d’un
point d’ancrage stable et propice à la démocratie»
PROJET
L’Uruguay a assisté à une chute de
la croissance économique de 2002
à 2003. L’année 2003 a été marquée
par un équilibre, et dès 2004 il y a eu
un rebond de la croissance qui s’est
poursuivi jusqu’à maintenant. Effecti--
vement, l’indice de croissance annuel
se situe entre 6% et 7%. Cela est dû à
plusieurs facteurs, un contrôle fiscal
et budgétaire d’une part, mais aussi
une réaction rapide du gouvernement
au tout début de la crise en 2001,
ce qui a permis d’éviter la faillite. De
plus, nous avons payé nos dettes en
respectant les échéances financiè--
res imposées par le Fonds Monétaire
International (FMI), la Banque mon--
diale et les pays créanciers qui nous
ont accordé des prêts (bon, stocks
et bons du trésor). Cela a joué en fa--
veur du redressement économique de
notre pays, nous n’avons pas perdu
la confiance internationale même
au plus fort de la crise économique
que traversait l’Uruguay. Je tiens à
signaler que cette crise était la plus
sévère que l’on ait connu depuis
1929. Même lors de la crise finan--
cière internationale de 2007-2008,
l’impact sur notre économie est resté
minime et nous avons, tout comme le
Liban, pu rester une place financière
forte grâce aux normes très strictes
de notre secteur bancaire. C’était
aussi l’époque où les marchés inter--
nationaux avaient fixé des prix élevés
sur les matières premières (graines,
viandes, lait, maïs, soja, blé et riz)
ce qui nous a permis d’exporter nos
produits à des prix plus élevés. Pour
garder cet indice de croissance, nous
avons mis en place un plan d’action
qui s’est traduit par un maintien de
la réduction des dépenses publiques
et une diversification de nos secteurs
d’exportation - l’Uruguay est devenu
un grand exportateur de pâte à pa--
pier mais aussi, ces dernières années,
de produits laitiers, de software, de
médicaments et de services. La dis--
Page.2 Septembre 2012
INTERVIEW

Septembre 2012 Page.3
uruguayens, les seuls ressortissants
hors pays arabes à avoir été convié
à la Conférence arabe sur les inves--
tissements. L’événement a été orga--
nisé par l’Union
Générale des
Chambres de
Commerce des
pays arabes,
dont Adnane
Kassar est le pré--
sident. Cette ini--
tiative met en lu--
mière l’envie de
développer une
coopération plus
grande et plus
efficace entre nos deux pays.
La Chambre de commerce, d’indus--
trie et d’agriculture de Beyrouth
et du Mont-Liban et l’Union des
exportateurs d’Uruguay ont signé
un accord de coopération en sep--
tembre 2011 afin de développer les
échanges économiques bilatéraux.
Que pouvez-vous nous dire sur le
chemin qu’a fait cet accord?
Pour l’instant, cet accord a été sur--
tout suivi par des échanges d’infor--
mations entre les deux chambres. On
espère recevoir très prochainement
une délégation libanaise d’entrepre--
neurs en Uruguay.
Dans ce contexte de crise économi--
que mondiale, pensez-vous que la
résilience de l’économie libanaise,
grâce notamment à son secteur
bancaire stable, soit un facteur dé--
terminant pour attirer les investis--
seurs uruguayens au Liban?
Tout à fait, et cela doit être souli--
gné, car même au pire moment de
la crise financière internationale de
2008, l’économie libanaise est pres--
que la seule parmi les pays arabes à
avoir sauvegardé et protégé le niveau
de son secteur bancaire. Ce facteur
devrait suffire à attirer l’intérêt des
investisseurs uruguayens pour déve--
lopper des relations commerciales.
Les importations uruguayennes du
Liban ont totalisé 41,5 millions de
dollars en 2010, contre 58,1 mil--
lions en 2009. Les exportations
libanaises vers l’Uruguay ont at--
teint 92,649 dollars en 2010 contre
67,165 dollars en 2009. Quelles
sont vos prévisions pour 2012?
Les importations libanaises depuis
l’Uruguay étaient jusqu’en 2010
concentrées à plus de 90% sur le
bétail. A partir de 2011, il y a eu un
changement important car les expor--
tations uruguayennes de bovins et de
vaches se sont dirigées vers d’autres
marchés plus lucratifs comme la
Turquie. Les importateurs libanais
ont préféré acheter de la France à
des prix préférentiels et donc moins
chers. Quant aux ventes libanaises
cipline financière de nos institutions
et la confiance que nous témoigne les
organismes internationaux nous ont
permis de sortir de la crise qui tou--
chait beaucoup
d’autres pays.
Concernant no-
-
tre bicentenaire
célébré en 2011,
il nous a permis
d’évoquer l’an--
née 1811, qui
marque la pre--
mière révolution
des Uruguayens
pour la marche
vers la souve--
raineté. Après des années de lutte
et d’alliances nous avons finalement
obtenu notre indépendance, pour
assurer la souveraineté longuement
cherchée en 1830. Ce bicentenaire
a surtout été une occasion de saluer
la mémoire, l’histoire, l’identité et le
chemin parcouru par l’Uruguay.
L’Uruguay et le Liban sont deux
pays jeunes, petits, dynamiques,
qui jouissent d’une façade maritime
avec une population d’environ 3
millions et demi d’habitants. Quels
sont les autres points communs
entre nos deux pays?
L’Uruguay et le Liban sont deux pays
qui s’appuient dans leurs relations
respectives mais l’un comme l’autre
regarde ailleurs. Nous étions appe--
lés la Suisse de l’Amérique latine,
tout comme le Liban était qualifié
de Suisse du Moyen-Orient. Le Liban
est considéré comme un pont reliant
l’Orient à l’Occident et l’Uruguay
comme un pont reliant l’Europe à
l’Amérique latine. Nos deux pays ont
aussi une position géographique stra--
tégique: l’Uruguay se situe au milieu
d’une région commerciale et écono--
mique très dynamique qui comprend
São Paolo, Buenos Aires, Santiago
et Asunción; le Liban à la porte du
Moyen-Orient. Nos secteurs bancai--
res sont tous les deux forts, stables
et bien disciplinés. Sans oublier, bien
entendu, les ports de Beyrouth et de
Montevideo qui desservent chacun
des régions et points stratégiques.
Que pouvez-vous nous dire sur
la coopération économique entre
l’Uruguay et le Liban?
Il reste encore beaucoup de travail
à faire. Nos liens économiques sont
pour l’instant limités mais des ef--
forts se font pour mieux se décou--
vrir mutuellement et pour explorer
des possibilités d’échanges futurs.
On peut souligner les efforts et la
bonne volonté de nos gouvernements
et chambres de commerce respec--
tifs pour développer notre coopéra--
tion économique. L’année dernière,
l’Ambassade de l’Uruguay au Liban a
reçu une délégation d’entrepreneurs
INTERVIEW
...Nous étions appelés
la Suisse de l’Amérique
latine tout comme le
Liban était qualié de
Suisse du Moyen-Orient.
vers l’Uruguay, elles se sont concen--
trées depuis des années vers le ta--
bac, les tapis et quelques machines.
Les échanges vont se poursuivre de
façon stable et l’Uruguay va continuer
à vendre un peu de viande, de bétail,
de poisson et de lait en poudre. Et les
Libanais de leur côté, vont poursuivre
leurs exportations et ventes de tapis
et de tabac.
L’Uruguay est une porte d’entrée
pour les produits libanais en Amé--
rique latine, et inversement le
Liban un hub vers les pays arabes.
Quel est actuellement le contenu
des échanges commerciaux entre
nos deux pays (valeur, volume, sec--
teurs)?
Nous espérons diversifier nos échan--
ges commerciaux et il y a un fort in--
térêt côté libanais pour nos produits
laitiers, la viande, la cellulose (pâte à
papier) et les médicaments. Du côté
uruguayen, nous avons commencé à
acheter du Liban des faux bijoux, des
accessoires et vêtements féminins.
Nous pensons qu’il y a de bonnes op--
portunités pour des franchises liba--
naises, en particulier au niveau des
nourritures rapides traditionnelles
qui ouvriraient en Uruguay. Pour leur
part, les Libanais devraient explorer
les marchés du luxe en Uruguay. A
titre d’exemple, Puntas Del Este est
reconnu comme le Saint-Tropez de
l’Atlantique Sud, au Brésil, en Argen--
tine et en Uruguay.
L’Uruguay a été l’un des premiers
pays à établir des relations diplo--
matiques avec le Liban. Quel est
le poids des Libanais résidant en
Uruguay?
Nos relations diplomatiques avec le
Liban remontent à la période du Man--
dat français, dans les années 1920.
En 1924, nous avons établi un consu--
lat honoraire, devenu en 1928 un
consulat de carrière. En 1945, suite à
l’indépendance du Liban, nous avons
ouvert notre première ambassade à
Beyrouth, et en 1964 le Liban inau--
gurait à son tour sa première ambas--
sade en Uruguay. Pour recenser la
population libanaise résidant en Uru--
guay, nous remontons jusqu’à la troi--
sième génération de descendants. 70
000 Libanais résident actuellement
en Uruguay. Ils représentent la troi--
sième communauté implantée dans
notre pays, après les Italiens et les
Espagnols. Les Libanais étant un peu--
ple très adaptable qui s’intègre vite
et bien dans le pays d’accueil, nous
ne pouvons pas parler d’une commu--
nauté fermée. Cependant, on compte
près de 15 associations en Uruguay
représentant les Libanais. En 1968,
le vice-président de la République
était originaire de Koura au Liban, de
la famille Abdallah. Nous avons éga--
lement eu de nombreux sénateurs et
députés d’origine libanaise. En 2011,
notre président de la Cour suprême
de justice était aussi d’origine liba--
naise, de la famille Chidiac. On peut
également citer beaucoup de com--
merçants et d’artistes reconnus, no--
tamment deux peintres des familles
Saadé et Sfeir qui ont exposé le mois
dernier aux Souks de Beyrouth. Un
grand sculpteur, Adela Neffa, a offert
une sculpture à la municipalité de
Zouk-Mikhaïl dont elle est originaire.
Dans le contexte politique tumul--
tueux des révolutions arabes, et
plus particulièrement de la crise
syrienne, comment remédier à la
fragilisation du climat d’investisse--
ment au Liban?
Comme nous avons été touchés par
la crise argentine de 2002, et aupa--
ravant par celle du Brésil en 1998, et
comme nous nous en sommes sortis,
nous espérons que la crise syrienne
ne va pas endommager l’économie
libanaise ni sa stabilité, à la fois poli--
tique et sécuritaire. Le Moyen-Orient,
tout comme l’Amérique latine, ont
besoin d’un point d’ancrage stable et
propice à la liberté et à la démocratie
sur lequel s’appuyer.
La confiance des investisseurs uru--
guayens dans l’économie libanaise
est-t-elle toujours au beau fixe?
Nous dirons que oui, l’Uruguay a tou--
jours un intérêt porté sur le Liban et
la preuve est que notre ambassade
va bientôt recevoir une délégation
des représentants du secteur du tou--
risme uruguayen pour dynamiser les
relations et voyages touristiques en--
tre nos deux pays.

L’ÉCONOMIE LIBANAISE &ARABE
ECO NEWS
Le volume du marché de la fran--
chise au Liban est estimé à 4
milliards de dollars en 2010,
soit environ 10% du PIB. Depuis
près de dix ans, la franchise ne
cesse de se développer. Et le
nombre de franchisés est pas-
-
sé d’une dizaine en 1990 à près
de 200 actuellement.
Les créneaux existant dans les dif--
férentes activités de la franchise
(alimentation-restauration, grande
distribution, habillement-mode-beau-
-
té, hôtellerie, etc.) constituent des
secteurs importants de développe-
-
ment pour les franchiseurs français
et étrangers. En effet, les franchises
étrangères sont toujours recherchées
par les investisseurs libanais, princi-
-
palement intéressés par les enseignes
de renommée internationale, puisque
les consommateurs attachent une
grande importance à la notoriété de
la marque, surtout chez les jeunes gé-
-
nérations. Quant aux franchiseurs, on
observe que plus d’une trentaine de
marques libanaises, la plupart dans le
secteur de l’alimentation, ont su créer
des concepts suffisamment porteurs
pour espérer un succès à l’internatio-
-
nal de leur franchise. Pour n’en citer
que quelques-unes: Patchi, Casper &
Gambini’s, Crepaway, Al Rifai, Kabab-
ji, La Maison du Café, Rectangle Jaune,
etc. L’Association libanaise de la fran-
-
chise (LFA), représentée par Charles
Arbid et partenaire de la Fédération
française de la franchise (FFF) depuis
2006, regroupe actuellement plus de
180 enseignes de franchises.
Les franchisés au Liban
La majorité des grandes enseignes
internationales sont aujourd’hui pré-
-
sentes à Beyrouth. Les premières
franchises se sont installées vers la
fin des années 1990. Comme pres-
-
que partout dans le monde, les chaî-
-
nes de fast food, dont le succès est
intimement lié au concept de réseau
en franchise, ont d’abord inondé le
marché libanais, avec notamment
l’ouverture du premier Mc Donald’s
en septembre 1998 à Dora. Le choix
d’une enseigne est toujours lié à sa
notoriété et à sa capacité à s’intégrer
dans le marché local. «Le concept Mc-
-
Donald’s, c’est le burger numéro un
dans le monde, qui a construit au fil
des années une confiance et une fidé-
-
lisation du consommateur qui s’y rend
pour manger les yeux fermés», affirme
son directeur général Rashwan Mik-
-
nas. Mais pour ce dernier, l’implanta-
-
tion de McDonald’s ne pouvait se faire
sans prendre en compte le goût du
consommateur local. Le slogan adop-
-
té par la maison mère «Think global,
act local» (penser global, agir local),
ajoute donc au succès local de l’ensei-
-
gne. «Afin de nous adapter au marché
libanais, nous avons notamment créé
le «McArabia Chicken», un sandwich
avec du pain arabe dans lequel on
peut savourer un poulet à l’ail et aux
tomates-mayo. Il a fallu cinq ans de
préparation car c’est de la production
de masse. McDonald’s est le premier
dans le monde à jouir d’une véritable
présence locale, proche de la commu-
-
nauté et des gens. Je ne peux pas diri-
-
ger McDonald’s au Liban sans penser
libanais», précise Rashwan Miknas.
Pour Raef Letayf, gérant de l’enseigne
PAUL qui a ouvert ses portes à Gem-
-
mayzé en février 2002, «PAUL offre
une gamme de produits qui étaient
peu représentés sur le marché local
tels que le pain artisanal, les tourtes,
les tartines, etc.». «Nous avons élargi
le menu en le modifiant pour mieux
l’adapter au goût du consommateur
libanais; par exemple, nous avons in-
-
clus le thym comme saveur dans les
pains et dans nos recettes», poursuit
Raef Letayf. Christine Sfeir a obtenu
la franchise de Dunkin’ Donuts pour
le Liban en 1998. La directrice géné-
-
rale gère ainsi directement les trente
points de vente de la marque au pays
du Cèdre. «Le choix de Dunkin’Donuts
s’est fait car c’est une marque amu-
-
sante qui repose sur deux principaux
produits, les donuts et le café, affirme
Christine Sfeir, nous avons estimé que
ce serait un lieu de rencontre adéquat
pour les jeunes libanais». «Certains
produits sont des produits standard
qui figurent sur les menus de toutes les
branches à travers le monde, d’autres
sont spécifiquement créés pour le
marché libanais», ajoute la directrice.
L’implantation d’une franchise ne peut
se faire sans une étude approfondie
de la part des deux partenaires. Pre-
-
mièrement, en termes de contrat: le
contrat de franchise spécifie sa durée,
les clauses financières, les normes
imposées par la maison mère ainsi
que le plan de développement de la
marque. Les clauses financières sont
généralement régies par un système
de droits d’entrée (une somme à ver-
-
ser pour l’implantation de la marque)
et des royalties: le franchiseur fixe un
pourcentage du chiffre d’affaire que
le franchisé devra lui verser annuel-
-
lement. «Mais un contrat c’est tout
d’abord choisir des partenaires, et la
réussite d’une franchise se fait dans
la réciprocité», certifie le directeur
général de l’enseigne McDonald’s au
Liban. La plupart des franchisés in-
-
terrogés représentent la marque pour
tout le territoire libanais et ne peuvent
accorder de sous-franchise, ce qui fait
d’eux des «master-franchisés». Deuxiè-
-
mement, les normes à respecter par
les franchisés sont souvent très stric-
-
tes puisqu’elles garantissent et protè-
-
gent l’image de marque de l’enseigne.
Pour le gérant de l’enseigne PAUL, «les
normes de la franchise exigent une
décoration d’ambiance, les mêmes
recettes de boulangerie applicables à
tous les franchisés et des normes bien
précises en termes d’hygiène». Du
côté de McDonald’s, «les normes sont
basées sur des codes QSCV (Quality,
Service, Cleanless and Value). Elles
sont très scrupuleuses en termes de
produit, de nourriture, de location, de
décoration, souligne Rashwan Miknas.
Quant aux exigences liées à la qualité
des produits, elles varient souvent
d’une enseigne à l’autre. «Une par-
-
tie de nos produits sont importés et
d’autres sont produits localement»,
affirme Christine Sfeir. «Nous devons
répondre à un certain nombre de cri-
-
tères et de spécifications techniques
pour sélectionner nos fournisseurs»,
précise-t-elle. L’enseigne PAUL est par
exemple obligée d’importer les matiè-
-
res premières comme la farine pour
des raisons de qualité et d’identité de
la marque. «Nous établissons une en-
-
tente commune avec la maison mère
pour le choix des produits locaux et de
nos fournisseurs», précise Raef Letayf.
Du côté de McDonald’s, on importe la
viande et les pommes de terre car le
Liban n’est pas un pays fournisseur.
«Les fournisseurs avec lesquels on tra-
-
vaille localement, régionalement et à
l’international nous sont suggérés par
la maison mère et notre bureau régio-
-
nal de Dubaï, dans un listing de noms
exclusifs», indique Rashwan Miknas.
Le plus important pour la plupart des
franchiseurs est l’emplacement de
l’enseigne. «La localisation, c’est la
clé pour n’importe quel business flo-
-
rissant», indique le directeur général.
«Prenons à titre d’exemple, un lieu
ouvert dans un mall, même si le loyer
est très cher, l’affluence est pratique-
-
ment garantie, explique-t-il, le client
McDonald’s est un consommateur
spontané, des facteurs comme la faim,
l’humeur et le budget primeront donc
dans son choix». Les franchiseurs ap-
-
portent également leur aide au niveau
du développement de l’enseigne mais
chacun à sa manière. Dans le cas de
Dunkin’Donut, «l’aide apportée par la
maison mère se fait au niveau de la
mise en place du système, des procé-
-
dures, des recettes et des formations
apportées aux employés», affirme
Christine Sfeir. «Les plans d’aménage-
-
ment et les normes de décoration nous
sont communiqués de l’extérieur et la
maison mère était présente le jour de
l’ouverture pour nous assister au ni-
-
veau opérationnel», poursuit le gérant
de PAUL. Chez McDonald’s, la maison
mère favorise le travail d’équipe tout
en apportant son soutien et son ex-
-
pertise. «Du mois d’août au mois d’oc-
-
tobre, nous établissons un planning
pour les 25 branches présentes au
Liban en collaboration avec la maison
mère, explique de son côté Rashwan
Miknas, ce processus baptisé «3-1-Q»
prévoit un planning sur trois ans».
Parallèlement, des «fast-retails» ont
emboîté le pas aux franchises. C’est le
cas de ces chaînes de vêtements du
type Zara ou Mango, deux franchises
du groupe Azadea aujourd’hui présen-
-
tes dans toutes les régions du Liban.
Comme Azadea, ABC et Abchee (BHV-
Fauchon) font partie de ces grands
groupes qui trustent les contrats avec
les grandes marques internationales.
Tous les franchisés interrogés sont
d’accord pour affirmer que la difficulté
majeure en tant que franchisé au Liban
est plutôt liée à la situation sécuritaire
du pays qui empiète sur leur bien-être
en les empêchant de faire des projets
à long-terme. Malgré cette situation,
les franchises se succèdent. Parmi
les nouveaux arrivants, on compte la
prestigieuse enseigne de luxe Hermès,
le restaurant Momo géré par le groupe
Hospitality Service (Solidere) ou enco-
-
re le restaurant gastronomique STAY,
fameux de par la réputation de son
chef étoilé Yannick Alléno (Hôtel Meu-
-
rice). Pendant ce temps, PAUL pour-
-
suit son expansion avec l’inauguration
le 16 août dernier d’un sixième res-
-
taurant lors de l’ouverture du «Mall»,
sa toute dernière enseigne.
STRUCTURE COMPETITIVE
Les franchises au Liban:
un marché dynamique et en pleine expansion
Page.4 Septembre 2012
è

Septembre 2012 Page.5
Quand les Libanais se franchisent
Créer un concept nécessite de bien
connaître le marché local et ses besoins
en vue d’avoir une idée ingénieuse ou
innovante. Le slogan qui permet d’at-
-
tirer et de fidéliser le consommateur
a également sa place dans la réussite
d’une enseigne. Georges Najjar, fonda-
-
teur et PDG du concept La Maison du
Café explique que l’idée de sa création
est née d’une polémique autour de la
marque de café Najjar. «Préparer un
bon café nécessite tout un rituel, mon
père Michel avait créé cette marque de
café en 1957. Il était nécessaire d’ac-
-
tualiser son goût», affirme Georges
Najjar, précisant que sa femme l’a ac-
-
compagné dans cette aventure en s’oc-
-
cupant notamment de la décoration de
la première enseigne qui a ouvert ses
portes en 1996 à Jal el Dib. «Notre slo-
-
gan est «To offer the best coffee cup in
town» (offrir la meilleure tasse de café
en ville)», poursuit-il. De leur côté, Dory
Daccache (CEO) et Naji Jabre (COO) se
sont réunis pour fonder en mars 2007
Leil Nhar, une enseigne de repas rapi-
-
des qui peuvent
être consommés
7/7, à toutes les
heures du jour
et de la nuit et
à des prix très
abordables. Le
choix du nom de
l’enseigne repré-
-
sente le dyna-
-
misme de la vie
citadine libanai-
-
se. Le restaurant propose une carte va-
-
riée de mets savoureux (salades, sand-
-
wiches, manakish, pizzas, desserts)
tout en ambitionnant de rester fidèle
aux saveurs proposées par la cuisine
libanaise. «Le «know how» assure plus
de 60% de la continuité et du succès
de la franchise», estime Georges Najjar
qui détient aujourd’hui huit enseignes
au Liban, trois au Qatar, une à Dubai et
une quinzaine en Arabie saoudite. Très
prochainement, un nouveau café Na-
-
jjar ouvrira ses portes à Beyrouth mais
laissons la surprise quant à son em-
-
placement stratégique. «La première
ouverture à l’international avait eu lieu
à Bahrein à la fin des années 90, une
période encore timide pour les franchi-
-
ses libanaises qui n’étaient alors pas
encore suffisamment reconnues à l’in-
-
ternational pour pouvoir concurrencer
les géants américains et les multina-
-
tionales malgré leur prix abordables»,
souligne-t-il. Leil Nhar détient trois
enseignes au Liban, une quatrième est
en cours d’ouverture à Dbayeh. Quant
à l’expansion régionale, elle s’étend
déjà à Dubai (2010) et d’autres projets
sont en cours à Sharjah, Abou Dhabi
et Erbil pour 2013. Après une premiè-
-
re ouverture de l’enseigne à Ryad en
Arabie saoudite, dix autres branches
suivront. Les deux franchiseurs intér-
-
rogés reconnaissent que les difficultés
rencontrées dans les pays hôtes sont
surtout d’ordre légal. En fait il s’agit
de très bien choisir son franchisé,
c’est un mariage qui s’établit entre les
deux parties. «Les contrats, en parti-
-
culier dans les pays arabes, sont flous
et ne protègent pas suffisamment no-
-
tre enseigne», affirme Georges Najjar.
«Lorsque nous refusons de renouveler
le contrat du franchisé, c’est du temps
et de l’argent que nous perdons car ce
type de contrat ne protège pas les dé-
-
tails», ajoute-t-il. La nouvelle politique
d’exportation de franchise pour Café
Najjar est d’exclure d’emblée les fran-
-
chisés qui n’accepteraient pas que le
contrat soit signé et chapeauté par les
tribunaux libanais. En effet, le respect
des normes imposées par le franchi-
-
seur et la conservation de l’identité de
l’enseigne sont des éléments déter-
-
minants dans le choix du franchisé.
Food For Pleasure SAL (FFP SAL) est
l’opérateur de Leil Nhar. Le système
de franchise créé pour le concept a été
structuré de manière à clarifier toutes
les opérations liées à la recréation du
concept. Il s’agit aussi de s’adapter
aux goûts des consommateurs des
pays franchisés tout en gardant intac-
-
te l’identité de l’enseigne. Café Najjar
vend ses franchises à 100%, «c’est un
principe de base, un partenariat néces-
-
siterait une vision commune et présen-
-
terait un risque de
conflit d’intérêt»,
souligne Georges
Najjar qui dit ne
pas contrôler ses
franchisés «mais
plutôt les soute-
-
nir» par le biais
de visites trimes-
-
trielles et en en-
-
tretenant une re-
-
lation constante
via Internet et un système spéciale-
-
ment mis en place pour évaluer quo-
-
tidiennement les chiffres d’affaire. En
cas de baisse d’activité du franchisé,
une des clauses du contrat permet
en effet de réduire ses frais publici-
-
taires et les frais de royalties annuels.
Georges Najjar se dit optimiste quant
à l’avenir du secteur de la franchise,
surtout après les révolutions arabes.
Au regard des difficultés économiques
et politiques que traverse la région, le
«business model» de la franchise est
indéniablement plus résistant aux vi-
-
cissitudes économiques que le com-
-
merce indépendant classique. En tant
de crise, la marque reste une assurance
qualité pour le consommateur.
l’uniformité de
l’offre, des prix et de la
décoration des points
de vente rassure les
consommateurs.
La marque et la franchise:
A vos marques, prêts, partez!
L’apparition du mot «marque» remonte au Moyen Age quand les éleveurs
marquaient leur bétail au fer rouge à l’aide de signes distinctifs afin de ne
pas le confondre avec celui des autres éleveurs.
Plus tard, au XIXe siècle, c’est la révolution industrielle et les progrès du pac--
kaging individualisé qui favoriseront l’apparition de marques afin de distin--
guer l’origine des produits tels que le dentifrice, les sodas, le savon, produits
que le consommateur pourra retrouver dans les premières grandes surfaces
(création du Bon Marché en 1890 par Edward Nordhoff à Paris).
Aujourd’hui, les marques font partie de notre quotidien et l’on ne pourrait
pas imaginer un monde sans elles. Elles fascinent, font l’objet d’un véri--
table culte dans un monde sécularisé, et deviennent de nouvelles religions
pour des hommes en quête permanente d’identité et de bonheur.
Dans le cadre de la franchise, la marque est la relation entre le franchi-
-
seur, le franchisé et le consommateur final. Pour ce dernier, elle comprend
plusieurs avantages: moyen d’identification au moment de l’acte d’achat,
garantie de constance dans la qualité et l’origine du produit, élément de
l’environnement familier et affectif du consommateur, vecteur de valeurs.
En fait la marque se décline en trois grands éléments: l’identité, l’image, le
positionnement.
1-L’identité de la marque se définit grâce à ses codes, ses codes couleurs
(le rouge et le blanc pour une marque de cigarette célèbre); son discours
narratif (qui explique la mission spécifique que la marque a envers ses
clients: Apple a pour mission de faciliter l’usage de produits informatiques
en les rendant plus pratique et plus agréable à utiliser); ses valeurs (les
marques véhiculent des valeurs qui répondent à des aspirations diverses: le
succès, le bien-être, etc.).
2-L’image de marque représente la façon dont la marque est perçue par le
consommateur.
3-Le positionnement est la façon dont la marque voudrait être perçue par
ces derniers.
Si la marque présente des avantages pour le consommateur, elle constitue
aussi une source de valeur pour le franchiseur et le franchisé.
La marque étant protégée, elle permet au franchiseur et au franchisé de
communiquer des messages au consommateur.
Elle garantit une fidélité en donnant la possibilité au consommateur de ra-
-
cheter des biens ou services qui lui ont procuré plaisir et satisfaction.
Nous pouvons dire que la marque constitue pour les deux parties du
contrat de franchise, le franchiseur et le franchisé, un des objets essentiels
du contrat avec le savoir-faire.
Plus la valeur de la marque sera élevée, plus elle fera vendre au franchisé,
augmentera ses parts de marché et créera une fidélité accrue de la part de
ses clients.
L’esthétique de la marque dans son expression matérielle et fonctionnelle,
devra répondre à l’aspect éthique de la marque en tant que véhicule d’émo--
tions et stimulateur de l’imaginaire.
Les marques devront donc faire l’objet de la plus grand attention de la part
du franchiseur dans leur construction en véhiculant des valeurs positives et
exclusives, car les marques ont l’obligation de se différencier pour exister,
en proposant un univers, en formulant un discours justificatif du «code
génétique» de leur identité. Plus l’identité de la marque sera forte, plus elle
aura la possibilité de devenir une marque premium et plus elle dressera une
barrière envers ses compétiteurs.
«En amour, on ne compte pas» comme dit la formule, on pourrait dire la
même chose pour les marques qui très souvent nous font oublier leur prix.
En fin de compte, admettons que les marques sont comme les êtres hu-
-
mains et obéissent aux mêmes règles de comportement et d’évolution,
avec une naissance, une vie et une mort.
Tant qu’elles sont vivantes, quittez-les, protestez ou soyez leur fidèles,
voilà nos trois seuls choix!
Nicolas Faure, fondateur de NF Consultants©
Bibliographie:
La marque, Benoît Heilbrunn (Coll. Que sais-je?, éd. des PUF, 2007)
La société de consommation, Jean Baudrillard (éd. Poche Folio Essai, 1996)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%