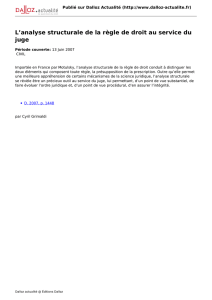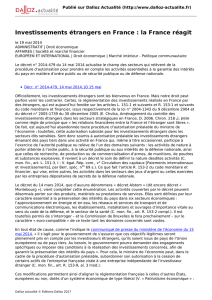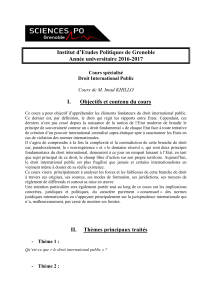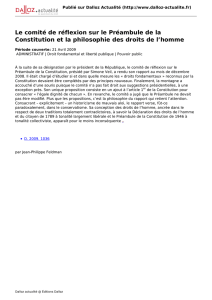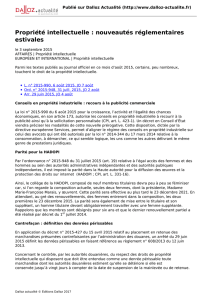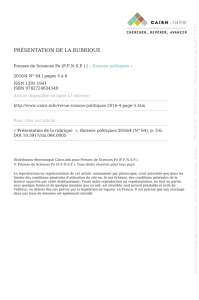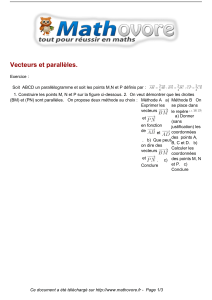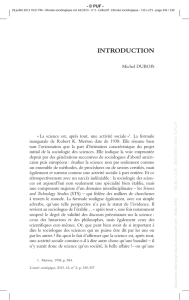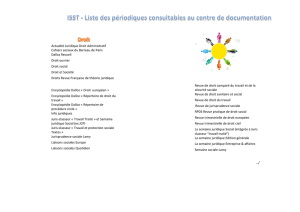le libre-échange : un paradigme en situation d`inconfort

LE LIBRE-ÉCHANGE : UN PARADIGME EN SITUATION
D'INCONFORT ?
Henri Bourguinat
Dalloz | Revue d'économie politique
2005/5 - Vol. 115
pages 531 à 543
ISSN 0373-2630
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2005-5-page-531.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bourguinat Henri , « Le libre-échange : un paradigme en situation d'inconfort ? » ,
Revue d'économie politique, 2005/5 Vol. 115, p. 531-543.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Dalloz.
© Dalloz. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz

Le libre-échange : un paradigme
en situation d’inconfort ?
Henri Bourguinat*
Chacun connaît la fécondité du modèle du libre-échange. Cependant, comme l’a mon-
tré récemment (2003) J.-A. Samuelson lui-même, le principe des coûts comparatifs
(Théorème Ricardo-Mill) se heurte à certaines difficultés si, dans le cas de deux pays
comme la Chine et les États-Unis, le premier rattrape rapidement son retard technique
dans ce qui était à l’origine le bien de spécialisation du second. La nouvelle théorie de
l’échange international (économies d’échelle et différenciation de la demande) elle-
même, n’échappe pas au questionnement lié à la globalisation.
globalisation - coûts comparatifs - économies d’échelles - différenciation de la de-
mande - délocalisation - biens à forte densité technologique - économies des conti-
nents - processus de redistribution
The free trade paradigm
and the challenge of globalization
Every one knows the fecondity of free trade model. Nevertheless, as P. A. Samuelson
himself las recently (2003) demonstrated, the Ricardo-Mill theorem meets some limits
whan it is applied to present China and US case, when the first country catchs up
rapidly the second in its specialised good. The new theory of international trade itself
doesn’t escape to this challenge of the globalization.
globalization - comparative costs - economies of scale - differenciation demand - out
sourcing - redistributing process - continental economies
Classification JEL : F02, F12, F14
Y a-t-il aujourd’hui lieu de s’interroger sur le bien-fondé d’une ouverture
économique toujours plus poussée et, au-delà, de douter de l’entière perti-
nence du paradigme (au sens de T. Kuhn [1]) du libre échange qui la sou-
tend ? Parallèlement au triomphe dans le monde entier de l’idée d’économie
du marché des vingt-cinq dernières années, celle de la supériorité du libre
échange paraît de nos jours tout à fait acquise. Il se trouve d’ailleurs que le
* LARE-Efi – Université Bordeaux IV Montesquieu.
Le texte qui va suivre a bénéficié d’utiles discussions avec P. Cassagnard, Maître de confé-
rences.
Ses insuffisances éventuelles restent, bien entendu, entièrement imputables à l’auteur.
•BERNARD LASSUDRIE-DUCHÊNE
REP 115 (5) septembre-octobre 2005
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz

modèle dual, celui du protectionnisme, n’a guère, aujourd’hui, de crédibilité.
De plus, ceux qui prétendraient mettre en doute, de nos jours, le principe de
libre-échange, risqueraient presque immanquablement d’être classés dans
la catégorie des adeptes de la « pop économie », moquée par Paul Krug-
man [2] il y a presque dix ans [1996] et, si bien caractérisée par Bernard
Lassudrie-Duchêne qui la définit comme « cette culture économique de
masse simpliste et erronée ayant, si l’on veut, aux yeux des économistes
avertis, un aspect « kitsch » » [3].
Celui qui, aujourd’hui, en viendrait à douter de la pertinence du libre-
échange intégral au nom des délocalisations qui s’accélèrent, de la menace
que fait peser sur les spécialisations l’irruption d’une économie chinoise
conquérante ou, de la montée des inégalités attribuée – plus ou moins
légitimement – à l’échange international, celui-là ne manquerait pas d’être
considéré comme un tenant avéré de la « pop économie ».
Et pourtant, dans notre monde globalisé, il peut ne pas paraître inutile par
rapport aux tendances lourdes précédentes, de s’interroger sur l’adéquation
des fondements même du paradigme en remontant jusqu’à sa base pre-
mière qui n’est autre que celle des coûts comparatifs. D’ailleurs des voix
plus qu’autorisées, en particulier celle de Paul Antony Samuelson [4], vien-
nent tout récemment de nous y inviter. En essayant d’aller plus loin, on
tentera aussi de déterminer si la « nouvelle théorie du commerce internatio-
nal » elle-même (économies d’échelle et différenciation du produit) convient
davantage pour refonder aujourd’hui le paradigme du libre échange et, au-
delà, pour justifier d’aller toujours plus loin dans la voie de la libéralisation
des échanges.
1. Les coûts comparatifs
dans une économie globalisée
Pour confirmer la supériorité du libre-échange, y compris dans une éco-
nomie globalisée de l’époque actuelle, on en revient toujours au même
socle théorique, celui des coûts comparatifs de Ricardo (et de la théorie de la
dotation en facteurs). Or, à y regarder de plus près, déjà à ce niveau, certains
problèmes interviennent tant à propos du théorème lui-même (la spécialisa-
tion sur la base des coûts relatifs) que de son corollaire (le gain réciproque
des co-échangistes).
1.1. Coûts absolus contre coûts comparatifs
Dans le « modèle » ricardien (2 ×2) le plus simple, deux pays (le Portugal
et l’Angleterre) et deux produits (le vin et le drap), chacun doit se spécialiser
dans le bien pour lequel il dispose du plus grand avantage (ou du plus petit
désavantage) relatifs. Le corollaire veut qu’il y ait alors partage du gain entre
532
————————————————————————————————————————————————————
Henri Bourguinat
REP 115 (5) septembre-octobre 2005
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz

les deux pays. L’apologue devient plus dépouillé encore lorsque Ricardo,
pour illustrer l’idée d’une comparaison des productivités relatives, donne
l’exemple des deux artisans, le cordonnier et le chapelier et que chacun
d’entre eux, doit choisir l’activité dans laquelle il réussit relativement le
mieux. Dans un modèle modernisé à plusieurs pays, plusieurs biens et plu-
sieurs facteurs pays (n ×n×n) mené en termes de chaîne des coûts compa-
ratifs et incluant d’autres éléments de coût que le travail, c’est toujours l’idée
d’avantage relatif choisi comme critère de la spécialisation qui prévaut, le
corollaire de partage du gain à l’échange demeurant lui-même tout à fait
valide.
En fait, tout le raisonnement dépend de l’hypothèse de mobilité différen-
tielle des facteurs de production dans le cadre national par rapport à celui
qui intervient au niveau international. Certes Ricardo n’exclut pas dans les
« Principes de l’économie politique et de l’impôt [1817] » l’investissement à
l’étranger mais il postule nettement une forte préférence pour le champ
national. « Bien des causes, écrit-il, s’opposent à la sortie des capitaux : la
crainte bien ou mal fondée de voir s’anéantir à l’étranger un capital dont le
détenteur n’est pas le maître absolu et la répugnance naturelle qu’éprouve
tout homme à quitter sa patrie et ses amis pour aller se confier à un gou-
vernement étranger et assujettir des habitudes anciennes à des lois nouvel-
les. Ces sentiments... décident la plupart des capitalistes à se contenter d’un
taux de profit moins élevé dans leur propre pays plutôt que d’aller chercher
un emploi plus lucratif de leurs fonds dans des pays étrangers ».
Cette idée sera poussée plus loin encore lorsque les auteurs plus moder-
nes postuleront que les nations doivent s’analyser comme autant de « blocs
de facteurs », ceux-ci étant tenus comme immobiles sur le plan externe alors
qu’ils seraient parfaitement mobiles sur le plan interne.
Point n’est guère besoin d’insister pour faire apparaître combien cette
hypothèse est contredite aujourd’hui par la mondialisation. Le développe-
ment exponentiel de l’investissement direct étranger s’y oppose très direc-
tement tout comme la montée actuelle des délocalisations. De ce point de
vue, l’un des fondements majeurs de la spécialisation internationale fait déjà
défaut. Il est toutefois utile de bien comprendre aussi que cette théorie des
coûts comparatifs a été conçue à l’origine à l’aune de pays – en fait d’États-
nations – considérés comme strictement concurrents et fort peu interdépen-
dants. Dans le contexte d’une économie internationale de plus en plus inté-
grée, dans laquelle le capital technique et financier est de plus en plus
ubiquiste, elle ne peut qu’avoir du mal à se maintenir. Les lignes de la
spécialisation se dessineront désormais au niveau global et, de moins en
moins, sur une base nationale, si ce n’est nationaliste. La firme multinatio-
nale (le détenteur de portefeuille) au lieu de choisir ses lignes de produits et
ses implantations (ou ses titres) en jaugeant de l’excellence relative des
secteurs au sein d’une même économie nationale, n’aura qu’un seul réfé-
rent : le marché mondial. En conséquence, c’est le moindre coût, recherché
au niveau global, qui prévaudra et par la même le principe des coûts absolus
qui l’emportera sur celui des coûts comparatifs (Damian et Graz [2001]) [5].
En notant
a
1
h
{a
n
h
les besoins unitaires en facteur travail « domestique »
(i.e. national) et
a
1
w
{a
n
w
ceux de l’étranger, il faut voir ce que l’on pourrait
Le libre-échange : un paradigme en situation d’inconfort ?
—————————
533
REP 115 (5) septembre-octobre 2005
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz

appeler le « test des spécialisations » pour celui des pays qui désire s’adon-
ner à telle ou telle production devrait, dans le cadre de la théorie des coûts
comparatifs, se faire sur la base de la comparaison :
a
1
h
a
2
h
"a
1
w
a
2
w
∀
1
{n [1]
Dans un contexte de mondialisation, ce choix, en termes de coûts absolus,
reviendra à comparer :
a
1
h
"a
1
w
∀
1
{n [2]
La méthode de sélection (1) peut conduire à des résultats très différents
de (2).
1.2. « L’acte II » de Samuelson
A supposer même que la spécialisation obéisse encore à la règle des
coûts comparatifs, il n’est pas sûr, dans un monde où les délocalisations et
les transferts de technologie prospèrent, que celles-ci garantissent nécessai-
rement le gain des deux parties à l’échange. C’est ce que vient d’établir avec
éclat un auteur pourtant peu suspect d’opposition de principe au paradigme
dit HOS (Heckscher, Ohlin, Samuelson) puisqu’il s’agit de Paul Antony Sa-
muelson lui-même [6].
En partant du modèle standard de Ricardo-Mill avec deux pays (cette fois
les États-Unis et la Chine), deux biens (le bien 1 et le bien 2) et un seul
facteur (le travail), il considère que chaque pays se spécialise complètement
dans le bien pour lequel il a l’avantage comparatif. Dans la mesure où la
dotation en travail est fixe, tout changement du revenu global est reflété par
celui du salaire réel.
Samuelson considère alors trois situations :
(i) Il part d’abord de l’autarcie par rapport à laquelle il introduit l’échange.
L’Amérique, comme la Chine, gagnent alors à commercer : le premier pays
se spécialise entièrement dans le bien (1) ; le second dans le bien (2).
(ii) En introduisant ensuite, par rapport à cet équilibre de libre-échange, un
accroissement de productivité dans le bien (2) produit et exporté par la
Chine, il aboutit à la baisse de son prix relatif. L’Amérique achète davantage
de ce bien, meilleur marché. Il y a toujours un gain réciproque.
(iii) Par contre, si par rapport à l’équilibre général, on introduit un gain de
productivité en Chine dans le bien (1) que ce pays importe, et si celui-ci est
juste suffisant pour égaliser le ratio des coût relatifs entre l’Amérique et la
Chine, tout le commerce est effacé et l’Amérique voit les bénéfices de
l’échange précédent se trouver confisqués.
Ce dernier cas que Samuelson appelle « l’Acte II » (par rapport à l’acte I
des situations (i) et (ii)) justifie que, selon lui, le théorème des coûts compa-
534
————————————————————————————————————————————————————
Henri Bourguinat
REP 115 (5) septembre-octobre 2005
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 90.30.163.138 - 16/10/2011 23h50. © Dalloz
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%
![Le transfert d`embryon [I]post mortem[/I] : comment](http://s1.studylibfr.com/store/data/004730355_1-e5b105ea355cee335821a41a8809bb22-300x300.png)