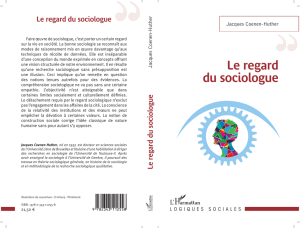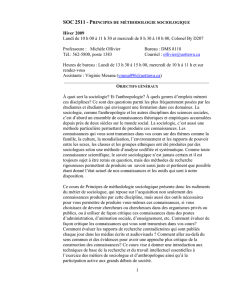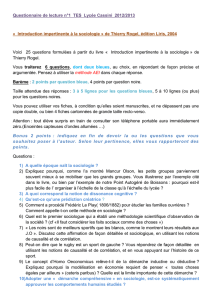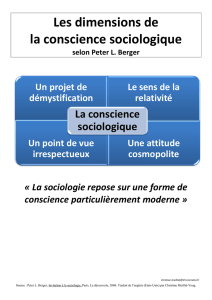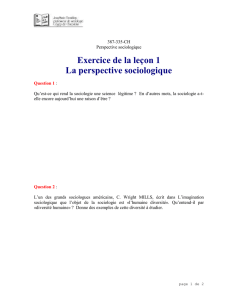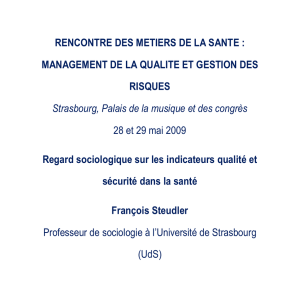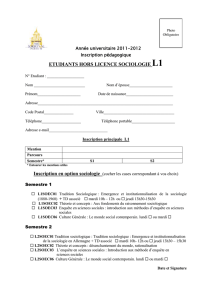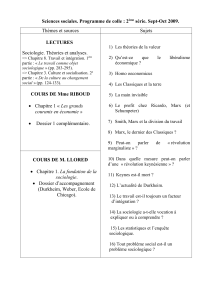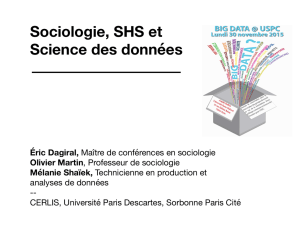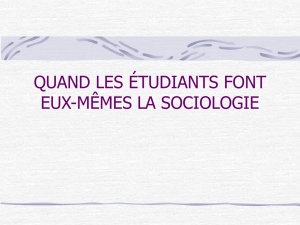INtROdUCtION

29 juillet 2013 10:21 PM ‑ L’Année sociologique vol. 63/2013 - n° 2 ‑ Collectif ‑ L’Année sociologique ‑ 135 x 215 ‑ page 344 / 530
- © PUF -
29 juillet 2013 10:21 PM ‑ L’Année sociologique vol. 63/2013 - n° 2 ‑ Collectif ‑ L’Année sociologique ‑ 135 x 215 ‑ page 344 / 530 29 juillet 2013 10:21 PM ‑ L’Année sociologique vol. 63/2013 - n° 2 ‑ Collectif ‑ L’Année sociologique ‑ 135 x 215 ‑ page 345 / 530
- © PUF -
L’année sociologique, 2013, 63, n° 2, p. 345-357
INtROdUCtION
Michel DUBOIS
« La science est, après tout, une activité sociale »1. La formule
inaugurale de Robert K. Merton date de 1938. Elle résume bien
tant l’orientation que la part d’hésitation caractéristique du projet
initial de la sociologie des sciences. Elle indique la voie empruntée
depuis par des générations successives de sociologues d’abord améri-
cains puis européens : étudier la science non pas seulement comme
un ensemble de méthodes, de procédures ou de savoirs certifiés, mais
également et surtout comme une activité sociale à part entière. Et ce
rétrospectivement avec un succès indéniable : la sociologie des scien-
ces est aujourd’hui non seulement une spécialité bien établie, mais
une composante majeure d’un domaine interdisciplinaire – les Science
and Technology Studies (STS) – qui fédère des milliers de chercheurs
à travers le monde. La formule souligne également, avec un simple
adverbe, qu’une telle perspective n’a pas le statut de l’évidence. Il
revient au sociologue de l’établir… « après tout », une fois notamment
soupesé le degré de validité des discours préexistants sur la science :
ceux des historiens et des philosophes, mais également ceux des
scientifiques eux-mêmes. Or, que peut bien avoir de si important à
dire le sociologue des sciences qui ne puisse être dit par les uns ou
par les autres ? En quoi le fait d’armer que la science est, après tout,
une activité sociale consiste-t-il à dire autre chose qu’une banalité – il
n’y aurait donc de science qu’en société, la belle aaire !– ou qu’une
1. Merton, 1938, p. 584.
Introduction
Michel Dubois
345-357
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 25/01/2014 13h31. © P.U.F.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 25/01/2014 13h31. © P.U.F.

Michel Dubois346
29 juillet 2013 10:21 PM ‑ L’Année sociologique vol. 63/2013 - n° 2 ‑ Collectif ‑ L’Année sociologique ‑ 135 x 215 ‑ page 346 / 530
- © PUF -
29 juillet 2013 10:21 PM ‑ L’Année sociologique vol. 63/2013 - n° 2 ‑ Collectif ‑ L’Année sociologique ‑ 135 x 215 ‑ page 346 / 530 29 juillet 2013 10:21 PM ‑ L’Année sociologique vol. 63/2013 - n° 2 ‑ Collectif ‑ L’Année sociologique ‑ 135 x 215 ‑ page 347 / 530
- © PUF -
futilité – à quoi bon restituer l’« arrière-cuisine » de la science, celle-ci
ne se sut-elle donc pas à elle-même ?
Ainsi que le rappelait Jean-Michel Berthelot (2008), il existe
autant de façons de répondre à cette double interrogation que de
façons de définir la science comme activité sociale. La controverse
qui agite cycliquement depuis trente ans la sociologie des sciences
autour de la démarcation de la science l’illustre abondamment. La
polarité de cette controverse peut être rappelée ici à grands traits.
D’un côté la thèse selon laquelle le caractère social de l’activité
scientifique n’est ni banal ni futile dans la mesure où il représente
la condition nécessaire de l’autonomie, sinon absolue du moins
relative, de la science et de ses produits. Le social s’apparente ici à un
état et/ou un processus collectif – interactionnel, organisationnel,
normatif – dont la spécificité est indissociable de celle des produits
de l’activité scientifique comme de la légitimité du « pouvoir social »
des scientifiques. De l’autre, la thèse selon laquelle le caractère social
de l’activité scientifique ne peut être ni banal ni futile dans la mesure
où il fait l’objet d’un travail systématique d’occultation de la part
des scientifiques. Une fois « dévoilé » par le sociologue, il permet
d’en finir définitivement avec l’« illusion » d’une autonomie de la
science et de la communauté scientifique. Le social s’apparente là
encore à un état et/ou un processus collectif, mais dont l’absence de
spécificité ne peut qu’alimenter tant le scepticisme quant à celle des
produits de l’activité scientifique que la critique du « pouvoir social »
des scientifiques.
Cette controverse a été reconstituée dans ses grandes lignes
historiques et épistémologiques (Stehr, 1978 ; Ben-David, 1991 ;
Boudon, Clavelin, 1994 ; Dubois, 2001 ; Raynaud, 2003 ; Shinn,
Ragouet, 2005 ; Evans, 2005). La sociologie des sciences nord-
américaine – en particulier celle développée en contact direct
ou indirect avec les départements de sociologie des univer-
sités de Harvard ou de Columbia dans la seconde moitié du
e siècle – incarne traditionnellement le pôle centré sur l’idée
d’une autonomie de la science. Pour mémoire on peut évoquer
rapidement quelques figures sociologiques classiques. Dans le sillage
des variantes du fonctionnalisme incarnées par Parsons et Merton,
B. Barber (1953) arme par exemple que « la science conserve
une marge d’indépendance, comme toutes les autres parties de
la société, parce qu’elle possède sa propre structure interne et un
principe d’action qui lui est propre ». Parmi les éléments qui garan-
tissent l’« autonomie relative de la science » il faut compter certes
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 25/01/2014 13h31. © P.U.F.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 25/01/2014 13h31. © P.U.F.
1
/
2
100%