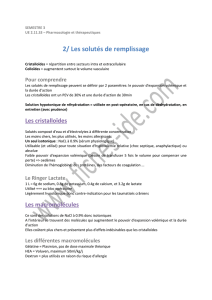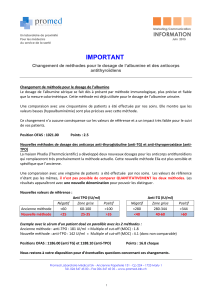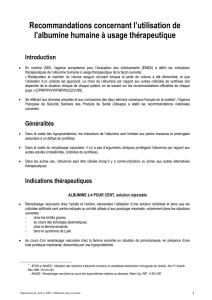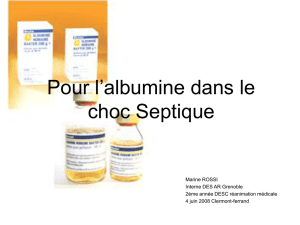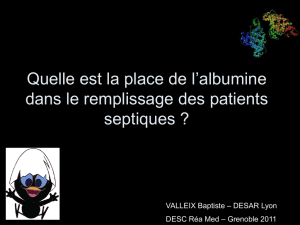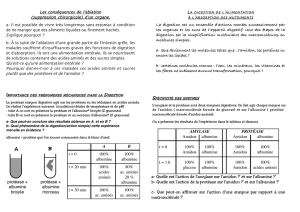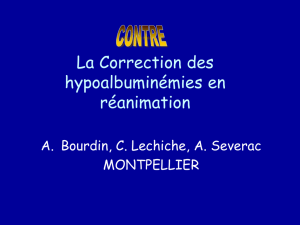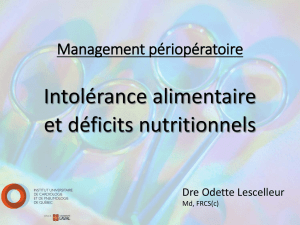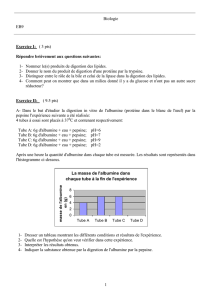- Canadian Blood Services` professional education

GUIDE DE LA PRATIQUE
TRANSFUSIONNELLE
Chapitre 3: Albumine
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine
Date de publication: Vendredi 1 mai 2015
Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux
patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de
transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités
insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au
traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines
situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.
1/7
Susan Nahirniak, MD, FRCPC
Le présent chapitre présente les applications de l’albumine ainsi que les alternatives thérapeutiques.
QU’EST-CE QUE L’ALBUMINE?
L’albumine a un poids moléculaire d’environ 67 000 daltons et possède, en raison de sa forme, une faible
viscosité sérique. C’est une molécule très soluble, à charge négative nette, qui peut se lier tant aux cations
qu’aux anions. L’albumine corporelle totale équivaut à environ 300 g, dont 40 % (soit 120 g) se trouve dans le
compartiment plasmatique.
L’albumine sérique est synthétisée dans le foie. Un adulte sain produit quelque 16 g d’albumine par jour.
Plusieurs hormones peuvent accroître la synthèse de l’albumine, mais divers facteurs peuvent aussi en abaisser
la production, notamment la malnutrition, le stress, le vieillissement ainsi que certains médicaments. Une perte
de sang de 500 ml entraîne une perte d’albumine de 12 g seulement (4 % de l’albumine corporelle totale).
Ainsi, l’albumine perdue lors d’une hémorragie de l’ordre de quatre culots sanguins sera entièrement remplacée
par la synthèse physiologique en l’espace de trois jours.
Environ 80 % de la pression oncotique totale du plasma est attribuable à l’albumine. En règle générale, 1 g
d’albumine attire 18 ml d’eau du fait de son activité oncotique. La perfusion de 100 ml d’albumine à 25 %
augmente de 450 ml le volume plasmatique.
EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DE L’ADMINISTRATION D’ALBUMINE
Depuis que l’on a commencé à utiliser l’albumine comme agent thérapeutique dans les années 40, son utilité
ainsi que la controverse générale concernant son efficacité et son innocuité par rapport à d’autres colloïdes et
cristalloïdes ont fait l’objet de nombreuses revues systématiques et publications.
Selon deux méta-analyses effectuées vers la fin des années 90, l’utilisation de l’albumine pour le traitement de
l’hypovolémie, des brûlures ou de l’hypoalbuminémie est associée à une hausse du taux de
mortalité.1,2 Toutefois, ces données reposent sur des études de faible envergure et des populations de patients
hétérogènes.
Un vaste essai clinique randomisé (ECR) comparant l’administration d’albumine à 4 % avec celle d’une solution
physiologique salée chez 6 997 patients nécessitant une réanimation hydrique dans des unités de soins
intensifs (USI) australiens (l’essai SAFE) n’a révélé aucune augmentation du taux de mortalité.3 En outre, cette
même étude n’a démontré aucune différence significative par rapport au nombre de jours passés aux USI, à la
durée d’hospitalisation, au nombre de jours de ventilation mécanique ou à la défaillance multiviscérale. En
l’absence de différence significative entre les groupes visés par l’étude, les cliniciens des deux camps
continuent d’utiliser cette étude pour faire valoir leur point de vue. D’autres études ont également étayé
l’innocuité de l’albumine.4
Une revue systématique Cochrane publiée en 2011 n’a pas démontré une efficacité ou une innocuité accrue de
l’albumine par rapport à d’autres solutions colloïdales.5 Un ECR multinational, l’essai CRISTAL, a démontré que
l’utilisation de colloïdes par rapport aux cristalloïdes n’engendrait aucune différence significative au niveau du
taux de mortalité à 28 jours (risque relatif [RR] de 0,96; intervalle de confiance [IC] à 95 % de 0,88 à 1,04) chez
les patients atteints d’hypovolémie hospitalisés aux USI.6 La revue systématique Cochrane la plus récente
publiée en 2013 a déterminé qu’en comparant l’albumine aux cristalloïdes pour la réanimation hydrique des
patients gravement malades (traumatismes, brûlures ou soins post-chirurgicaux), le RR commun de décès en
cas d’administration d’albumine s’élevait à 1,01 (IC à 95 % de 0,93 à 1,10), ce qui montre encore une fois que
l’administration d’albumine aux fins de réanimation hydrique ne présente aucun avantage ni aucun risque

GUIDE DE LA PRATIQUE
TRANSFUSIONNELLE
Chapitre 3: Albumine
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine
Date de publication: Vendredi 1 mai 2015
Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux
patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de
transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités
insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au
traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines
situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.
2/7
accru.7 Cette revue indique toutefois que les solutions d’amidon hydroxyéthylé peuvent contribuer à un risque
accru de décès avec un RR de 1,10 (IC à 95 % de 1,02 à 1,19).
Selon l’étude ALBIOS, l’ajout d’albumine à un traitement aux cristalloïdes en cas de septicémie grave ou de
choc septique n’a pas amélioré le taux de mortalité à 28 jours chez 1 818 patients (RR de 1,0; IC à 95 % de 0,85
à 1,05).8
Chez les patients subissant une paracentèse à grand volume auxquels on administre de l’albumine au lieu
d’autres colloïdes, les données de la méta-analyse ont fait ressortir un bienfait au niveau de l’instabilité
hémodynamique suite à la paracentèse (rapport des cotes [RC] de 0,39; IC à 95 % de 0,27 à 0,55), de
l’hyponatrémie (RC de 0,58; IC à 95 % de 0,39 à 0,87) et du taux de mortalité (RC de 0,64; IC à 95 % de 0,41 à
0,98).9
DESCRIPTION DU PRODUIT
L’albumine humaine est préparée à partir du plasma prélevé chez les donneurs à l’aide d’un processus appelé
« fractionnement ».
Au Canada, l’albumine est disponible sous forme de produit à base de protéines plasmatiques humaines en
solution stérile sans latex présentant un pH physiologique et une concentration de sodium de 130 à 160 mmol/l.
Le produit final renferme des stabilisateurs, mais est généralement exempt d’agents de conservation.
L’inactivation virale a lieu pendant le fractionnement. Les solutions d’albumine normales sont des liquides clairs
légèrement visqueux qui peuvent être presque incolores ou encore avoir une couleur jaune, ambre ou vert pâle.
On trouvera au tableau 1 la liste des préparations à base d’albumine offertes par l’entremise de la Société
canadienne du sang.
En général, l’albumine est offerte en deux concentrations, soit 5 % et 25 %. L’albumine à 5 % et le plasma
humain sont iso-osmotiques; par contre, l’albumine à 25 % est hyperoncotique par rapport au plasma et elle
équivaut à un volume plasmatique environ de quatre à cinq fois supérieur au volume perfusé. En cas de déficit
oncotique, l’albumine à 25 % est le produit à privilégier, tandis que l’albumine à 5 % est utilisée dans des
conditions associées à une hypovolémie isolée ou à la plasmaphérèse thérapeutique.
Tableau 1 : Préparations à base d’albumine offertes par l’entremise de la Société canadienne du sang*
Nom du
produit
Taille du
flacon Fournisseur Stockage Stabilisateurs et substances
tampons pH
Plasbumin® 5 % 50 ml ou
250 ml
Grifols de 2 à 30 °C Caprylate de sodium,
acétyltryptophanate de sodium
et carbonate de sodium
Teneur en Na
= 145 mé/l
Plasbumin® 25
%
100 ml
Albumine 25 % 100 ml Grifols /
Société
canadienne du
sang
de 2 à 30 °C Caprylate de sodium,
acétyltryptophanate de sodium
et carbonate de sodium
Teneur en Na
= 145 mé/l

GUIDE DE LA PRATIQUE
TRANSFUSIONNELLE
Chapitre 3: Albumine
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine
Date de publication: Vendredi 1 mai 2015
Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux
patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de
transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités
insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au
traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines
situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.
3/7
Nom du
produit
Taille du
flacon Fournisseur Stockage Stabilisateurs et substances
tampons pH
Alburex® 5 % 250 ml ou
500 ml
CSL Behring de 2 à 30 °C Caprylate de sodium,
acétyltryptophanate de sodium
et carbonate de sodium
Intervalle de
pH = de 6,4 à
7,4
Teneur en Na
= 3,2 mg/ml
Alburex® 25 % 50 ml ou
100 ml
Octalbin® 5 % 250 ml Octapharma de 2 à 25 °C Caprylate de sodium,
acétyltryptophanate de sodium
et carbonate de sodium
pH = s.o.
Teneur en Na
= de 142,5 à
157,5 mmol/l
Octalbin® 25% 100 ml
*On trouvera des mises à jour régulières de cette liste sur le site Web de la Société canadienne du sang à l’adre
sse https://www.blood.ca/sites/default/files/PPP_Customer_Table_of_Information_FR.pdf
INDICATIONS
En 1995, l’organisme University Hospital Consortium a rédigé le premier énoncé consensuel sur les indications
concernant l’utilisation de l’albumine.10 Dans de nombreux pays, ces indications sont encore valables; toutefois,
suite aux revues systématiques susmentionnées, de nouvelles lignes directrices limitent l’utilisation de ce
produit au remplissage vasculaire en cas de choc hypovolémique.
Deux recommandations canadiennes (issues de la Colombie-Britannique et de l’Ontario), légèrement différentes
l’une de l’autre, sont publiées sur le site Web de la province concernée.11,12 Ces recommandations reconnaissent
que l’albumine serait généralement indiquée dans les cas suivants :
Préparations à 25 %
Maladie du foie et péritonite bactérienne
Résection ou greffe du foie accompagnée d’une ascite
Paracentèse à grand volume (> 5 l)
Préparations à 5 %
Échange plasmatique thérapeutique
Brûlures thermiques sur plus de 50 % de la surface totale du corps, en l’absence de réaction aux
cristalloïdes
Et qu’elle ne serait généralement pas indiquée dans les cas suivants :
Réanimation volémique pour l’hypovolémie
Ischémie cérébrale ou lésion cérébrale suite à un état hypovolémique
Hypoalbuminémie
Hypotension pendant la dialyse
CONTRE-INDICATIONS
L’albumine est contre-indiquée dans les cas suivants :

GUIDE DE LA PRATIQUE
TRANSFUSIONNELLE
Chapitre 3: Albumine
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine
Date de publication: Vendredi 1 mai 2015
Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux
patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de
transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités
insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au
traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines
situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.
4/7
Le patient serait incapable de tolérer une augmentation rapide du volume sanguin.
Le patient a des antécédents de réaction allergique à l’albumine.
D’après la notice d’accompagnement des produits Grifols,13 ceux-ci ne devraient pas être utilisés chez les
nourrissons ou les patients en hémodialyse puisque la teneur en aluminium de ces produits n’a pas été
évaluée et peut être supérieure à 200 µg/l. La notice d’accompagnement des produits Octapharma et CSL
Behring indique que leurs produits contiennent moins de 200 µg/l d’aluminium et la monographie de
produit d’Octapharma ajoute que celui-ci convient aux bébés prématurés et aux patients en dialyse.14,15
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Le volume et le débit de perfusion varieront selon le contexte clinique.
Toutefois, le taux de perfusion pour les solutions d’albumine à 5 % ne devrait pas dépasser 5 ml/min. En raison
de la nature hyperosmotique de l’albumine à 25 %, le taux de perfusion dans ce cas ne devrait pas dépasser 1 à
2 ml/min. Il est recommandé de surveiller les patients recevant une perfusion d’albumine à 25 % étant donné le
risque de surcharge circulatoire et d’hyperhydratation.
Le produit est administré au moyen d’un dispositif de perfusion de produit sanguin standard ou d’une aiguille-
filtre fournie avec celui-ci. Le dispositif devrait contenir une voie d’air (aiguille d’aération) empêchant la
formation de mousse.
L’albumine est compatible avec les solutés électrolytiques et glucosés intraveineux habituels, par exemple, la
solution physiologique salée, le soluté lactate de Ringer, le Plasmalyte et le dextrose à 5 %, mais elle ne doit
pas être perfusée en même temps qu‘une solution contenant de l’alcool ou des hydrolysats protéiques.
L’albumine ne peut être diluée dans des solutions hypotoniques comme de l’eau stérilisée aux fins d’injection,
puisque cette dilution peut provoquer une hémolyse grave.
Une fois ouvert, le flacon d’albumine doit être utilisé dans les quatre heures; passé ce délai, on doit jeter le
produit.
STOCKAGE ET TRANSPORT
Le tableau 1 indique les températures de stockage des différentes préparations à base d’albumine. La durée de
conservation varie entre deux et cinq ans, selon le procédé de fabrication. Avant d’administrer le produit, on
doit vérifier la date de péremption de chaque unité, qui est toujours inscrite sur l’emballage.
Le produit ne devrait pas être administré si :
la solution a été congelée;
la solution est trouble;
le flacon est endommagé; ou
des particules (de verre ou de liège) sont visibles dans la solution.
SOLUTIONS DE RECHANGE À L’ALBUMINE
L’albumine peut être remplacée par des cristalloïdes ou d’autres solutions colloïdales. Il existe trois grandes
catégories de liquides de remplissage vasculaire utilisées en milieu clinique, soit :

GUIDE DE LA PRATIQUE
TRANSFUSIONNELLE
Chapitre 3: Albumine
https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine
Date de publication: Vendredi 1 mai 2015
Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux
patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de
transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités
insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au
traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines
situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.
5/7
cristalloïdes;
colloïdes (p. ex., albumine); et
solutions hypertoniques (pour remplacer l’albumine à 25 %).
Les cristalloïdes les plus utilisés en milieu clinique sont la solution physiologique salée, le Plasmalyte et le soluté
lactate de Ringer. Par rapport à la plupart des colloïdes, les cristalloïdes offrent les avantages suivants : coût
moins élevé, augmentation du débit urinaire et absence de complexité chimique se traduisant par un
métabolisme et une élimination simples. Leurs inconvénients se concrétisent essentiellement lorsque la
perfusion d’un volume important s’impose aux fins de réanimation. En effet, les cristalloïdes peuvent alors
provoquer un œdème périphérique et pulmonaire, en plus de présenter un risque d’hyperchlorémie en cas de
troubles rénaux.
Les colloïdes se distinguent des cristalloïdes par une rétention accrue de l’eau dans le compartiment
intravasculaire. Ainsi, en présence d’une perméabilité membranaire normale, les colloïdes peuvent augmenter
le volume plasmatique sans pénétrer dans les compartiments interstitiel ou intracellulaire. En plus de
l’albumine, les colloïdes actuellement offerts au Canada à des fins thérapeutiques sont les suivants :
dextrans (D40, D70)
gélatine (Haemaccel)
solutions d’amidon hydroxyéthylé (AH) (Volulyte®, Voluven® et Hextend)
Les inconvénients éventuels des colloïdes sont les suivants :
leur coût, puisqu’ils sont nettement plus chers que les cristalloïdes;
la baisse de la concentration d’hémoglobine du receveur après la perfusion;
la dilution des protéines plasmatiques, y compris des facteurs de coagulation; et
la surcharge circulatoire.
Les colloïdes qui ne renferment pas d’albumine coûtent moins cher que l’albumine, mais les effets secondaires
peuvent être accrus, en particulier dans le cas de solutions AH.16 En 2013, Santé Canada a publié un avis
informant les cliniciens qu’un taux de mortalité accru ainsi qu’une augmentation du risque d’insuffisance rénale
et hépatique avaient été associés à l’utilisation de solutions AH et que ces solutions étaient maintenant contre-
indiquées chez les patients souffrant de septicémie, de maladie du foie grave ou d’insuffisance rénale
accompagnée d’oligurie et d’anurie, non liée à l’hypovolémie.17
Parmi les effets indésirables propres à l’albumine, mentionnons un très faible risque d’anaphylaxie. Au moment
de la rédaction du présent chapitre, aucun cas de transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH),
d’hépatites ou d’une autre maladie virale n’avait été signalé; cela dit, il existe un risque théorique de
transmission d’une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L’osmolalité, la teneur en sodium, le pH et les
stabilisateurs du produit (le caprylate de sodium, le N-acétyltryptophanate de sodium et aluminium) chez
certaines populations de patients suscitent des préoccupations.18,19
On trouvera au chapitre 11 du présent guide de plus amples renseignements sur l’utilisation de cristalloïdes et
de colloïdes comme solutions de remplissage en cas de transfusion d’urgence.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers. Human Albumin Administration in Critically Ill Patients:1.
Systematic Review of Randomised Controlled Trials. BMJ 1998; 317: 235-40.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%