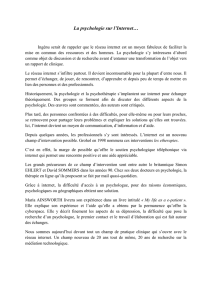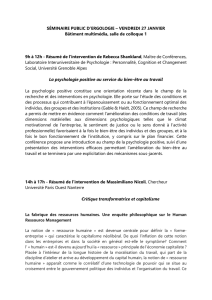LECTUREDUSOCIAL-Fiche de lecturen n- 3- avec

Lecture du social – Fiche de lecture n°2
La soumission librement consentie
Comment amener les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire.
De Robert-Vincent JOULE et Jean Léon BEAUVOIS
1 – Eléments de catalogage
L’ouvrage étudié pour la réalisation de cette deuxième fiche de lecture s’intitule : « La
soumission librement consentie, comment amener les gens à faire librement ce qu’ils doivent
faire ». Il a été écrit par Robert-Vincent JOULE et Jean Léon BEAUVOIS et est paru aux
éditions Presses Universitaires de France. Cette édition est la 6
ème
et date de décembre 2009.
2 – Présentations synthétique de l’œuvre
2-1 Introduction
Robert-Vincent JOULE et Jean-Léon BEAUVOIS sont chercheurs en psychologie sociale et
professeurs des Universités, le premier à Aix-en-Provence, le second à Nice.
Ils publient régulièrement les résultats de leurs travaux dans des revues nationales et
internationales. Ils ont rédigé ensemble :
•Soumission et idéologies (1981),
•A radical dissonance theory (1996),
•la Soumission librement consentie (1998)
•et surtout le petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (2002), best-seller
vendu en France à plus de 250000 exemplaires.
Leurs productions scientifiques les placent parmi les personnalités les plus actives de la
psychologie sociale française.
2-2 Développement
L’ouvrage est constitué en 8 chapitres, eux même composés de sous chapitres et d’intertitres.
Avant d'entrer dans la structure de l'ouvrage, vous devez faire ressortir son objectif principal.
Ici, il s'agit de présenter la théorie de l'engagement et ses applications pratiques. La
psychologie de l'engagement repose sur une inversion des liens traditionnels entre les pensées
et les actes : ces stratégies n'ont pas pour objectif d'influer sur les idées des participants mais
de « créer des conditions dans lesquelles de nouveaux comportements pourraient apparaître
[...], comportements susceptibles d'en appeler d'autres correspondant aux objectifs de
l'intervention. » P. 28
Dans le premier chapitre intitulé : trouver un emploi, les auteurs s’appuient sur deux
expériences, l’une menée dans le cadre d’une formation pour la réinsertion de chômeurs de
longue durée et l’autre dans le cadre d’une formation qualifiante pour des jeunes de plus de 16
ans en échec scolaire. Au travers de ces deux exemples, les auteurs nous expliquent comment
en modifiant l’énoncé d’une règle ou le mode de rapport aux stagiaires, et ce sans toucher au
contenu entre le groupe de contrôle et le groupe expérimental, les effets sont probants tant sur
la motivation, que sur les résultats de réussite. Il est précisé page 17 : « Quand une personne
est déclarée libre de faire ou de ne pas faire quelque chose, et qu’elle le fait, elle va se
reconnaitre dans cet acte et en assumer la signification ». Ils ajoutent page 26 : « Ce principe

qui consiste à rapprocher le plus possible la personne des comportements qui ont pu être les
siens fonde les bases d’une pédagogie de l’engagement ».
Dans le second chapitre : les procédures de soumission librement consentie, les auteurs
développent trois principales procédures de soumission librement consentie qui permettent de
peser efficacement sur les comportements et les attitudes des gens. Il est écrit page 29 que ces
procédures sont : «… susceptibles de conduire les gens à faire de leur plein gré ce qu’on
attend d’eux ».
Pour décrire le principe de manipulation et d’automanipulation, les auteurs s’appuient sur un
concept de Kurt LEWIN ; l’effet de gel. Ils citent deux expériences, l’une menée auprès de
ménagères américaines et l’autre qui étudie la réaction d’une personne face au vol d’un objet
qui lui a été confié avec son accord durant l’absence de son propriétaire. Au travers de ces
expériences les auteurs mettent en avant le lien entre une décision énoncée préalablement à la
réalisation de l’acte par l’individu et la réalisation effective de l’acte en lui-même. Ils
indiquent page 31 : « La décision relie la motivation à l’action et semble avoir dans le même
temps un «effet de gel » qui est dû en partie à la tendance de l’individu à « adhérer à sa
décision » et en partie à son « engagement vis-à-vis de groupe ».
Puis ils parlent du second principe : « l’amorçage » qu’ils définissent comme le fait de faire
prendre à quelqu’un une décision sur une mauvaise information soit on ne disant pas toute la
vérité soit en mentant. Une fois la décision prise le principe la vérité est rétablie toute en
demandant à la personne si elle maintient son choix. Au travers de deux exemples ils
décrivent comment cette technique d’engagement amène un nombre important de personne à
maintenir leur choix énoncé malgré le fait de savoir que la tache énoncée est tronquée voire
même fausse.
Enfin il est évoqué le principe du pied dans la porte qui est défini page 41
comme : « demander peu pour obtenir beaucoup ». Au travers d’un exemple les auteurs nous
expliquent que cette technique consiste à entrer en contact avec les personnes avec une
première demande peu engageante pour ensuite établir un lien pour demander et obtenir ce
qui est recherché. Il est écrit page 43 : « Dans les recherches qui viennent d’être évoquées, on
constate qu’un premier comportement peu couteux …. Prédispose la personne, adulte ou
enfant, à accepter un nouveau comportement plus couteux ». L’effet de cette technique est
d’obtenir ce qui était recherché sans que la personne n’ait le sentiment d’avoir été forcée.
Nous pouvons lire page 50 : « …C’est la raison pour laquelle nous parlons de « soumission
librement consentie », soumission dans la mesure où le comportement réalisé est bien celui
que l’intervenant attendait, librement consentie dans la mesure où les gens n’ont subi aucune
pression et qu’ils ont, à juste titre, le sentiment d’avoir agi de leur plein gré ».
Le chapitre 3 intitulé : la psychologie de l’engagement, commence par une définition
commune pour définir au sens large l’engagement. Page 52 il est écrit : « être engagé ne
signifiant pas autre chose qu’être impliqué » et page 55 : « l’engagement est le lien qui unit
l’individu et ses actes comportementaux ».
Puis il est distingué deux type d’engagement, celui qui est provoqué par des éléments propre
à la personne ; qu’ils nomment l’engagement interne, et celui qui est provoqué par un élément
ou une personne extérieur à la personne ; ils parlent alors de l’engagement externe. Les
auteurs indiquent page 54 : « Tantôt l’individu s’engage en fonction de ses convictions dans
des actes importants du point de vue de ses convictions, tantôt la situation engage la
personne dans des actes dont l’importance peut être appréhendée en adoptant le point de vue

d’un observateur ». Puis ils mettent l’accent sur l’engagement externe, qui les intéresse plus
particulièrement.
Ils en donnent ainsi une définition plus précise page 60 : « l’engagement correspond aux
conditions de réalisation d’un acte qui, dans une situation donnée, permettent à un
attributeur [défini par l’auteur comme acteur et/ou observateur] d’opposer cet acte à
l’individu qui l’a réalisé ». En se référant à plusieurs expériences, les auteurs mettent l’accent
sur des variables de l’engagement comme la visibilité de l’acte et l’importance de l’acte. Page
64 il est écrit : « un acte est d’autant plus engageant qu’il est socialement visible ».
Concernant la variable de la visibilité de l’acte, ils insistent sur l’importance du caractère
public, clair, définitif et répétitif de l’acte. A ce sujet, page 64 il est développé : « le caractère
public (par opposition à anonyme), le caractère explicite (par opposition à ambiguë),
l’irrévocabilité et la répétition de l’acte ». Sur l’importance de l’acte, ils précisent également
l’importance des conséquences de l’acte et le coût de l’acte comme facteurs du degré de
l’engagement. Il est précisé page 68 : « Il en ressort que l’engagement augmente avec le coût
de l’acte ».
Puis les auteurs décrivent les raisons qui peuvent amener une personne à commettre un acte et
s’engager. Des raisons d’ordre externes, comme par exemple les récompenses et les punitions,
dont il est dit, page 69 : « … plus elles sont importantes, plus elles désengagent ». A contrario,
les raisons d’ordre interne et réalisé dans un contexte de liberté, engagent la personne.
Dans la seconde partie de ce chapitre il est décrit les effets de l’engagement, en portant
l’attention sur les effets dans les actes non problématiques, définis page 73 comme des actes
qui: « ne vont pas à l’encontre d’aucune de vos attitudes ou motivations » et dans les actes
problématiques, définis sur cette même page comme des actes: «qui vont à l’encontre de vos
convictions ou vos motivations ». Pour les effets de l’engagement concernant des actes
problématiques les auteurs, en s’appuyant sur des expériences fort intéressantes, nous
expliquent comment sur la base de situations qui sont en lien avec nos idées il est assez
courant d’obtenir l’engagement d’une personne. Il est indiqué page 80 : « …il est finalement
aisé de créer des circonstances qui engagent les gens dans les actes conformes à leurs
convictions, c’est-à-dire dans des actes non problématiques ». Pour les effets de l’engagement
dans un acte problématique ils expliquent, sur la base d’expériences menées, que dans
certaines conditions il est possible d’obtenir l’engagement d’une personne avec une condition
nécessaire voire primordiale ; qu’il ait été laissé à la personne la liberté de faire ou de ne pas
faire. Page 83, il est écrit : « Pour peu que son acceptation ait été obtenue dans un contexte
de liberté - d’engagement donc – il en vient à trouver son labeur intéressant». Dans cette
même idée les auteurs parlent page 85 du processus de rationalisation : « comme d’un
processus par lequel une personne ajuste à postériori ce qu’elle pense (ses attitudes) ou ce
qu’elle ressent (ses motivations) ».
Enfin dans le derniere partie ; indentification de l’action et engagement, il est mis en avant
l’importance que l’acte, sur lequel il est demandé à une personne de s’engager, soit bien
identifiable au sens qu’il soit bien inscrit dans une réalité. Il est écrit page 93 : « … les gens
préfèrent identifier leurs actes à des niveaux élevés, à des niveaux donc n’allant pas sans
incertitude ». Identification : processus qui consiste pour un individu à décider à quelle
catégorie d'actes il va rattacher un acte particulier. Coller des affiches contre la pollution
atmosphérique peut se rattacher à un positionnement écologiste, à un acte militant plus
général ou bien à un service rendu à quelqu'un qui nous l'a demandé. Cf. p. 91
Dans le quatrième chapitre intitulé ; Economie d’Energie, les auteurs s’appuient sur une
recherche action menée dans un hôpital avec pour but de réduire l’économie d’énergie.
Sur la bases de procédures propre à la théorie de l’engagement, telles que définies dans le
chapitre 2, ils nous expliquent, au travers des étapes de l’expérience, comment il est possible

de faire changer le comportement et l’attitude de professionnels hospitalier concernant la
consommation d’énergie. Page 108 il est précisé : « Les techniques utilisée (pied dans la
porte, amorçage, engrenage) se sont montrés particulièrement efficaces puisque la quasi-
totalité des personnes sollicitées a participé à l’intervention jusqu’à son terme et a réalisé les
comportements économes attendus en dépit de leur coût ».
Le cinquième chapitre, Lutter contre les accidents du travail, les auteurs s’appuient sur deux
actions recherches menées sur la sécurité au travail afin d’amener les personnes à utiliser plus
souvent les objets mis à leur disposition pour leur sécurité au travail. Page 112 il est indiqué :
« rechercher les actes préparatoires les plus à même de les prédisposer à librement consentir
à cet usage ». Comme dans le chapitre précèdent les résultats de ces expériences sont
concluants. A ce sujet il est indiqué page 115-116: « En somme, sans avoir eu recours à la
moindre pression hiérarchique, sans avoir davantage eu recours aux voies traditionnelles de
l’argumentation et de la persuasion, nous sommes quasiment parvenus à multiplier par deux
la probabilité de voir un ouvrier à son poste de travail, un jour J à une heure H, un casque de
protection sur les oreilles ». D’autre part il est mis en avant la force des procédures
d’engagement, comme par exemple le principes du pied dans la porte avec des premières
questions/demandes peu couteuses. Il est précisé page 121 : « ces résultats sont d’autant plus
remarquables qu’il n’a jamais été demandé aux monteurs de mieux respecter les règles de
sécurité. On s’est limité à les faire discourir, dans un contexte d’engagement, sur la manière
dont s’appliqueraient à leur activité de monteurs les règles générales de la charte ».
Dans le chapitre 6 ; combattre le Sida, les auteurs nous décrivent, au travers de deux actions
recherches menées auprès de lycéens et étudiants, comment les procédures de la théorie de
l’engagement se sont confrontés à l’objectif de modifier le comportement et l’attitude des
lycéens et étudiants dans l’utilisation du préservatif et le dépistage. Le postulat de départ des
psychosociologues engagés dans l’action est de dire que la prévention est intéressante mais
insuffisante pour avoir un effet sur le comportement et l’attitude des personnes. Il est écrit
page 125 : « Elle (la prévention) est insuffisante parce que le lien entre attitude et
comportement n’est malheureusement pas aussi direct que l’on a coutume de le croire…
surtout lorsqu’il s’agit de toucher un comportement précis comme utiliser un préservatif lors
d’une prochaine rencontre ». L’action recherche sur l’utilisation du préservatif met en
lumière que les procédures de l’engagement ont eu un effet sur le comportement mais
également sur l’attitude des lycéens concernant l’utilisation du préservatif. Les auteurs
écrivent page 140 : « Il fut ainsi observé que seuls les lycéens soumis à la stratégie
d’engagement étaient, après la campagne, plus nombreux à être en mesure de montrer à
l’enquêteur un préservatif qu’il avait par-devers eux (13% avant la campagne, 20% après) ».
Dans la seconde recherche action qui consistait à amener l’étudiant à accepter de réaliser un
dépistage volontaire, les procédures de l’engagement ont été mises à rudes épreuves, avec de
nombreux échecs. De nombreuses tentatives ont montré sur cette question du dépistage tout
l’écart entre l’intention déclaré et le comportement effectif. Page 146 il est écrit : « Nous
attendions, en revanche, une liaison plus étroite entre intention (décision de se faire dépister)
et comportement effectif ». Après de multiples expériences sans résultats probants, une
nouvelle procédure est expérimentée en introduisant une personne extérieur avec pour
fonction de s’opposer fortement à la position dominante. Il est indiqué page 151 : « Il
s’agissait, en somme, de faire de ce compère une « brebis galeuse » dont le rejet constituerait
le ciment d’une cohésion de groupe valorisante ». Avec cette nouvelle procédure de la théorie
de l’engagement les résultats de la recherche action sont beaucoup plus satisfaisants. Page 153
il est écrit : « Il nous semblait important de montrer, chiffres à l’appui, qu’on pouvait

légitimement prétendre toucher des comportements aussi sensibles que les comportements de
dépistage volontaire par des stratégies relevant de la psychologie de l’engagement ».
Dans le chapitre 7, La théorie de l’engagement : champs d’application, principes et règles,
l’auteur nous énonce les principes et règles importants inhérents à la théorie de l’engagement
selon que l’objectif est d’engager ou de désengager.
Dans le cas d’une action recherche à but d’engager le ou les personnes ciblées, l’agent social
(au sens de celui qui mène l’expérience) va rechercher à influer le comportement des uns ou
des autres sans les forcer. Il est précisé page 155 : « comment amener autrui à faire librement
ce qu’il doit faire ». Pour ce faire les procédures de la théorie de l’engagement s’appuie sur
les éléments propre à la personne (ou éléments internes). Page 157 il est écrit : « On sait
qu’un bon acte préparatoire ne doit pas s’accompagner de justifications extérieurs ».
Puis les auteurs nous décrivent les cinq principes d’action importants à la disposition de
l’agent social engagé dans une action recherche dont le but est d’engager. Ils indiquent page
165 : … et dont notre expérience d’intervenant nous a montré tout l’intérêt » :
•Le principe de naturalisation, consiste à rapprocher l’acte réalisé de la nature même de
la personne,
•Le principe de dénaturalisation, résulte du fait de dissocier l’acte réalisé, mais non
souhaité, de la nature de la personne,
•Le principe des attentes confirmées, vise à s’assurer que tout a été fait et que tout est
prêt pour que la personne prenne la décision et surtout celle attendue.
•Le principe du renforcement du surcroit, consiste à récompenser ou punir, tout en étant
vigilant à ce que ce principe ne vienne désengager la personne.
•Le principe de la juste identification de l’action, consiste à bien identifier le lien entre
l’acte et la personne dont il l’a obtenu.
Puis ils traitent du cas des actions recherches menées par un agent social dans le but de
désengager la personne. Il est entendu par désengagement l’action d’amener la personne à se
sortir d’un acte dans lequel elle n’arrive pas à se défaire et qui provoque des effets négatifs
pour la personne elle-même et les autres autour d’elle. Page 166 il est écrit: « si vous vous
êtes laissé entrainer dans une escalade d’engagement ou si un piège abscons vient soudain de
se refermer sur vous… ».
Il est précisé quelques règles en lien avec cette démarche en page 166 et167:
•« Se donner a priori des critères clairs permettant de savoir si la décision que l’on est
sur le point de prendre aura bien les effets escomptés
•Se donner, sur des critères et toujours a priori, des objectifs quantifiables et temporels,
•Décider, encore a priori, de l’écart par rapport aux objectifs au dela duquel on
renoncera à la décision,
•Le jour J, évaluer les effets de la décision et en tirer, sans plus attendre, les
conséquences.
Dans le 8
ème
et dernier chapitre ; une conception de la psychologie sociale appliquée, les
auteurs opposent deux types de psychologie sociale, l’une scientifique et l’autre pas.
Ils définissent le premier type de psychologie sociale, non scientifique, comme une approche
essentiellement, voire exclusivement rattachée aux savoirs communs. Il est dit page
177 : « En fait, tout se passe comme si, un problème étant posé, le psychologue social
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%








![Fiche projet n 2 [ PDF - 370 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008469253_1-179f3cc09c20e1657d654cc261bce6c5-300x300.png)