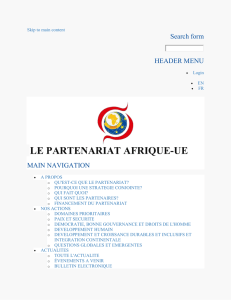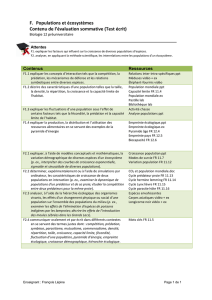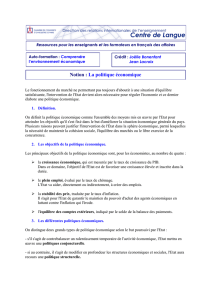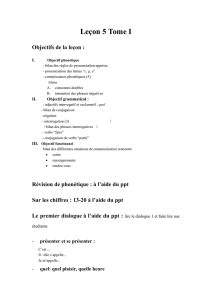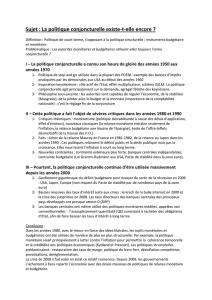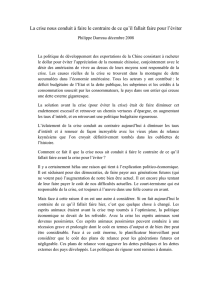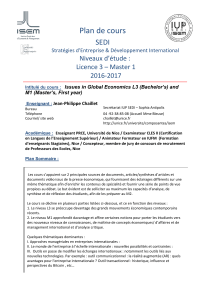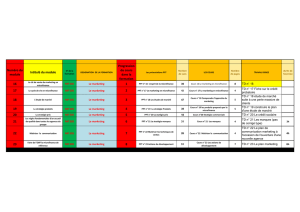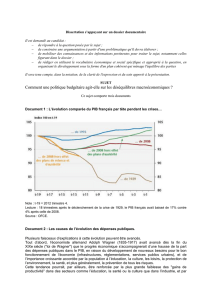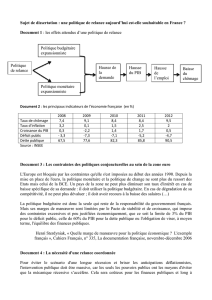PARTIE 3 : L`INTERVENTION DE L`ETAT I

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3
PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1
1
PARTIE 3 : L'INTERVENTION DE L'ETAT
I– POURQUOI L'ETAT INTERVIENT-IL DANS L'ECONOMIE?
A - L'extension du domaine d’intervention de l'Etat
1 - De l’Etat gendarme…
A l'origine les fonctions de l'Etat se bornent à assurer:
la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du pays
Cf: police, justice
la défense du territoire contre toutes agressions extérieures
Cf: diplomatie, défense nationale
Une fonction d’assistance (par charité chrétienne !)
Ces fonctions sont dites régaliennes et confère à l'Etat un rôle de gendarme.
2 - … A l’Etat Providence
Progressivement, l'Etat a étendu le domaine de son intervention à l'économie et au social: c’est
l’Etat providence.
Au sens large : ensemble des interventions économiques et sociales de l'Etat destinées à
soutenir l'économie (régulation économique), et à améliorer le bien-être social (régulation
sociale). "Wefare State" ou Etat du bien-être.
Au sens strict et historique, l'Etat Providence regroupe les interventions de l'Etat dans le
domaine de la protection sociale par l'intermédiaire de la sécurité sociale (assurance et
assistance)
3 - Les trois fonctions de l'Etat
Selon R.Musgrave l'Etat possède trois fonctions qui justifient son intervention économique et
sociale:
Allocation des ressources cad l'Etat producteur de services et de règles afin d’assurer une
allocation optimales des ressources et améliorer le bien-être social.
Répartition: l'Etat protecteur qui redistribue les richesses afin d’assurer une plus grande
justice sociale (Cf : la protection sociale : assurance et assistance)
Stabilisation: l'Etat régulateur économique qui réduit les déséquilibres économiques,
inflation et/ou chômage (Cf : la politique économique conjoncturelle).
Conséquence le poids de l'Etat augmente en longue période, c'est la loi de Wagner : les
dépenses publiques sont passées en France de 12% environ en 1870 à 55% en 2010.
Attention : les APU comprennent les APUL, les APUC et les ASSO.
Ppt : les différentes configurations de l’Etat
B – L’Etat producteur
1 - Pallier les défaillances du marché
L’intervention des pouvoirs publics dans l’économie se justifie d’abord pour pallier les
défaillances du marché : l'Etat répond à des besoins collectifs en produisant des services non
marchands ou marchands à partir de biens publics que le marché est incapable de produire lui-
même en raison du caractère indivisible de ses biens (biens collectifs).

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3
PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1
2
Ex : l’éclairage public (biens public non marchand), le transport ferroviaire (bien public marchand
en monopole naturel).
pour faire bénéficier l'économie d'effets externes positifs attachés aux biens publics ou pour
limiter les effets externes négatifs liés aux activités privées.
Externalité : Situation ou l’action d’un AE modifie volontairement ou involontairement la
situation d'un autre AE sans que cela passe par une transaction sur le marché cad un prix
Ex : Effet externe positif : la recherche fondamentale publique.
Ex : Effet externe négatif : la pollution
Outre le fait de produire à la place du secteur privée, l’Etat palie les défaillances du marché par :
La réglementation. Exple : interdiction de la publicité mensongère, rôle du BVA
L’information. Exple : labels et information sur la qualité des produits
L’incitation financière et fiscale. Exple : pollutaxe (internalisation des effets externes négatifs)
2 - Améliorer le bien-être
L’Etat produit des biens publics pour améliorer le bien-être social afin de permettre à tous les
citoyens, mêmes les plus pauvres de satisfaire ses besoins fondamentaux.
Ces biens publics permettent de satisfaire :
des services non marchands comme la santé, et l’éducation.
i.e: le secteur public non marchand cad les administrations publiques.
des services marchands qui comportent une dimension d’intérêt général
i.e : le secteur public marchand cad les entreprises publiques comme dans l’énergie et les transports.
Ppt : Le secteur public
C – L’Etat protecteur
1 - La redistribution
Pour protéger ses citoyens, l'Etat utilise principalement la redistribution qui vise à prélever des
ressources (impôts et cotisations) chez les AE afin de les redistribuer (prestations) à ceux qui en
ont besoin.
Il existe deux types de redistribution:
horizontale: elle consiste à se protéger contre les risques sociaux par le versement de
prestation d’assurance.
Risques sociaux : santé (maladie, invalidité, accident du travail), vieillesse/survie, famille
(handicap & logement), chômage.
verticale: elle consiste en un transfert de ressources de tous vers les plus pauvres dans un
souci de solidarité par le versement de prestation sociale d’assistance : Minima sociaux dont
RSA, aides sociales.
Ces deux types de redistribution correspondent généralement à deux logiques différentes:
Une logique "d’assurance", pour la redistribution horizontale, ou les droits sont contributifs.
D'origine allemande (Bismarck), cette protection est généralement financée par des
cotisations sociales obligatoires assises sur le travail prélevé par les organismes de sécurité
sociale.
Une logique d'assistance, pour la redistribution verticale, ou les droits sont non contributifs
D'origine anglaise (Beveridge), cette protection est généralement financée par l'Etat au
moyen de l'impôt.
En France, le système de protection sociale emprunte aux deux logiques, mais reste à dominante
horizontale.
Ppt : La structure des PO
Ppt : Les dépenses de protection sociale

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3
PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1
3
2. Quels sont les défis de l’Etat social ?
La protection sociale offre un filet de sécurité aux ménages.
Ppt : Le filet de protection des prestations sociale
Cependant, ces dernières années l'Etat providence connait une triple crise:
financière: croissance des dépenses et du déficit de la protection sociale ("trou de la sécu"),
Ppt : Le « trou de la sécu »
d'efficacité: malgré la hausse des dépenses les inégalités face aux risques sociaux se
creusent,
de légitimité: moins efficace, l'EP est remis en cause par les libéraux au nom des classes
moyennes.
II – LA POLITIQUE ECONOMIQUE CONJONCTURELLE
A – Les principes de la PE
1. Définition
La politique économique et sociale comprend 3 fonctions : allocation, stabilisation, redistribution
(R.Musgrave)
Elle possède un composante conjoncturelle (CT) et structurelle (LT).
La politique conjoncturelle assure la régulation de l’économie cad qu’elle consiste à corriger ses
déséquilibre induit par le cycle en prenant un ensemble de mesure en vue d'atteindre à CT (3 à 5
ans) 4 objectifs:
croissance et plein emploi (lutte contre le chômage),
stabilité des prix (lutte contre l’inflation) et équilibre du commerce extérieur.
Les objectifs de la politique économique sont résumés dans le carré magique de Nicolas Kaldor.
Ppt : Le carré magique
Cependant comme les objectifs sont difficiles à atteindre simultanément.
Ppt : Des objectifs difficiles à atteindre simultanément
2. Typologie & instruments (moyens d'action)
Il existe 2 grands types de PE:
les politiques de relance qui ont pour objectif la croissance et l'emploi,
les politiques de stabilisation qui ont pour objectif prioritaire la lutte contre l'inflation et
l'équilibre du commerce extérieur.
Attention : ces politiques peuvent aussi avoir comme objectif de réduire le déficit et la dette
publique, mais dans ce cas elles sont procycliques au lieu d’être contracyclique.
Il existe 2 grands instruments:
le budget de l'Etat central: la politique budgétaire,
le monnaie et le taux d'intérêt: la politique monétaire
B - Les différentes politiques conjoncturelles depuis l’après-guerre
1. Les politiques d’inspiration keynésienne
Historique :
La politique économique d’après-guerre, durant les 30 glorieuses est d’inspiration keynésienne.

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3
PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1
4
Elle cherche constamment un équilibre entre chômage et inflation (courbe de Phillips) par des
politiques de «stop and go» ou « réglage fin » utilisant un mixage des politiques budgétaires et
monétaires (policy mix).
Ppt : La courbe de Phillips à la base des politiques de « stop and go »
Attention : Ces politiques sont contra-cycliques, elles cherchent à amortir l’ampleur des cycles.
La politique de relance keynésienne :
Le principe de la PE de relance a été élaboré par J.M Keynes dans son ouvrage : « Théorie
générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie » (1936)
La relance vise à rétablir l'expansion et le plein emploi en accroissant la demande globale,
principalement au moyen de la politique budgétaire.
Ppt : Le budget de l’Etat et des administrations publiques
Keynes propose que l'Etat finance, par les dépenses budgétaires supplémentaires qui accroissent
le déficit, une politique d'investissements publics autonome, type grands travaux.
Le déficit public initial doit être compensé par l'accroissement des recettes fiscales et la
diminution des dépenses liées au regain d'activité.
Ppt : La PB de relance
Ces dépenses doivent engendrer une hausse plus importante de la production et des revenus
grâce à l'effet multiplicateur.
Ppt : Schéma du multiplicateur
Attention: il existe deux fuites qui limitent l'effet multiplicateur et donc l'efficacité des politiques de
relance: l'épargne et les importations
Le « Policy mix » keynésien propose une PM de relance visant à baisser les taux d’intérêt pour
accroître la demande.
Ppt : La PM de relance
2. Le retour des politiques libérales
Historique :
A partir de la fin des années 70, les politiques de « réglage fin », perdent de leur efficacité, c’est
la stagflation : inflation et chômage.
Ex : en France le chômage atteint 6.3% en 1981, la croissance ralentit à 0.9% et l’inflation grimpe
à 13.4% traduisant un conflit autour de répartion.
Conséquence, elles sont peu à peu remplacées par des politiques libérales de rigueur dite de
désinflation compétitive, inspirée par M.Frideman et le courant monétariste.
Conséquence, l’inflation se réduit fortement à partir des années 80, mais le chômage reste
durablement élevé. Ces politiques inspirent encore aujourd’hui les principaux pays développés.
La politique de rigueur :
La politique de rigueur a pour objectif la lutte contre l’inflation et le rétablissement des équilibres
extérieurs au moyen d’une politique monétaire et budgétaire restrictive : c’est la désinflation
compétitive
La PM restrictive entraine la diminution de l’inflation (désinflation) par une hausse des taux
d’intérêts
Ppt : Une PM de rigueur la base de la désinflation…
Si l’inflation diminue, les entreprises gagnent en compétitivité prix et vendent plus à l’étranger ce
qui réduit le déficit commercial.
Ppt : …compétitive
La PB restrictive est utilisée en complément afin de comprimer la demande globale et ainsi
ralentir la hausse des prix.
Ppt : La Politique Budgétaire de rigueur

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3
PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1
5
Les dangers de la politique de rigueur :
A court terme cette politique freine la demande, la croissance et l’emploi, surtout si elle est
utilisée de manière pro-cyclique, comme actuellement, elle risque d’entraîner la récession.
Ppt : « Les dangers d’une politique de rigueur »
Cependant, théoriquement, à LT, cette politique n’est pas l’ennemie de l’emploi (JC Trichet) car :
une meilleure compétitivité prix des entreprises leur permet d’accroître leurs bénéfices,
cela permet d'aboutir au théorème de Schmidt : « les profits d’aujourd’hui sont
investissements de demain et les emplois d’après-demain » (Thèse libérale)
Historiquement, la politique de désinflation compétitive alterne :
récession à court terme (cf : danger des politiques de rigueur),
puis expansion à long terme (cf : la politique de rigueur n’est pas l’ennemie de l’emploi)…
puis retour de la récession en raison de la déformation du partage salaire/profit en faveur
des profits qui finit par déprimer la demande anticipée (effet accélérateur négatif) et donc la
croissance.
Ppt : L’impact de la politique de désinflation compétitive française
3. Les conséquences de la crise des subprimes : entre relance et rigueur
De la relance… :
La crise financière des subprimes a entrainé dans un 1er temps le retour des politiques de relance
et éviter, en France notamment, une dépression trop importante en 2009.
Le déficit budgétaire des principaux pays développés s’est fortement accrue jouant son rôle de
stabilisateur automatique.
Stabilisateur automatique : le déficit budgétaire lié à un pic de récession, vient soutenir la demande
défaillante et exerce un effet contra cyclique (inversement dans les périodes d’expansion)
La BCE a fortement diminué ses taux d’intérêts afin d’éviter de « Crédit Crunch ».
Ppt : La PE conjoncturelle de relance en 2008-2009
… à la rigueur:
Les déficits publics se sont fortement accrue entre 2008 et 2012 entraînant l’accroissement de la
dette publique : C’est la crise des dettes souveraines.
En effet, l’interdiction faite à la BCE de prêter directement aux Etats a entrainé une envolée de la
charge de la dette en raison de la hausse des taux d’intérêts liée à la prime de risque.
Ppt : La crise des dettes souveraines
Cela conduit:
certains pays au bord de la cessation de paiement par effet boule de neige de la dette
(Grèce, Espagne, Italie…)
Ppt : L'effet "boule de neige" de la dette
au retour de mesure d’austérité afin de réduire la dette et l’adoption d’un pacte budgétaire
(régle d’or). (Voir II)
à une forte dégradation du bien-être des populations : hausse du chômage, creusement des
inégalités, hausse de la pauvreté…
Attention: ces mesures risquent d’accroitre l’insolvabilité des pays concernés, et les entrainer dans
un cercle vicieux de l’austérité perpétuelle … sans pour autant régler le problème de la dette !
Rq : L’austérité conduit à la dépression ce qui accroît le poids de la dette dans le PIB !
Synthèse :
Ppt : Crise des subprimes et politique budgétaire
C – La politique économique conjoncturelle dans le cadre européen
1 – La coordination des politiques économiques
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%