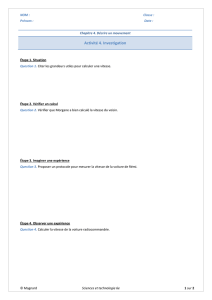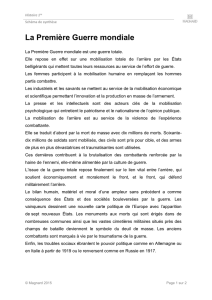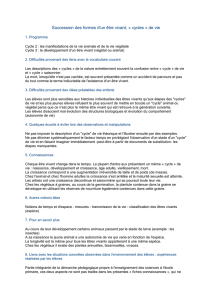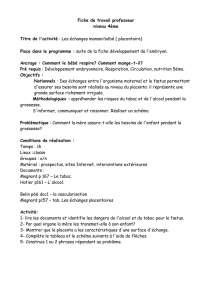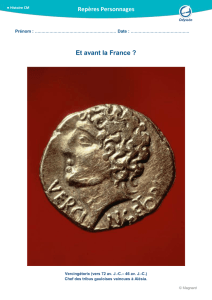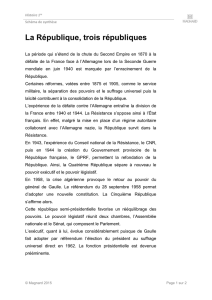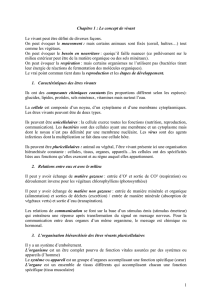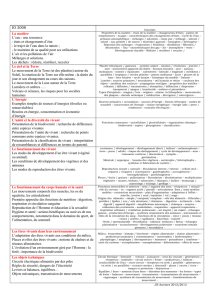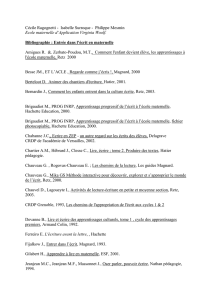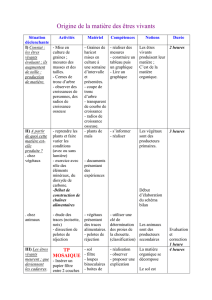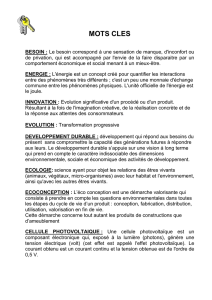Attestation de maîtrise des connaissances et compétences

Attestation de maîtrise des connaissances et compétences - Palier 2 CM2
La culture scientifique et technologique (p: 9)
OUI NON
Pratiquer une démarche scientifique et technologique
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer questionner…
Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions
Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral
Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des
activités de la vie courante
Le ciel et la terre
La matière
L’énergie
L’unité et la diversité du vivant
Le fonctionnement du vivant
Le fonctionnement du corps humain et la santé
Les êtres vivants dans leur environnement
Les objets techniques
Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable et agir en
conséquence

Aide à l’évaluation des acquis
Pratiquer une démarche scientifique ou technologique
Outils d’évaluation pour l’attestation
du palier 2
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner Ex : 5.1- 5.2 doc Eduscol
Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions Ex : 2.1- 2.2- 3.1 doc Eduscol
Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral
Ex : 2.3- 3.2 doc Eduscol
Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie
courante
Thèmes
Savoirs à construire pour l’élève au cours de toute la scolarité
élémentaire
Connaissances à enseigner pour l’enseignant (le programme)
Propositions d’items pour le livret
d’évaluation (liens avec le programme)
En gras « minimum exigible » pour
l’attestation du palier 2 du socle commun
Outils d’évaluation pour l’attestation
du palier 2
Le ciel et la terre
Le mouvement de la Terre
(et des planètes) autour
du Soleil, la rotation
de la Terre sur elle-même
; la durée du jour et son
changement au cours des
saisons.
– L’alternance du jour et de la nuit en un lieu de la
Terre correspond au passage de ce lieu successivement dans la zone de l’espace éclairée par
le Soleil et dans la zone d’ombre portée par la Terre.
– La trajectoire «apparente » du Soleil s’effectue de la gauche vers la droite pour un
observateur situé face à celui-ci. La rotation de la Terre sur elle-même s’effectue donc de la
droite vers la gauche, c’est-à dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
– Chaque jour, les habitants de la Terre constatent que le Soleil apparaît vers l’est, monte
dans le ciel, culmine (est au plus haut au-dessus de l’horizon) en passant au-dessus du sud
(dans l’hémisphère Nord), redescend et disparaît vers l’ouest (cette affirmation n’est pas vraie
dans les régions polaires). En Europe, la trajectoire du Soleil est parcourue de gauche à droite
pour un observateur situé face à lui.
Savoir que le soleil se déplace d’est en ouest dans le
ciel
Savoir que selon les saisons, l’amplitude de la course
du soleil varie
Savoir que la durée des jours et des nuits varie au
cours de l’année et comment celle-ci varie.
Savoir à quoi correspondent les équinoxes et les
solstices.
Savoir que la succession du jour et de la nuit est due
à la rotation de la terre sur elle même
Situation n°2 P :126 Magnard

– La trajectoire apparente du Soleil dans le ciel se modifie au cours des saisons. Aux latitudes
de l’Europe, elle est la plus courte au solstice d’hiver (le Soleil se lève alors pratiquement au
sud-est et se couche pratiquement au sud-ouest) et la plus longue au solstice d’été (le Soleil
se lève pratiquement au nord-est et se couche pratiquement au nord-ouest).
Ce n’est qu’aux équinoxes de printemps et d’automne que le Soleil se lève exactement à l’est
et se couche exactement à l’ouest (sur un horizon parfaitement horizontal).
– Quand il reste longtemps levé et culmine haut dans le ciel, le Soleil chauffe davantage le sol :
c’est la saison chaude. À l’inverse, quand les journées sont courtes et que le Soleil reste assez
bas, c’est la saison froide. La durée de la journée évolue au fil de l’année. Dans les régions
tempérées, elle est la plus courte à la date du solstice d’hiver et la plus longue à la date du
solstice d’été.
À la date des équinoxes, la durée de la journée (mesurée entre le coucher et le lever du Soleil
sur un horizon fictif parfaitement horizontal) est pratiquement égale à 12 heures. Il y a alors
égalité entre la durée de la journée et celle de la nuit, c’est l’origine du mot « équinoxe ».
Savoir que la terre tourne d’ouest en est
Situation n°16 p :134 Magnard
Le mouvement de la Lune
autour de la Terre.
Repérer des régularités dans le phénomène des phases
Même si on la voit différente, il n’y a qu’une seule lune.
La lune ne brille pas (comme les étoiles), c’est le soleil qui l’éclaire.
La lune reflète la lumière du soleil sur la terre.
Au fil des jours, la lune change progressivement d’aspect.
On appelle ces changements : les phases de la lune.
Elles sont, dans l’ordre :
-la nouvelle lune,
-le premier croissant qui s’éclaire par la droite (D= Premier quartier)
-ensuite le premier quartier
-vient ensuite la lune gibbeuse
-la pleine lune (la lune est éclairée entièrement)
-vient ensuite la lune gibbeuse (éclairée par la gauche)
-vient le dernier quartier ( C= dernier quartier)
-enfin le dernier croissant
Ce cycle complet dure : 29 jours ½ : c’est une lunaison.
La lune parfois ne se lève pas toujours à la même heure. C’est pour cela que l’on ne la voit
briller dans le ciel le jour comme la nuit.
Chaque jour la lune change d’aspect car depuis la terre, nous la voyons éclairée différemment
par le soleil.(puisqu’elle tourne autour de nous).
· Savoir que ces différentes formes sont la partie
éclairée de la lune
· Savoir que le Soleil éclaire la Lune
· Savoir que la Lune tourne autour de la Terre
· Connaître le cycle lunaire :
Durée d’une lunaison
Les différentes phases de la lune-leur nom
Pouvoir prévoir l’évolution de l’aspect de la
lune dans le ciel
Situation n°11 p : 131 Magnard
+Ex : A) n°1 Les 2 premières questions p : 160
Magnard élèves

Lumières et ombres. – Une ombre nécessite une source de lumière. Sa forme dépend de la forme de l’objet, de sa
position et de son orientation par rapport à la source.
– La lumière suit un trajet rectiligne dans un milieu
homogène.
– Un objet opaque éclairé par une source de lumière a une partie éclairée et une partie à
l’ombre. Les formes visibles de ces surfaces varient suivant la place de l’observateur.
Savoir que l’ombre d’un objet ne donne des
informations que sur les contours de l’objet
Savoir que l’ombre d’un objet n’existe que si l’objet
est éclairé par une source lumineuse (soleil- lampe)
Savoir que l’ombre se forme sur un support (mur- sol-
table…)
Savoir qu’il y a opposition entre l’ombre et la source
lumineuse (par rapport à l’objet)
Situation n°5 p : 128 Magnard
Volcans et séismes, les
risques pour les sociétés
humaines.
– Le magma est le résultat de la fusion partielle de roches. Cette fusion se déroule à quelques
dizaines de kilomètres de profondeur. Le magma remonte vers la surface, empruntant une ou
plusieurs fissures de la croûte terrestre. La sortie du magma (et ses conséquences et
phénomènes associés : nuées ardentes…) constitue une éruption volcanique. Une éruption
présente souvent des signes précurseurs, une période d’activité maximale (écoulements de
laves, explosions, nuées ardentes…) ; enfin, une période d’accalmie plus ou moins longue.
– Un séisme correspond au mouvement brusque d’une ancienne fracture de roches en
profondeur ou à la formation d’une nouvelle faille. Des vibrations plus ou moins fortes
peuvent être ressenties en surface. Ces manifestations peuvent être catastrophiques ou
imperceptibles.
– L’étude des risques majeurs naturels permet de rechercher les conditions de leur
prévention.
Connaître les manifestations et les conséquences
d’un tremblement de terre
Comprendre les causes d’un tremblement de terre
· Connaître et pouvoir modéliser l’origine
des séismes
· savoir ce que sont les plaques tectoniques
· Connaître les notions de plaques, magma,
subduction, faille
Savoir ce que signifie : sismologues, séisme,
magnitude,
épicentre, réplique, échelle de Richter
Savoir localiser les plaques tectoniques et les volcans
sur une carte
Ex : D) p : 161 Magnard élèves
La matière
L’eau : une ressource
- états et changements
d’état ;
- le trajet de l’eau dans la
nature ;
- le maintien de sa qualité
pour ses utilisations.
– La glace, l’eau liquide et la vapeur d’eau sont trois états physiques de l’eau.
–
L’eau gèle (ou reste solide) lorsque elle est portée à une température inférieure à 0°C et,
réciproquement, la glace fond (ou l’eau reste liquide) lorsqu’elle est portée à une
température supérieure à 0°C. La masse se conserve au cours de cette transformation.
– À l’air libre et dans les conditions usuelles, l’eau bout à une température fixe voisine de
100 °C. La valeur de celle-ci n’est affectée ni par la durée du chauffage ni par la puissance de
la source. L’ébullition se caractérise par la transformation d’eau liquide en vapeur d’eau se
produisant dans tout le volume du liquide.
La vapeur d’eau présente dans l’air ambiant, état gazeux de l’eau, est imperceptible à nos
sens.
– Le passage de l’état liquide à l’état gazeux peut se produire seulement en surface : c’est
l’évaporation. Le phénomène est alors plus lent et se produit à toute température (en
dessous de 100°C). Au cours d’une évaporation, l’eau ne disparaît pas. Elle se transforme en
vapeur d’eau qui se mélange à l’air ambiant.
Au cours d’une condensation, l’eau devient visible mais elle était présente dans l’air sous
forme de vapeur invisible avant de se condenser.
Connaître les trois états de l’eau
Savoir que le passage d’un état à l’autre est lié à la
température
Connaître la terminologie : fusion- évaporation-
vaporisation- solidification –condensation-
sublimation…
Connaître la température de solidification de l’eau
Connaître la température de fusion de l’eau
Connaître le cycle de l’eau dans la nature
Savoir « nettoyer » de l’eau. Faire la distinction eau
pure – eau limpide
Ex B) p : 146 Magnard élèves
Situation n°2 p : 89 Magnard

_De l’eau sale à l’eau claire : Comment obtenir de l’eau limpide à partir d’une eau
contenant de la terre et des débris de végétaux. (Connaître un procédé de séparation : la
filtration)
Infiltration et risque de pollution par les engrais. Filtration et infiltration dans la nature :
Comment prouver que l’engrais va dans les eaux souterraines ?
Savoir que certaines substances se dissolvent dans l'eau
Notion de dépollution : faire prendre conscience des dégradations infligées par l’homme sur
son
environnement, trouver des solutions pour retrouver une eau de qualité, faire la différence
entre eau
limpide et eau pot
able, comprendre la nécessité et le fonctionnement d’une station
d’épuration.
Fabrication d’un filtre naturel qui ne fait que nettoyer l’eau partiellement, sans la dépolluer
: le rôle du sol et du sous-sol en tant que filtre à eau, imaginer un système simple pour
filtrer l’eau pour prendre conscience que cette eau sera claire mais non potable.
L’air et les pollutions de
l’air.
– L’air est de la matière au même titre que les liquides et les solides puisque l’air est pesant.
– La matérialité se manifeste également par d’autres propriétés : l’air peut être transvasé
comme les liquides, l’air peut transmettre un mouvement comme les solides, l’air peut
résister à un liquide, à un solide ou au mouvement (parachute), le vent est de l’air en
mouvement…
– L’air est un excellent isolant thermique
_L’air est composé de plusieurs gaz et peut être plus ou moins pollué (chargé en gaz
polluants). Réflexion sur la qualité de l’air et les moyens d’en réduire la pollution.
-L’air a une masse. On peut le peser.
Savoir que l’air est un gaz composé de plusieurs
autres gaz
Savoir que l’air est de la matière.
Comme toute autre matière :
Savoir que l’air a la capacité à s’opposer à
une autre matière, l’eau.
Savoir qu’on peut agir sur d’autres
matières avec l’air.
Savoir qu’on peut transvaser l’air.
Savoir que l’air peut mettre en
mouvement une autre matière.
Savoir que l’air a une masse.
Mélanges et solutions. –
Certains gaz, certains liquides, certains solides, peuvent se dissoudre dans l’eau
(dissolution) en quantité appréciable mais pas illimitée. Lors d’un mélange ou d’une
dissolution, la matière, et donc la masse, se conservent.
– Dans le cas d’un mélange homogène, on ne voit
plus de particules solides. Le seul moyen de récupérer la substance introduite dans le
liquide est alors l’évaporation. Dans le cas d’un mélange hétérogène, on voit des substances
solides en suspension ou en dépôt au fond du liquide. On peut récupérer le solide par
filtration ou décantation (dans le cas d’un dépôt) ou encore par évaporation
Savoir la différence entre mélanges homogènes et
hétérogènes.
Connaître et utiliser à bon escient le phénomène de
décantation, de filtration pour récupérer un solide
dans un liquide
Savoir comment récupérer un solide dissout dans un
liquide: par évaporation.
Situation n°1 p : 33 Magnard
Situation n°5 p :35 Magnard
Les déchets : réduire,
réutiliser, recycler.
Il existe plusieurs sortes de déchets : les déchets biodégradables- les recyclables – les
autres
Connaître les caractéristiques des déchets biodégradables. Connaître les conditions
favorables à la biodégradation. Expérience test avec une décharge miniature.
Le recyclage => Un exemple : le recyclage du papier en classe
Réflexion autour des emballages.
Notion de dépollution. Que faire de l'eau polluée lors de la traversée d’une décharge ?
Fabrication d'un filtre naturel, qui ne fait que nettoyer l'eau partiellement, sans la
dépolluer.
Savoir repérer des déchets organiques des autres.
Connaître les notions : biodégradable- recyclable
Ex G) p : 97 Magnard élèves
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%