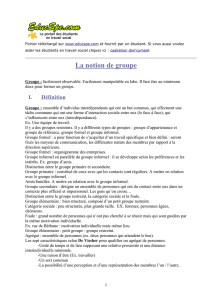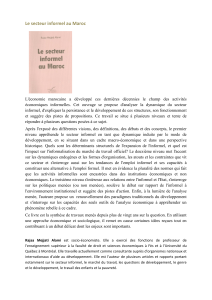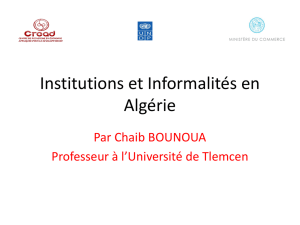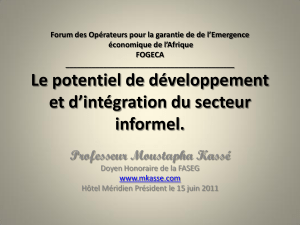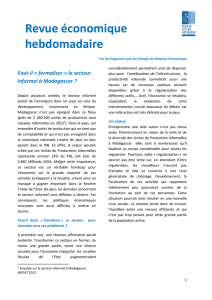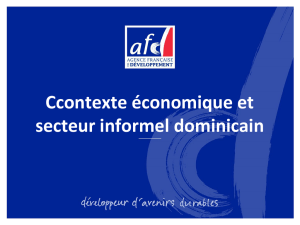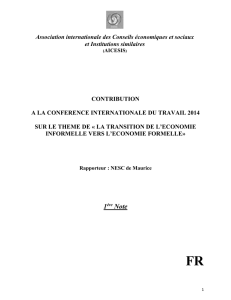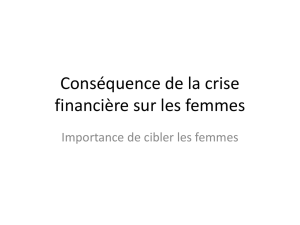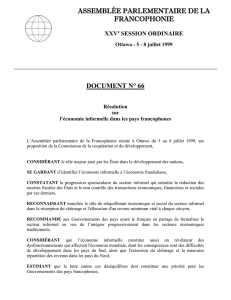« Prix relatifs et effets de substitution formel/informel »

Les déterminants micro-
économiques de la présence d’un
dualisme formel/informel
en Afrique sub-saharienne1
Some microeconomic
foundations of formal/informal
dualism in sub-saharan Africa
BOYABÉ JEAN BERNARD 2
Résumé : Cet article propose une interprétation de la caractéristique duale des économies des
pays en développement. Le dualisme retenu est celui qui distingue le secteur informel du
secteur formel. Un cadre d’analyse micro-économique permet d’analyser l’impact d’une
modification des prix relatifs sur la demande. Dans le contexte de l’arbitrage, un différentiel
de prix en faveur du secteur informel, et un différentiel de qualité en faveur du secteur formel,
est de nature à entraîner un phénomène de substitution entre les deux secteurs. Dans ce cadre,
le secteur informel serait handicapé dans la compétition qui l’oppose au secteur formel. On
montre que l’existence du secteur informel, et donc les déterminants du dualisme, repose sur
des mécanismes complémentaires à ceux qui sont traduites dans les variables quantitatives et
qualitatives habituelles.
1 Je remercie les différentes personnes qui ont bien voulu porter un regard critique su les
versions précédentes. Bien entendu, je suis le seul responsable des erreurs et omissions qui
subsisteraient.
2 Université Lille I.
Abstract : In this paper, we propose an interpretation of dualism characterizing developping
countries. The formal/informal dualism is analysed here. A microeconomic framework enables to
analyse effects on demand of relative price distorsion. Normaly, qualitative and quantitative
differences between formal and informal sectors should lead to substitution between the two
sectors, on the basis whom informal sector should have ceased to exist. Our approach is to show
that the existence of informal sector lays on specific mechanisms, relative to social interactions.
JEL :
MOTS CLÉS : secteur informel, dualisme, Afrique subsaharienne, interactions sociales,
marchandage, prix implicite.
I / Introduction : définition et présence du dualisme formel/informel
L’informel suscite encore des débats controversés, tant du point de vue de l’approche du
phénomène que de celui de sa définition même. Dans le but de présenter un cadre
d’analyse, nous proposons, dans cette première partie, de revenir brièvement sur
l’essentiel de ce débat. Une définition sera proposée à la lumière des travaux qui ont
suivi les approches dualistes des économies en développement. La deuxième section
présente le cadre d’analyse de la relation qui existe entre les secteurs formel et informel.
Du point de vue micro-économique, une variation des prix relatifs des produits est de
nature à favoriser un phénomène de substitution d’un secteur à l’autre. La troisième
section montre en quoi ce phénomène de substitution peut être limité, notamment
pourquoi le secteur informel continu d’exister, malgré son handicap dans la compétition
qui l’oppose au secteur formel. Des implications macro-économiques sont tirées dans la
dernière section.
1. Définition

On peut remonter aux travaux de Todaro (1969) et de Harris et Todaro (1970), à la
suite de Lewis (1954), pour retrouver les premières analyses fondées sur une
conception duale des économies en développement. D’une distinction urbain/rural,
les travaux ont évolué vers un dualisme formel/informel (Mazumdar, 1976 ;
Charmes, 1990 ; Datta Chauduri, 1989 ; Gupta , 1993 ; etc.). De façon générale,
l’informel est considéré comme un secteur "passif" destiné à « fournir de la main
d'œuvre à un taux de salaire déterminé par le revenu de subsistance ». Selon Datta
Chauduri (1989), par exemple, ce secteur (informel) est un « point d’entrée », dans
les villes, des migrants qui quittent les campagnes avec l’espoir d’avoir un revenu
urbain supérieur à celui qu’ils obtiendraient dans le secteur agricole rural. Ne
pouvant immédiatement trouver un emploi dans le secteur formel urbain, ces
migrants mènent dans des activités informelles, celles-ci apparaissant comme une
solution d’attente, et donc provisoire.
Il est d’autant plus nécessaire d’inverser cette logique de raisonnement qu’il présente
l’inconvénient d’être déterministe et séquentiel. Il s’agirait alors de considérer que
l'informel possède son propre dynamisme lui permettant de concurrencer le secteur
formel. Ce dynamisme peut être mis en évidence à travers les caractéristiques de
l’offre, de la demande et des pratiques de prix qui rappellent les marchés les plus
purs de la théorie économique3.
La définition même du secteur informel est loin de faire l’unanimité chez les auteurs
qui s’y sont intéressés. Pour se rendre compte de la difficulté que ces auteurs ont à
s’entendre sur les critères, on peut se référer à Hugon (1991). Une définition
statistique s’appuie sur le critère du non enregistrement ou out-law (absence de
comptabilité, non respect de la codification et de la fiscalité, chiffre d'affaires ou
nombre de travailleurs limité. Une définition fonctionnelle utilise des critères
d’organisation : "activités à petite échelle où le salariat est limité, où le capital
avancé est très faible mais où il y a néanmoins circulation monétaire et production
de biens et services onéreux" (Hugon, 1991 ; p. 155). Dans un article récent,
Morrisson et Mead (1997) reviennent sur ces critères de définition. Sur la base
d’enquêtes portant sur plusieurs pays, ils proposent un nouveau cadre de définition
qui présente l’avantage de tenir compte des diversités géographiques.
Sans nous attarder sur ce débat, nous nous proposons ici de partir d’une conception
de l’informel qui fait plus office d’un cadre d’analyse que d’une définition
proprement dite. Ce choix est donc d’ordre méthodologique. Pour cela nous faisons
référence aux principales caractéristiques des unités de production qui le composent.
Ces unités appartiennent généralement à « des personnes travaillant pour leur propre
3 L’objet de cet article n’est cependant pas de traiter cet aspect walrasien du problème.
compte, avec l'aide des travailleurs familiaux non rémunérés ou en association avec des
membres du même ménage ou d'autres ménages » (BIT, 1993 ; p. 17). Elles se
distinguent de celles du secteur formel principalement par une absence de contrôle par
l’État (Roubaud et Séruzier, 1991). Relèverait ainsi du secteur informel toute activité
économique qui échappe entièrement à l’État et qui est exercée par des agents
économiques travaillant pour leur propre compte, dans des petites unités de production.
Celles-ci sont assimilables aux ménages dans le système de comptabilité nationale.
Cette définition du secteur informel présente l’avantage de rendre souple le passage d'un
raisonnement en terme urbain à un raisonnement en terme rural, et inversement. La
distinction urbain/rural serait ainsi moins significative. Pour illustrer l'axe commun, qui
permet d’économiser une analyse qui tiendrait compte de cette distinction, on peut citer
deux exemples : 1) l'agent économique du secteur informel rural utilisera l’output de sa
production saisonnière (les graines de sa dernière récolte) pour sa propre consommation
domestique, mais aussi, il en affectera une partie au marché, soit par la vente directe à
d'autres consommateurs, et de façon informelle, soit par la vente des produits issus de sa
transformation, à travers une fonction de production. 2) De même, l'agent économique
du secteur informel urbain est demandeur d’un produit quelconque (un magnétoscope
d'occasion ou neuf, par exemple) qui sera destiné aussi bien à une consommation
domestique qu’a une activité de service marchand informel (duplication de cassettes
vidéo, par exemple). Il en est de même pour l'exemple (classique et récurrent dans les
analyses sur l'informel) du cadre, salarié urbain, qui utilise l’automobile mis à sa
disposition par l’administration ou par son entreprise, aussi bien pour ses propres
besoins domestiques que pour une activité de transport informelle. Le secteur informel
dont il est question peut donc être urbain comme rural, archétype du marché qui
approvisionne les consommateurs en produits et services.
Moyennant quelques restrictions, on peut s’accorder avec Becker (1965) pour supposer
que l’agent représentatif du secteur informel : 1) possède une fonction domestique de
production de biens ou satisfactions à partir des produits du marché ; 2) possède une
fonction de production marchande de biens ou de services dans laquelle les produits du
marché sont des inputs ; 3) a une fonction de production domestique qui peut s’assimiler
à sa fonction de production marchande en ce sens que nous avons affaire à un
producteur caractéristique du secteur informel (de très petite taille et dont l’organisation
s’apparente à un ménage).
2. Du dualisme formel/informel à la distinction marché formel/marché informel
Les approches dualistes (Todaro, 1969 ; Harris et Todaro, 1970 etc.) et celles qui se
sont développées par la suite (Stark, 1982 ; Gupta, 1993 ; Datta Chauduri, 1989 ; etc.)
2

partent de l’existence de deux secteurs de l'économie. Les dualismes les plus
fréquemment distinguées sont l'agriculture et l'industrie, le traditionnel et moderne et
enfin le rural et l’urbain. Chacun est fondé sur le différentiel dans les
caractéristiques des secteurs considérés. Par exemple, le dualisme rural/urbain est
souvent fondée sur le différentiel de salaire entre les deux secteurs.
Le dualisme formel/informel repose sur certains facteurs de différenciation dont les
plus couramment retenus sont (Steele, 1975) :
- les facteurs spatiaux, de démographie et de distribution de ressources qui
déterminent la taille et l'étendue du marché;
- les niveaux de revenu des actifs et leur niveau de qualification qui déterminent le
profil des producteurs ;
- les capacités de financement et les capacités techniques qui déterminent les
caractéristiques et les niveaux d'activité des unités de production.
Ces différents facteurs reflètent les caractéristiques des agents qui apparaissent à
travers le cadre de définition du secteur informel retenu précédemment. Cependant,
les secteurs, formel et informel, peuvent être considérés comme deux marchés
concurrents de biens et services4. Derrière l’expression « marché informel », se
cache le secteur informel lui-même. Loin de sophistiquer le sens du mot
« informel », la notion de marché ici permet simplement d’introduire les notions
d’offre, de demande et de prix. La notion de marché étant univoque, l'adjonction de
l'épithète "informel" ne modifie nullement son sens.
Du côté de la demande, on peut globalement cerner le rôle que joue le secteur
informel à travers trois points, conformément à la diversité de l'origine de la
demande (Roubaud, 1993) et à l'hypothèse du dualisme. Ce rôle consisterait à : i)
permettre aux actifs du secteur informel de satisfaire leurs besoins fondamentaux en
trouvant dans leur propre branche les produits nécessaires ; ii) permettre aux actifs
du formel et à certaines catégories d’agents plus ou moins aisées (touristes, cadres,
etc.) de satisfaire une partie de leurs préférences dans des conditions de flexibilité ;
iii) permettre à la catégorie la plus démunie de la population d’accéder aux produits
4 Cependant, il est possible de dépasser la distinction entre ces derniers pour se fonder sur
une hypothèse de travail selon laquelle « l'analyse de la demande des consommateurs en biens
et en services ne doit pas s'appuyer directement sur des familles de biens ou de services, mais
sur des familles de satisfactions, de besoins ou de fonctions » (Gadrey, 1992). De ce point de
vue, peu importe que l’on s’intéresse au marché informel d'un produit particulier ou d'un
service donné. Une typologie des produits et services (Hugon, 1980), qui permettrait une
classification des « marchés informels »», n’est donc pas nécessaire.
essentiels, non accessibles sur le marché formel compte tenu du niveau de leur revenu
réel.
Du côté de l’offre, on peut considérer deux impératifs : (i) répondre à la demande qui ne
peut être satisfaite par le secteur formel; (ii) permettre à ceux qui sont à la recherche de
sources supplémentaires de revenus d'avoir des débouchés. Dans le premier cas, il s’agit
de mettre en avant les limites du secteur formel à couvrir un éventail assez large de
demande, notamment celle formulée par les plus modestes, ceux qui ont à satisfaire, de
façon prioritaire, les besoins les plus fondamentaux (se nourrir, se loger, se déplacer,
etc.). Dans le second cas, une activité informelle est considérée comme un recours pour
des individus, généralement pluriactifs, à savoir qu’ils cherchent à diversifier leurs
sources de revenu. On peut citer, dans le cas de l’Afrique sub-saharienne, les contraintes
de la communauté (Mahieu, 1990).
Pour ce qui concerne la pratique des prix, on peut parler d’une prédominance du
marchandage. Ce marchandage est défini comme le processus de négociation entre deux
agents, qui permet l'ajustement entre l'offre et la demande d'un produit. Pour
comprendre cette prédominance du marchandage, il faut s’attarder sur le fait que le
marché informel est caractérisé par des pratiques de prix non transparentes. L’un des
aspects les plus frappant de ce secteur est que les prix ne sont pas affichés. La pratique
du marché se fait à travers des « recherches » aux sens de Stigler (1961) et de Geertz
(1978) : déterminer la taille du marché, définir un échantillon de recherche, trouver un
partenaire à l’échange et engager une négociation5. L'étude réalisée pour l’USAID
(Zarour, 1989) montrent que 75% des producteurs informels à Dakar fixent leurs prix
par marchandage. Celles effectuées par le DIAL-DSCN (1993) tendent vers la même
conclusion, sachant que plus de la moitié des producteurs informels dans la localité de
Yaoundé ont recours au marchandage des prix. Ce qui pousse Cogneau, Razafindrakoto
et Roubaud (1944 p 10. ) à affirmer que « le mode de formation des prix dans le secteur
informel se caractérise par la prédominance de l'ajustement offre/demande et la
flexibilité, à la différence du secteur moderne qui cherche à maintenir son taux de
marge ».
Les secteurs formel et informel étant distingués à travers les marchés correspondants, on
peut alors essayer d’étudier leurs relations, notamment à travers des variations de prix,
et analyser le phénomène de substitution qui peut caractériser cette relation.
II / Variation des prix relatifs et substitution formel/informel
5 On peut également montrer que ces différentes étapes entraîne des coûts de transaction.
3

Partant de l’hypothèse selon laquelle les secteurs formel et informel constituent deux
marchés concurrents, on peut analyser leurs relations à travers une fonction de
demande. Le mécanisme de substitution entre le formel et l’informel, exprimé dans
cette fonction de demande, est fondé sur une variation des prix relatifs des produits.
Mais une vision mécanique de ce phénomène pose un paradoxe.
II.1. Le cadre d’analyse
Les préférences de l’agent sont représentées par la fonction d’utilité de la forme :
αα
−
=
1
1221
),( XXXXU
(1)
où
1
X
et
2
X
sont deux biens qui représentent les deux secteurs formel et
informel ;
α
représente la sensibilité de la demande du produit
X
au
marchandage, considéré comme la principale caractéristique du marché qui permet
de distinguer le formel de l’informel.
L’agent est supposé combiner les caractéristiques d’un ménage ordinaire et d’une
firme (Singh et alii, 1986). En ce sens il est Producteur-Consommateur (Bordes,
1992). On peut donc lui associer une contrainte de production, au sens beckérien, de
sorte que
Y
est un vecteurs de biens et/ou services
)...,(
10
n
yyy
produits à
partir de
j
X
)2,1(
=
j
:
),,( ETXfY
j
=
(2)
qui signifie qu’une collection de biens (
j
X
), est combinée au temps (
T
), sous
l’influence d’autres variables, de l’environnement, (
E
), et transformée en une
collection "d'outputs"
Y
. La demande pour les produits du marché est analogue à la
demande pour une firme des facteurs de production. Certains de ces biens ou
services sont destinés aux propres besoins de l’agent (ménage) et d’autres seront
destinés à une activité marchande informelle. 6.
6 L'idée de Becker (1965) est d'identifier l'activité de consommation à une activité de
production. Cette conception permet de découvrir dans le comportement de l’agent
l’utilisation des produits du marché à la fois pour ses propres besoins et pour le marché
informel. Le point essentiel est de considérer un ménage comme une unité de production
La contrainte de coût associée à cette fonction de production domestique peut s’écrire :
),;(
10
mj
yyypcC
⋯
=
(3)
Les solutions du programme de maximisation de
U
sous les contraintes
cC
−
= 0
sont données par le Lagrangien :
)),;((),(max
021
mj
xypcCXXUL
⋯
−+=
λ
L’effet de la variation des prix relatifs sur la demande de l’agent peut être illustré par la
figure 1, inspirée du modèle à deux secteurs de Harris et Todaro (1970)7 : les
combinaisons de
1
X
et
2
X
définissent un ensemble de possibilités de production que
l’on peut représenter graphiquement par la courbe (c) sur la figure 1. Cette courbe est
obtenue par les solutions de
)...,;(
10
mj
yyypcC
=
et représente les combinaisons
de
1
X
et
2
X
, nécessaires à la production de
Y
, qui sont techniquement possibles.
de biens ou satisfactions (commodities) dans laquelle les produits achetés sur le marché et le
temps hors travail sont des inputs dans une fonction de production domestique. Dans le cas
présent, il s’agit de supposer, à l’inverse de cet auteur, que certains éléments de
i
x
peuvent
faire l’objet d’une activité marchande informelle.
7 Pour d’autres extensions du modèle, voir, notamment, Mahieu et Napoléon (1997)
4

1
X
2
X
(I)
p
e
o
a
b
(c)
o
Figure 1
Si on considère que les marchés formels et informels sont en équilibre concurrentiel,
l’agent représenté par la fonction de l’équation (1) se situerait en
e
0
. En ce point, la
droite
P
est tangente à la courbe d’opportunité de production. Ce qui veut dire
également que le taux marginal de substitution entre
1
X
et
2
X
est égal au rapport
des prix. On définit la droite
P
comme le rapport des prix relatifs entre le formel et
l’informel, on note
21
ppP
=
. On considère
2
p
comme le numéraire.
L’agent choisit une combinaison de
1
X
et
2
X
sur la courbe des possibilités de
production telle que la droite
P
8, qui définit la rapport des prix de
1
X
et
2
X
,
soit la plus éloignée possible de l’origine, mais tangente à (c). Le point
e
0
qui
définit l’équilibre, et qui est également la pente de la droite de budget, détermine le
taux de substitution technique entre les deux biens dans la fonction d’utilité. En ce
sens, ce point mesure le coût d’opportunité d’un bien par rapport à un autre.
8
P
est un taux de change réel formel/informel. Pour des approfondissements sur ce
concept, voir Devarajan et De Melo (1987) ou Guillaumont Jeannenay (1993).
Puisqu’il s’agit de deux biens qui représentent les deux secteurs (formel et informel), on
peut également dire qu’il s’agit du coût d’opportunité de l’arbitrage formel/informel.
En
e
0
, le taux marginal de substitution entre
1
X
et
2
X
, qui mesure le ratio des prix,
est égal au taux marginal de substitution entre les préférences, qui mesure la pente de sa
courbe d’indifférence (I). Plus la courbe d’indifférence est haute, plus elle correspond à
un niveau d’utilité élevé. Le fait d’être sur la courbe des possibilités de production
signifie pour l’agent que toutes les ressources sont utilisées.
L’effet de variation des prix relatifs, et donc de
P
, est à l’origine du mécanisme de
substitution formel/informel qui est décrit.
2. Le mécanisme de substitution formel/informel et la position du problème
Il existe un effet de substitution entre
1
X
et
2
X
qui détermine le poids relatif des
secteurs formel et informel dans l’économie, et qui montre qu’une hausse du prix sur
l’un des deux secteurs entraîne une baisse de la demande sur celui-ci et une hausse
consécutive de la demande pour ce produit sur l’autre secteur.
Si donc l’agent est sur la courbe (c), cela voudrait dire qu’il utilise toutes ses capacités
productives. Mais le fait qu’il se trouve sur la courbe (c) à un point plus à droite ou plus
à gauche dépendra des prix relatifs des deux biens considérés. Et donc une variation des
prix relatifs des produits se traduit, du point de vue de la demande de l’agent, par un
déplacement d’un point à l’autre sur la courbe des possibilités de production.
Pour examiner cet effet d’arbitrage formel/informel, partons de
P
sur la figure 1
précédente. Cette droite représente la pente de la courbe de la courbe des possibilités de
production dans la situation d’équilibre. Notons
1,
ms
c
le coût marginal d’une quantité
supplémentaire de
1
X
et
2,
ms
c
le coût marginal d’une quantité supplémentaire de
2
X
. A l’équilibre, on montre que
212,1,
ppcc
msms
=
. Ceci nous indique, par
exemple, que quand le prix du produit augmente sur le marché formel, par rapport au
prix sur le marché informel, des ressources seront transférées du marché formel vers le
marché informel. De ce point de vue, la demande est supposée augmenter sur ce marché.
Un accroissement du prix formel se traduit par un accroissement du coût marginal d’une
quantité supplémentaire sur ce marché, ce qui implique pour l’agent (rationnel) de
sacrifier une quantité de produit sur ce marché au bénéfice de l’autre marché.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%