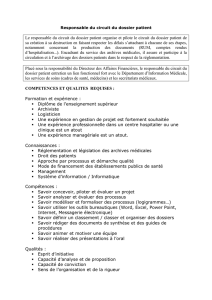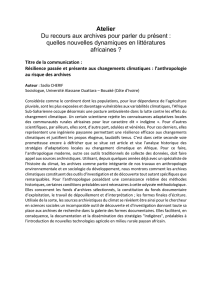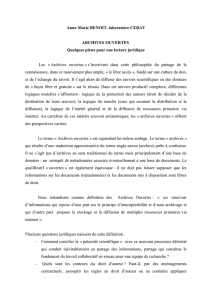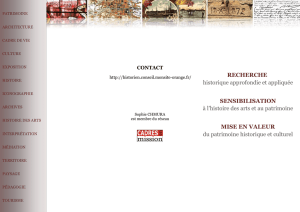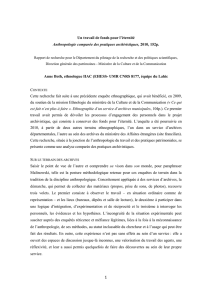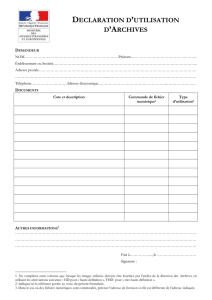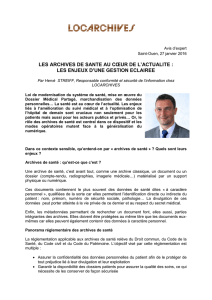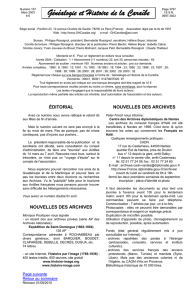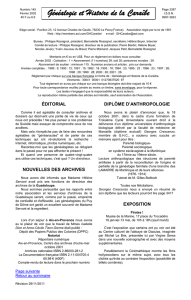Les pérégrinations - Archives départementales du Nord

Les pérégrinations des archives du
Nord
Par Rosine Cleyet-Michaud
Claudine Wallart
Conseil Général du Nord
Archives départementales du Nord
2004

La Chambre des comptes de Lille, rue Esquermoise

C’est la loi du 5 brumaire an V qui a créé les archives
départementales. Cette création resta toutefois virtuelle. Pendant
toute la Révolution, les archives du Parlement de Flandre et de
l’université restèrent à Douai, les fonds religieux à Cambrai. Les
archives de la Chambre des comptes et du Bureau des finances
demeurèrent rue Esquermoise à Lille jusqu’en l’an V. Le citoyen Ferat
acquit alors le bâtiment comme bien national et demanda que les
documents fussent évacués. Les archives ne seront transférées qu’en
l’an IX dans les salles hautes de la mairie de Lille.
Les Archives au Mont-de-Piété
En l’an XII, le Département loua, afin d’y installer les
archives, le « Lombard » qui appartenait aux hospices de Lille. Le
Lombard « était autrefois une maison de prêt sur nantissement », l’un
des « deux établissements publics de cette nature1. Tous deux furent
supprimés pendant les temps de la Révolution, mais vers l’an 1800,
l’on sentit la nécessité de rétablir ces établissements, l’on jugea qu’un
seul devait suffire pour la ville de Lille. Le mont-de-piété fut rétabli
dans le bâtiment qui portait antérieurement ce nom, le Lombard
demeura supprimé. Le bâtiment resta vacant et lorsque la préfecture
fut transférée de Douai à Lille en 1803, le préfet de concert avec le
maire de Lille et l’administration des hospices y fit placer les archives
du département »2. Ce bâtiment, édifié au début du XVIIe siècle par
Wenceslas Cobergher3 comme de nombreux autres monts-de-piété à
Arras, Valenciennes, Cambrai, Lille, Douai, Bergues …, fut aménagé
pour y recevoir les archives : carrelage rouge dans les salles, murs en
plâtre blanchis à la chaux.
1 Le mont-de-piété fondé par Masurel
2 4 N 229, lettre du Préfet au ministère de l’Intérieur
3 Wenceslas Cobergher (1557-1634), peintre, architecte, chimiste, il est aussi ingénieur et a dirigé le drainage des
Moëres. Il a construit de nombreux hôtels de ville, moulins à vent, diverses églises, notamment le dôme de
Montaigu.

Au rez-de-chaussée, le corps de logis principal comportait
15 pièces et 2 escaliers ; au 1e étage, 11 pièces ; au 2e étage, 10
pièces. Le grenier mansardé était divisé en 10 pièces. En 1806, les
archives de la Chambre des comptes furent conditionnées dans 400
boîtes en bois, portant « des étiquettes indiquant leur origine, le
nombre de pièces et les dates »4 et furent transférées au Lombard, à
bras d’hommes, avec l’aide de la garnison, sur des rayonnages en
bois installés par un menuisier lillois. En 1829, les archives du
Bureau des finances rejoignaient le Lombard. 4 ouvriers et une
voiture suffirent au transfert.
4 3 T 2028

Plan du rez-de-chaussée du Lombard
Mais « le bâtiment (…) est vieux, délabré, ruineux ».
L’archiviste écrit dans ses rapports au Préfet en 1840 : « on y
découvre sans cesse des brèches à réparer, des éboulements à
prévenir, de graves accidents à empêcher. Cet état de vétusté est
cause qu’il s’échappe continuellement de toutes les parties de l’édifice
un nuage de poussière qui, s’attachant aux papiers et surtout aux
parchemins, concourt à les détériorer beaucoup et même à les
détruire à la longue si des soins minutieux d’époussetage ne les
garantissaient. (…) Les gîtes du second étage paraissent fléchir sous
la masse énorme des papiers placés au grenier. Il semble que l’hôtel
oscille sous les coups de vent »5. Des lézardes apparaissaient dans les
murs, liasses et registres tombaient spontanément des rayonnages.
En 1821, L’employé en chef aux archives, Rapy, s’inquiétait de
l’installation d’une « pompe à feu », aux usines Scrive, juste en face
de la Maison des archives. Ses inquiétudes furent encore plus vives
lorsqu’en 1822, la mairie de Lille et le Conseil général décidèrent
d’aménager au rez-de-chaussée du Lombard, une école spéciale de
chimie appliquée aux arts industriels comprenant un amphithéâtre et
un laboratoire, ainsi qu’un logement pour le directeur. Les cours de
chimie qui commencèrent à l’été 1824, furent dispensés par Frédéric
Kuhlmann. Ils touchaient « un public nombreux, composé
5 3 T 2028, rapport de l’archiviste au préfet, 1836 et 1840
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%