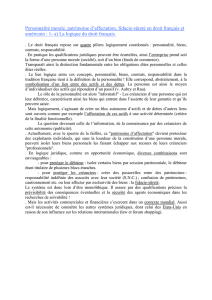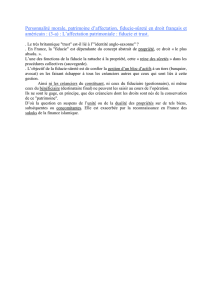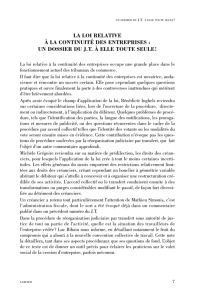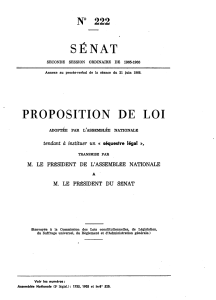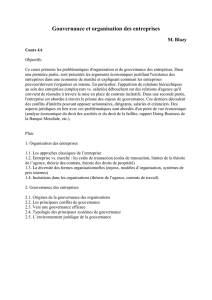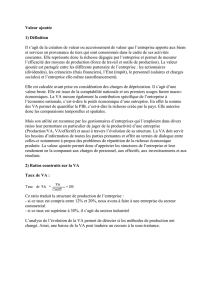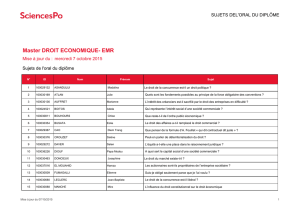Compétition juridique dans l`espace communautaire

MASTER 2 OPERATIONS ET FISCALITE INTERNATIONALES DES
SOCIETES
Compétition juridique dans l’espace communautaire : la question de la compétitivité du droit de
l’insolvabilité au regard des exemples français, anglais et allemand
Batiste Saint Guily
L’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne!L’Université n’entend donner aucune approbation ou improbation
aux propos tenus dans le présent mémoire. Ceux-ci sont propres à leur auteur.

!
"!
Remerciements
J’adresse tous mes remerciements à Monsieur le Professeur Michel Menjucq pour avoir dirigé ce mémoire
et porté à mon attention ces problématiques et élevé ma curiosité sur ce sujet.
J’adresse également tous mes remerciements à l’institut Droit et Croissance pour l’accès à la documentation
qui m’a été gracieusement fourni.
Par ailleurs je tiens à faire part de tous mes remerciements et toute ma reconnaissance aux membres du
Cabinet S.E.H Legal, pour m’avoir accueilli et stage soutenu dans la rédaction de ce mémoire, et plus
particulièrement à ses associés, Maître Sandra Esquiva-Hesse et Maître Jérôme Barbier, pour avoir pris le
temps de répondre à mes interrogations et de me faire part de leur recul et de leur expérience, ainsi qu’à
Cyprien de Girval, Juriste Doctorant, pour son soutien particulier, ses éclairages et le temps qu’il a
consacré à échanger avec moi.
Enfin, j’adresse des remerciements particuliers à ma famille et à mes proches sans le soutien desquels la
rédaction de ce mémoire n’aurait pas été possible.

#!
!
Table des matières
Introduction!..................................................................................................................................................!4!
I.!La compétition juridique dans l’espace communautaire : l’émulation d’une concurrence
entre législations nationales!.......................................................................................................................!6!
A.!La!compétition!juridique!dans!l’espace!communautaire!...............................................................!6!
B.!La!mesure!du!Droit!de!l’insolvabilité!..................................................................................................!11!
II.!La compétitivité du droit français de l’insolvabilité : de Londres à Berlin en passant par
Paris!.............................................................................................................................................................!16!
A.!Les!effets!des!procédures!d’insolvabilité!..........................................................................................!16!
B.!La!Restructuration!de!l’entreprise!......................................................................................................!26!
C.!La!Liquidation!et!la!cession!de!l’entreprise!......................................................................................!35!
Conclusion générale!.................................................................................................................................!40!
Définitions!................................................................................................................................................!41!
Bibliographie!...........................................................................................................................................!45!
Annexe!1!....................................................................................................................................................!52!
Annexe!2!....................................................................................................................................................!55!
Annexe!3!....................................................................................................................................................!57!
Annexe!4!....................................................................................................................................................!58!

!
$!
Introduction
« Après toutes nos complaintes quant à la fréquence des faillites, le malheureux qui subit cette
infortune n’est autre qu’une toute petit partie de ceux qui se livrent au commerce, ou toute autre sorte
d’affaires ; peut être pas plus d’un parmi mille. La faillite est peut être la plus grande et la plus humiliante
des calamités qui puisse s’abattre sur un innocent. C’est pourquoi la majorité des hommes est suffisamment
prudente pour l’éviter. Certains pour autant ne parviennent pas à l’éviter et certains n’évitent pas le gibet »1.
Le mot d’Adam Smith, dans ses célères Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations, surprend aujourd’hui comme elle a surement surpris hier. Aujourd’hui l’insolvabilité ne concerne
bien évidemment pas qu’un commerce sur mille et les gibets et échafauds ne trônent plus à la sortie des
tribunaux de commerce pour sanctionner ceux qui n’ont échoué dans les affaires. Notre vocabulaire n’en est
cependant pas moins marqué de cette tradition sanctionnatrice. La faillite, de fallere, qui signifie manquer,
tromper, marque la déchéance du failli, soumis à l’humiliation par ses pairs. Ainsi la banqueroute, délit pénal
aujourd’hui, est née en Italie du nord et a pour origine la banca rotta, signifiant le banc rompu. A l’époque,
les commerçants se jugeant entre eux au cours des foires rompaient solennellement et publiquement le banc
réservé au commerçant insolvable à l’assemblée des commerçants. L’insolvabilité, d’apparence plus neutre,
renvoie à l’expression moyenâgeuse « au sol la livre », décrivant à la procédure selon laquelle le failli se
voyait départir de tous ses biens pour payer ses créanciers2.
Pour autant, l’obsolescence du contexte n’exclut pas la modernité de la pensée : l’insolvabilité est une
calamité qui touche les malheureux et les innocents et pas seulement les fraudeurs. La défaillance des
entreprises ne saurait être aujourd’hui imputée à la seule incapacité des gérants, mais en premier lieu aux
crises, si lointaines et obscures qu’elles soient, aux cycles commerciaux, aux dynamiques d’échanges
internationales, aux marchés de capitaux, dématérialisés et insaisissables. La sauvegarde des entreprises, du
tissu économique et de l’emploi s’est imposée dans les plus grandes économies européennes comme un
impératif excluant la sanction du failli. L’entreprise malade doit être soignée et cette maladie devrait faire
l’objet d’un traitement aussi neutre que la vie des entreprises. La mort de l’entreprise doit également laisser
place à une seconde chance et une réallocation efficient des richesses, plus qu’à la sanction afin de ne pas
dissuader l’entreprenariat sur lequel repose nos économies libérales.
Le sauvetage de l’entreprise peut alors prendre plusieurs formes, en fonction des difficultés connues
par l’entreprise. Pour Michael Jensen3, quatre types de difficultés peuvent exister. Certaines (i) seront très
bien dirigées mais en raison d’un démarrage plus difficile que prévu, elles connaissent un décalage entre les
prévisions de rentrées de trésorerie et les échéances de paiement de la dette. Un simple rééchelonnement de
la dette permettra alors une sortie de crise. Pour d’autres, (ii) c’est la structure du capital qui, bien qu’adaptée
à l’origine, ne l’est plus du fait d’une modification de la conjoncture ou de difficultés opérationnelles, de
sorte que la dette ne puisse plus être couverte par les entrées de trésorerie prévues ; une modification de la
structure du bilan est alors à mettre en œuvre pour effacer une partie de la dette. Parfois, (iii) les difficultés
naîtront de l’équipe dirigeant qu’il faudra changer. Enfin, certaines (vi) seront inadaptées tant au regard de la
structure du capital et de la dette, que de leur activité opérationnelle et l’équipe dirigeante, si bien que seule
une procédure liquidative doive être mise en place. En toute circonstance, la restructuration devra donc
imposer une modification des droits des créanciers, des actionnaires ou des dirigeants. Tour à tour donc, la
législation en matière d’insolvabilité, au nom de la préservation de l’entreprise et de l’emploi, viendra
modifier, voire sacrifier, les droits des parties. En ce sens, la législation nationale, au gré de son histoire et de
son consensus politique et culturel réalisera une synthèse entre l’impératif de sauvegarde de l’entreprise et le
respect des droits des créanciers et actionnaires, sans lequel l’imprévisibilité juridique découragerait toute
initiative, toute prise de risque et tout esprit d’entreprise. Les législations nationales en matière
d’insolvabilité apparaissent donc, à certains égards, quasi régaliennes et intimement liées aux objectifs et aux
choix politiques opérés par les Etats et leur histoire. Ainsi, le droit de l’insolvabilité fait-il l’objet de fortes
disparités en Europe4 et peut donc apparaître, selon la formule de Jacques Beguin, comme « un ilot de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Adam Smith, An Inquiry into nature and causes of the Wealth of Nations Book II, Chap III. Of the accumulation of capital or of
productive and unproductive labour, p. 279, 1779, Electronic classic series publication, Penn state Univeristy (téléchargement libre).
Traduction personnelle.
2 Pierre Michel le Corre, Droit et Pratique des Procédures collectives, Dalloz Action 2012 2013, 6ème édition, p. 17 et s.
3 M.C. Jensen, Corporate Control and the politics of finance, Journal of Applied Corporate Finance, Summer 1991, Vol 4. N°2, p. 29
4 considérant 19, Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000, v infra et J.L. Vallens, L’insolvabilité des entreprises en droit comparé,
Joly, 2010

%!
!
résistance à l’internationalisation »5. A ce titre, nous remarquerons qu’aujourd’hui encore, le marché français
des avocats en procédures collectives reste très marqué par la présence de cabinets de niche d’origine
française et non des grands cabinets internationaux.
Or, l’internationalisation du financement et l’intégration des Etats au sein de l’Union Européenne
sont venus modifier fondamentalement ce rapport d’équilibre. L’intégration économique régionale dans
l’espace communautaire6 repose sur un principe de liberté d’établissement7 qui autorise, dans une certaine
mesure, les investisseurs à choisir le droit applicable à la société qu’ils entendent créer, nonobstant le lieu
d’exercice principal de leurs activités8. Dans le même mouvement est apparu, sous l’empire de la
réglementation européenne 9 en matière d’insolvabilité une compétition juridique entre les Etats. La
reconnaissance automatique des effets d’une procédure de faillite entamée dans un Etat membre au sein de
l’espace communautaire permet aux entreprises en difficultés de choisir, sous certaines conditions, la
procédure nationale qui leur convient le mieux. Ce Forum Shopping, selon l’expression consacrée,
déconnecte l’implantation sur un territoire du droit applicable et de l’équilibre atteint par une législation
entre les différents impératifs précédemment décrits.
En conséquence apparaît la question de l’attractivité d’une législation nationale et de sa
compétitivité. Attirer les restructurations sur son territoire permet non seulement de capter les revenus liés à
ces activités, mais surtout d’imposer le respect des valeurs et des impératifs que la législation nationale a
choisi. Or, pour attirer, faut-il encore être compétitif. Une telle notion, d’origine économique, n’a de sens que
dans la relation. La compétitivité induit un marché sur lequel il existe une compétition entre des droits et ces
droits ne sont concurrents que par l’existence d’un marché. Celui-ci est ici déterminé par le choix offert aux
acteurs des restructurations entre plusieurs droits nationaux. A minima, ceux-ci choisiront le droit le plus
efficace pour servir leurs intérêts. Au mieux, choisiront-ils le plus cohérent économiquement. Toutefois, il
semblerait bien trop optimiste de croire que ceux-ci choisiraient le « meilleur droit » puisqu’une telle notion
impliquerait la prise en compte d’enjeux trop variés liés à un grand nombre d’acteurs et de parties prenantes
touchées par la défaillance d’une entreprise. Ainsi, faut-il ici considérer le droit national comme un outil au
service d’un impératif économique sous-jacent qui, contrairement à un cadre purement interne, n’est que peu
influencé par la législation nationale10.
Par conséquent, il semble nécessaire de soulever, in concreto, la question de la compétitivité et de
l’attractivité des dispositions des droits de l’insolvabilité des trois plus grandes économies européennes : la
France, le Royaume Uni11 . Ces trois Etats, outre leur culture économique fort différente, incarnent
l’opposition de cultures juridiques distinctes : une tradition de Common Law au Royaume Uni et une
tradition juridique Romano-germanique et civiliste en Europe continentale, qui peut être divisée entre une
tradition latine, dont la France est une représentante, et la tradition juridique allemande12. Il s’agit également
d’une opposition entre cultures de la restructuration : l’Allemagne est restée sévère et sanctionnatrice envers
les faillis, la France a placé comme impératif le redressement des entreprises et le maintien de l’emploi et
l’Angleterre a, tout en étant plus modérée au regard de la question sociale, développé également une culture
du redressement et du retournement des entreprises plus respectueuse des droits des créanciers. Toutefois, la
compétition juridique évoquée ne s’exprime pas en termes de préférence idéologique mais repose sur la
décision de praticiens et d’acteurs économiques cherchant à répondre à des problématiques concrètes. Ainsi,
dans la mesure du possible et avec le recul disponible, la comparaison entreprise cherchera à adopter le
regard des praticiens, des créanciers et débiteurs confrontés à leur situation de crise.
Sans doute la compétition juridique est elle vouée à faire évoluer les législations nationales et les
impératifs nationaux, comme la préservation de l’emploi fortement sollicitée par la France, seront amenés à
être reformuler voire atténués. A ce titre, nous remarquerons que la législation en matière d’insolvabilité a
fait l’objet de récentes réformes dans les trois Etats. L’Angleterre a modifié sa législation en 2002 par
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Jacques Béguin, Un îlot de résistance à l’internationalisation : le droit des procédures collectives, in, L'internationalisation du
droit - Mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn-Paris : Dalloz, 1994. - 416 p.
6 entendu comme l’Union Européenne, à l’exception du Danemark qui n’applique pas la réglementation communautaire en matière
d’insolvabilité
7 art 48 TFUE
8 CJCE, 9 mars 1999, Centros Aff.C-212/97
9 Règlement (CE) 1346/2000du 29 mai 2000
10 par hypothèse, les parties ayant un choix, l’influence du droit national sur la logique économique est réduite).
11 ici limité à l’Angleterre et le Pays de Galle, en effet, l’Ecosse et l’Irlande du Nord bénéficient d’une législation propre en matière
d’insolvabilité
12 J.F. Gauderault Desbiens, La crise économiste dans la tradition germano romanique, RTD Civ. 2010, p. 683
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
1
/
59
100%