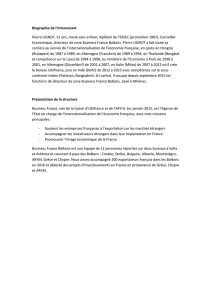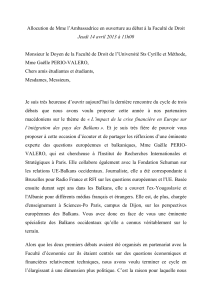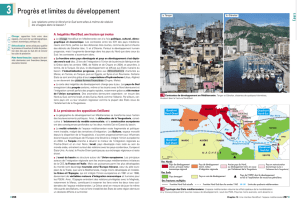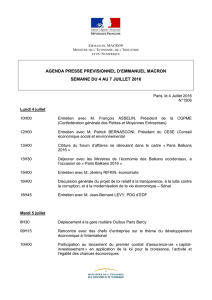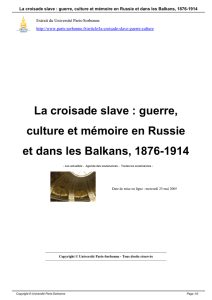l`europe dans le miroir des balkans

Jacques Rupnik – L’Europe dans le miroir des Balkans – Décembre 1998 / Janvier 1999
http ://www.ceri-sciences-po.org 1
L’EUROPE DANS LE MIROIR DES BALKANS
Jacques Rupnik
Le XXe siècle a commencé à Sarajevo, avec le déclenchement de la Première Guerre
mondiale, il se termine non seulement avec la chute du Mur, mais aussi avec le retour de la
guerre à Sarajevo. Les événements tragiques de Bosnie, et plus généralement les risques
inhérents à la fragmentation de l'Europe de l'Est après la Guerre froide, constituent le
démenti le plus flagrant et le plus immédiat aux perspectives du "nouvel ordre international"
tant annoncé. Mais c'est aussi le signe que Sarajevo 1994 n'est pas Sarajevo 1914 :
personne n'allait déclencher la Troisième Guerre mondiale pour la Bosnie. C'est ce double
constat que reflète la réaction internationale aux conflits consécutifs à l'éclatement de la
Yougoslavie, oscillant entre engagement et réticence, entre principes et réalisme (qui est
souvent le nom de code du cynisme), positions qui, implicitement, reposent les unes et les
autres sur les métaphores ou les stéréotypes du tournant du siècle concernant les Balkans,
"poudrière de l'Europe" pour certains, qui ne mérite pas qu'on lui sacrifie les "os d'un
brigadier poméranien" pour le chancelier Bismark et pour nombre de ses disciples
contemporains. De la même façon, le succès ou l'échec de la réaction internationale est
interprété différemment selon les objectifs et les attentes de chacun. Si l'objectif premier était
de contenir un conflit local difficile, de prévenir son extension à l'ensemble des Balkans, voire
au-delà, de fournir une aide humanitaire et en fin de compte d'imposer un règlement à des
adversaires épuisés par les hostilités, on peut parler d'un succès relatif pour ce qui est de
limiter les dégâts. Au contraire, si l'enjeu était l'établissement d'un nouvel ordre pour l'après-
Guerre froide en Europe, la capacité des démocraties occidentales à mettre en oeuvre leurs
principes avoués de politique étrangère, la crédibilité d'organisations internationales telles
que le CSCE, les Nations unies et l'Union européenne en matière de maintien de la sécurité,
et enfin la cohésion et la fiabilité de l'Alliance atlantique, échec est bien le mot qui convient (à
la rigueur relatif, si l'on prend en compte la conclusion du conflit prévue par les Accords de
Dayton).

Jacques Rupnik – L’Europe dans le miroir des Balkans – Décembre 1998 / Janvier 1999
http ://www.ceri-sciences-po.org 2
L'ECHEC COLLECTIF
"Permettrons-nous à ces guerres balkaniques de se dérouler sans au moins essayer d'en
tirer une leçon, sans savoir si elles ont été un bien ou un mal, si elles risquent de se rallumer
demain et prendre de l'ampleur?" demandait en 1914 le sénateur français d'Estournelles de
Constant, président de la Commission internationale sur les Balkans. Il ajoutait que le
rapport de la Commission aurait pu tout aussi bien s'intituler "L'Europe divisée et ses effets
démoralisants sur les Balkans". Ses propos, à l'époque, n'ont pas touché beaucoup de
lecteurs : en 1914, ils avaient d'autres occupations dans les Balkans. Mais la question
demeure, et pourrait bien servir d'avertissement à ceux qui ont pour mission, après la guerre
en ex-Yougoslavie, de tirer les leçons du conflit et d'en comprendre la signification pour la
nouvelle Europe. On a beaucoup écrit sur la réaction internationale aux conflits entraînés par
la dissolution de la Yougoslavie. Ce qui ressort de ces analyses est une image dérangeante
dont la signification dépasse largement la tragédie des Balkans. En premier lieu, lorsqu'il
s'agit des grands problèmes de sécurité, on peut se demander s'il existe bien une entité
appelée "communauté internationale". Ce qui compte, ce sont les grandes puissances, leurs
intérêts et leur pouvoir, leurs rivalités et leur capacité à travailler ensemble. Certes, il existe
des institutions et des lieux de discussion internationaux et il semble que la Bosnie, entre
autres, ait suscité dans l'opinion ce qui ressemble à un mouvement international en faveur
des questions humanitaires. Une telle réaction, due très largement à l'impact des médias
occidentaux, crée l'illusion qu'il existe une "communauté internationale", matérialisée par des
instances supranationales susceptibles de trouver ou d'imposer des solutions. En réalité,
c'est aux pays qui composent ces instances (à savoir les Etats-Unis, la Russie, la Grande-
Bretagne, la France et l'Allemagne) qu'il convient d'imputer leur incapacité à prévenir ou à
arrêter un conflit. En second lieu, la façon dont la guerre en ex-Yougoslavie a été
péniblement gérée par une succession d'organisations représentant ladite "communauté
internationale" n'a fait que souligner leur impuissance. Ce fut d'abord le CSCE (aujourd'hui
l'OCSE) après l'adoption de la Charte de Paris en novembre 1990 et la création d'un Centre
pour la Prévention des Conflits qui n'a jamais réussi à prévenir quoi que ce soit. Ensuite, lors
du déclenchement de la guerre en juin 1991, l'Union européenne s'est pro-posée comme
médiateur afin de mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, pour
découvrir qu'elle n'existait pas. Au début de l'année 1992, la diplomatie onusienne,
représentée par Cyrus Vance, a pris la direction des opérations pour négocier un cessez-le-
feu entre la Serbie et la Croatie, ce qui n'a servi, en l'espace de quelques mois, qu'à
démontrer les limites de la capacité de l'ONU à maintenir la paix en Bosnie-Herzégovine Ce
n'est que lorsque la crise bosniaque a provoqué des tensions majeures, y compris le risque
de décrédibiliser l'Alliance atlantique, que l'OTAN, à l'instigation des Etats-Unis, a finalement

Jacques Rupnik – L’Europe dans le miroir des Balkans – Décembre 1998 / Janvier 1999
http ://www.ceri-sciences-po.org 3
décidé de prendre en main la phase finale du conflit. La Bosnie a été décrite par Richard
Holdbrooke comme "l'échec collectif le plus grave de ces trente dernières années" pour les
Occidentaux. La crise, à l'évidence, a provoqué de graves tensions entre les Etats-Unis et
ses alliés européens, qui se sont, certes, atténuées mais n'ont pas disparu. Le contraste est
saisissant entre la situation telle qu'elle se présentait en 1991, au début du conflit, lorsque
les Etats-Unis partageaient le sentiment des Européens sur la Yougoslavie et leur laissaient
volontiers la responsabilité de gérer le conflit ("Nous n'avons aucun cheval dans cette
course", disait le Secrétaire d'Etat Baker), et la conférence de Dayton en novembre 1995,
que l'opinion, surtout dans les Balkans, considère comme la démonstration de la puissance
américaine au détriment des Européens. Tel est le contexte dans lequel il convient d'étudier
la réaction européenne à la crise des Balkans.
COMMENT L'EUROPE VOIT LES BALKANS
Dans son introduction à la nouvelle édition du rapport de la Commission Carnegie sur les
Balkans en 1914, George Kennan décrit les Balkans comme "un bastion de civilisation non
européenne qui a réussi jusqu'à aujourd'hui à conserver nombre de ses caractéristiques non
européennes, dont certaines conviennent encore moins au monde moderne qu'au monde tel
qu'il était il y a quatre-vingts ans". Les atrocités perpétrées au cours de ce qu'on a pu
qualifier de "troisième guerre des Balkans" sont, en effet, tristement analogues à celles du
passé, et le contraste est frappant entre une Europe constituée de démocraties prospères
bien décidées à éviter la guerre et une ex-Yougoslavie déchirée par des conflits
nationalistes. Sur le plan intellectuel comme sur le plan politique, il faut pourtant résister à la
tentation de considérer le sort des Balkans comme distinct de celui de l'Europe.
Essentiellement parce que l'Europe, il n'y a pas si longtemps, a été le théâtre d'horreurs
semblables et qu'elle a fini par les surmonter. Aujourd'hui, la principale différence entre
l'Europe centrale et les Balkans ne se fonde pas tant sur les disparités constatées entre les
chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, ou entre l'héritage des Habsbourg et celui de
l'Empire ottoman. Elle tient au fait que ce qu'on appelle aujourd'hui le "nettoyage ethnique"
dans les Balkans a été "mené à bien", si on peut dire, en Europe centrale pendant la
Seconde Guerre mondiale ou immédiatement après : extermination des juifs et expulsion
des Allemands. Les Balkans sont peut-être à la périphérie de l'Europe, mais leur histoire ne
s'en inscrit pas moins dans le destin de l'Europe du XXe siècle. Seule une acception plus
étroite du mot "Europe" permet de faire de "l'Europe" et des "Balkans" des entités distinctes,
comme ce fut le cas pour le titre revendiqué par d'Estournelles à l'occasion du rapport de
1914. Mais la définition est contestable. A son début, au lendemain de la Seconde Guerre

Jacques Rupnik – L’Europe dans le miroir des Balkans – Décembre 1998 / Janvier 1999
http ://www.ceri-sciences-po.org 4
mondiale, le projet d'intégration européenne se fondait sur deux postulats destinés à
dépasser les traumatismes récents : bannir les guerres de conquête et le principe du
nettoyage ethnique. Lorsque le Luxembourgeois Jacques Poos, au nom de la Communauté
européenne, arriva en Yougoslavie alors au bord de la guerre et déclara : "l'heure de
l'Europe est venue", il était implicitement sous-entendu que la Communauté européenne,
après la Guerre froide, entendait appliquer ces principes sur tout le continent. Au cours des
mois et des années qui ont suivi, elle allait connaître un échec cuisant, face aux pires
massacres et déportations que le monde ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale.
Elle allait aussi se montrer impuissante à éviter l'agression contre des Etats
internationalement reconnus. Le fait que l'Union européenne ait toléré le recours à la
violence pour régler les conflits et tacitement admis l'ethnicité comme principe central
d'organisation des nouveaux Etats a grandement contribué à miner sa crédibilité, aussi bien
à l'intérieur de l'Union qu'auprès des nations balkaniques qui, du même coup, ont commencé
à se tourner vers l'OTAN. Pendant tout le conflit, la réaction de l'Europe peut se résumer à :
"trop peu, trop tard". Elle a bien tenté au début de maintenir la cohésion de la Yougoslavie,
mais seulement par des avertissements et en brandissant la carotte économique. Fin mai
1991, Jacques Delors, président de la Commission européenne, s'est rendu en Yougoslavie
pour promettre un soutien politique et financier au Premier ministre Ante Markovic pour ses
plans concernant un "Maastricht yougoslave", assorti d'une union monétaire et douanière, à
une époque où les protagonistes, aux prises avec des projets nationalistes contradictoires,
se préparaient déjà à la guerre. Le langage rationnel des intérêts économiques n'avait
aucune prise sur des dirigeants politiques occupés à suivre la logique d'une confrontation
ethno-nationaliste. Pendant la guerre en Croatie, l'Union européenne s'est efforcée de ne
pas s'inscrire dans les affaires des "belligérants" ce qui a eu pour effet de favoriser
largement la seule d'entre elles qui possédait une véritable armée, c'est-à-dire la Serbie.
Lorsque, en 1992, la guerre s'est étendue à la Bosnie, l'Union a bien été obligée de
reconnaître comme l'agresseur la Serbie de Milosevic, mais n'a rien fait pour l'arrêter. L'aide
humanitaire (fournie en grande partie par l'Union européenne) a pris le relais de l'action
politique, les casques bleus devenant les otages potentiels, puis effectifs, des nationalistes
serbes bosniaques. Le résultat fut une succession de plans de paix dont aucun ne fut jamais
appliqué, et qui reflètent les étapes successives de la partition ethnique en Bosnie. C'est en
ce sens que les accords de Dayton peuvent être considérés comme un projet "européen",
mis en oeuvre grâce à des moyens américains. L'Europe avait, certes, des circonstances
atténuantes. D'abord, au moment de la désintégration de la Yougoslavie, elle avait d'autres
priorités. La réunification de l'Allemagne et l'éclatement de l'Union soviétique étaient
logiquement considérés comme décisifs pour la stabilité future du continent. La confirmation
de la frontière Oder-Neisse entre l' Allemagne et la Pologne prenait naturellement le pas sur

Jacques Rupnik – L’Europe dans le miroir des Balkans – Décembre 1998 / Janvier 1999
http ://www.ceri-sciences-po.org 5
celles des diverses républiques qui constituaient la Yougoslavie. On pensait aussi qu'on ne
devait rien faire qui puisse créer un précédent et saper l'autorité de Gorbatchev et de l'Union
soviétique. Par ailleurs, la Communauté européenne, comme on l'appelait encore en 1991,
n'avait ni mandat légal ni de puissance militaire suffisante pour agir de façon déterminante.
La "politique étrangère et de sécurité commune" était précisément l'un des objectifs du Traité
de Maastricht signé en décembre 1991. En fait, les six premiers mois de la guerre en
Yougoslavie (les plus décisifs en ce qu'ils conduisirent à la reconnaissance de la Slovénie et
de la Croatie) ont été dominés par les négociations de Maastricht. D'où un certain nombre de
"marchandages" : le Royaume-Uni voulait bien oublier sa réticence à reconnaître la Croatie,
en échange de la possibilité de rester en dehors de la charte sociale. La France acceptait
aussi de faire quelques concessions à l'Allemagne sous réserve que les objectifs du traité et
surtout le projet d'union monétaire européenne ne soient pas remis en question. Finalement,
au-delà des obstacles institutionnels, ce sont les divergences politiques des Etats membres
de l'Union européenne qui les ont empêchés de prendre les mesures qui s'imposaient. Sous
cet angle, on peut avancer que le principal mérite de l'Union européenne était précisément
de contenir ces divergences. L'absence d'une politique commune, cependant, était moins un
problème constitutionnel que le résultat d'une absence de volonté politique commune ("la
bonne volonté sans le pouvoir", comme on l'a dit de la réaction européenne). Mais celle-ci
s'expliquait tout autant par certaines convictions concernant la nature ou la signification du
conflit et la réaction appropriée que par les différentes perceptions, affinités et intérêts, chez
les principaux partenaires européens, touchant la manière de le gérer.
LECTURES DU CONFLIT
En Europe occidentale, on trouve principalement deux théories pour expliquer le conflit dans
les Balkans, dont chacune a, bien évidemment, des implications politiques. La première y
voit un archaïsme ou anachronisme : un "retour aux haines ancestrales". La seconde, au
contraire, considère les conflits comme un processus de construction des Etats-nations, une
étape fâcheuse mais indispensable de l'Europe de l'Est sur le chemin de la "modernité". La
première thèse, très répandue parmi les élites politiques et les médias, passe généralement
par la métaphore du réfrigérateur : le communisme n'a fait que "geler" frustrations et conflits,
qui se retrouvent merveilleusement intacts après sa disparition. Il existe aussi la variante de
la "marmite" : maintenant que le couvercle du communisme et du soviétisme s'est soulevé,
les vieilles haines et les aspirations trop longtemps contenues peuvent enfin s'échapper.
C'est l'interprétation la plus souvent avancée dans les médias et dans le discours politique,
tant dans les pays de l'Europe de l'Ouest qu'aux Etats-Unis. Le Président Clinton, dans son
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%