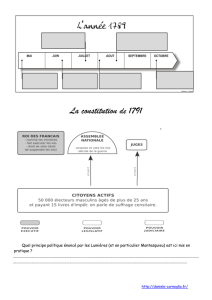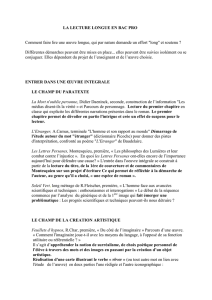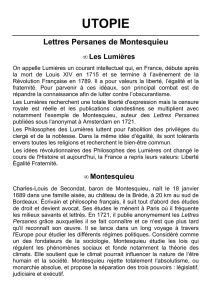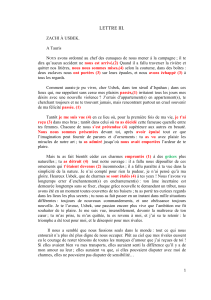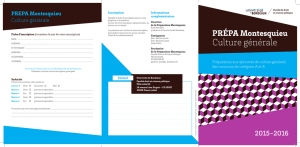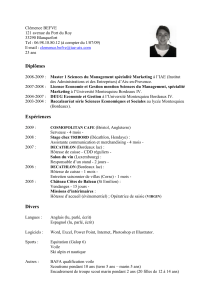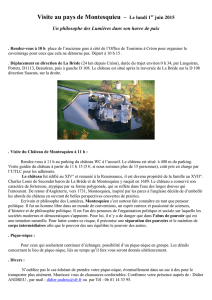lettres persanes




MONTESQUIEU
LETTRES PERSANES
GF Flammarion
www.centrenationaldulivre.fr
© 1995, Flammarion, Paris, pour cette édition.
Édition mise à jour en 2011
Dépôt légal : août 2011
ISBN Epub : 9782081277779
ISBN PDF Web : 9782081277762
Le livre a été imprimé sous les références :
ISBN : 9782081266346
Ouvrage composé et converti par Meta-systems (59100 Roubaix)

Présentation de l'éditeur
L’Orient et l’Occident, le sérail et les salons, les intrigues des sultanes et la coquetterie des
Parisiennes, les songes du harem et les propos de café, les muftis et le pape, les gouvernements réels
et les constitutions imaginaires… Voilà de quoi se nourrit la correspondance entretenue par Usbek et
Rica, seigneurs persans partis à la découverte de la France de Louis XIV, avec leurs amis demeurés à
Ispahan.
Révolutionnaire par sa forme – « mes Lettres persanes apprirent à faire des romans en lettres »,
écrivait Montesquieu –, satirique et enjouée, cette œuvre offre un condensé des théories les plus
audacieuses de l’auteur. Éloge du rationalisme et de l’esprit critique, réflexion sur le bonheur,
plaidoyer pour une politique et une religion raisonnables : la philosophie tient tout entière dans ce
livre en apparence badin, qui s’est imposé comme l’un des premiers grands chefs-d’œuvre des
Lumières.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%