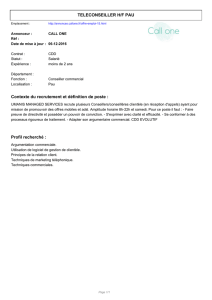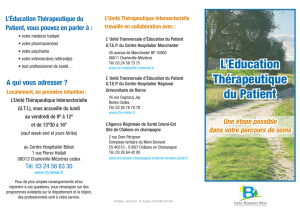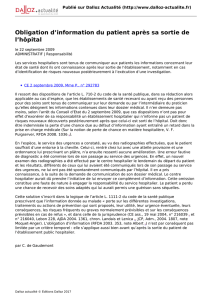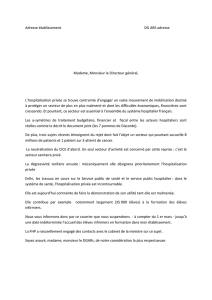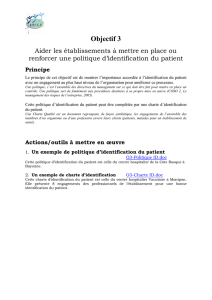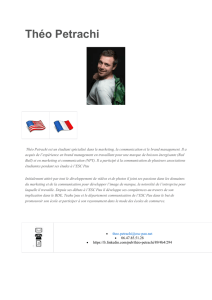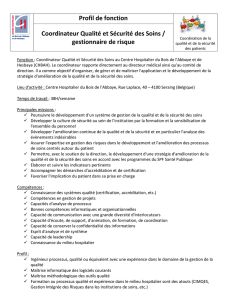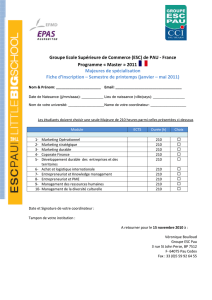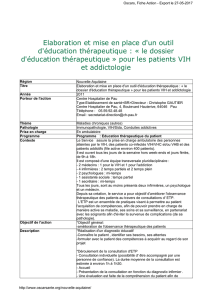Rapport d`observations définitives (PDF, 435,72

Bordeaux, le 5 juin 2009
Le Président
Références à rappeler : FN/ROD II 064025101
Monsieur le Directeur,
Par lettre du 28 février 2008, vous avez été informé que la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine allait procéder au jugement des comptes de 2003 à 2006 et à l’examen de la gestion de
2003 jusqu’à la période la plus récente du centre hospitalier de Pau. Une lettre identique a été adressée,
à la même date, à votre prédécesseur qui avait dirigé le centre hospitalier jusqu’au 31 août 2004. A
l’issue de cette vérification, l’entretien préalable avec le conseiller-rapporteur prévu par les articles
L. 243-1 et R. 241-8 du code des juridictions financières a eu lieu avec vous le 18 septembre 2008.
L’entretien préalable avec votre prédécesseur a eu lieu le 1er septembre 2008.
Je vous ai fait connaître par lettre du 2 décembre 2008, les observations retenues à titre
provisoire par la chambre lors de sa séance du 16 octobre 2008, en vous priant d'y répondre dans le
délai de deux mois. Vous avez répondu par courrier du 22 janvier 2009, reçu au greffe de la Chambre
le 4 février 2009. Une copie de ces observations a été adressée dans les mêmes conditions, à Madame
Martine LIGNIERES-CASSOU, en sa qualité de présidente du conseil d’administration.
Le centre hospitalier de Pau fait partie de l’échantillon retenu pour une enquête commune entre
la Cour des comptes et les Chambres régionales de comptes, portant sur l’organisation des soins à
l’hôpital et susceptible de déboucher soit sur une insertion à un rapport public de la Cour des comptes,
soit sur un rapport particulier de la Cour. Le contrôle de gestion mené par la Chambre a donc porté de
manière privilégiée sur les différents axes de cette enquête commune.
Après avoir examiné le contenu de votre réponse, la chambre a arrêté au cours de sa séance du
19 mars 2009 les observations définitives qui vous ont été notifiées le 10 avril 2009 concernant :
l’activité, la stratégie d’action et les coopérations développées par l’établissement (1), la fiabilité des
comptes, la situation financière, la comptabilité analytique et les procédures internes de gestion (2), la
mise en place de la nouvelle gouvernance hospitalière (3), l’adéquation des ressources de
l’établissement aux besoins et à la demande en soins (4) ainsi que la prise en charge des patients à
travers l’optimisation des parcours individuels de soins, l’amélioration de la qualité de l’accueil et des
soins et la prévention et la gestion des contentieux (5).
Vous avez répondu le 28 avril 2009. Cette réponse qui n’engage que votre responsabilité est
jointe au présent rapport. En conséquence, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le rapport
d’observations définitives de la chambre.
Monsieur Christophe GAUTIER
Directeur du centre hospitalier de Pau
4, bd Hauterive
B.P. 1156
64046 - PAU UNIVERSITE CEDEX
3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 Bordeaux Cedex – Tél. : 05 56 56 47 00 – Fax : 05 56 56 47 52

2
SOMMAIRE
1. L’ACTIVITE, LA STRATEGIE D’ACTION ET LES COOPERATIONS DEVELOPPEES PAR
L’ETABLISSEMENT............................................................................................................................................................... 4
1.1. LES COMPOSANTES DU CENTRE HOSPITALIER........................................................................................................................ 4
1.2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT DE 2003 A 2007................................................................................... 4
1.3. LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE L’ETABLISSEMENT................................................................................................... 6
A. L’évaluation de la réalisation des actions prévues par le CPOM 2004-2008.............................................................. 6
B. La mise en œuvre des objectifs qualitatifs du CPOM 2004-2008, en particulier dans la perspective du rapport de
certification 2007 de la Haute autorité de santé (HAS).............................................................................................. 10
C. Les documents stratégiques élaborés pour la période 2008-2012.............................................................................. 12
2. LA FIABILITE DES COMPTES, LA SITUATION FINANCIERE, LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LES
PROCEDURES INTERNES DE GESTION ........................................................................................................................ 12
2.1. L’EXAMEN DE LA FIABILITE DES COMPTES.......................................................................................................................... 12
A. L’examen des provisions constituées par l’établissement........................................................................................... 12
B. Le suivi comptable des immobilisations de l’établissement........................................................................................ 14
C. L’examen de divers soldes de classe 4 concernant les relations avec la Sécurité sociale.......................................... 15
D. Les reports de charges................................................................................................................................................ 16
E. Synthèse sur l’examen de la fiabilité des comptes ...................................................................................................... 17
2.2. LA SITUATION FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT SUR LA PERIODE 2003 A 2007................................................................ 17
A. Les comptes de résultat............................................................................................................................................... 17
B. Les tableaux de financement....................................................................................................................................... 18
C. L’évolution de l’endettement....................................................................................................................................... 19
D. Les bilans fonctionnels et leur évolution..................................................................................................................... 19
E. Les tableaux de bord des indicateurs financiers......................................................................................................... 20
F. Synthèse sur la situation financière............................................................................................................................ 20
2.3. LA COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LES AUTRES PROCESSUS INTERNES VISANT A AMELIORER LA GESTION........................ 21
A. La mise en place d’un contrôle interne de gestion ..................................................................................................... 21
B. Les améliorations apportées à la fonction « achats » et à d’autres aspects de la gestion.......................................... 21
C. L’approche analytique par le calcul des coûts de certaines activités logistiques et médico-techniques.................... 23
D. L’approche par l’analyse des coûts en fonction de l’activité médicale de l’établissement ........................................ 24
E. Synthèse sur la comptabilité analytique et l’amélioration de la gestion..................................................................... 26
3. LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE HOSPITALIERE......................................................... 27
3.1. LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DIRIGEANTES ET CONSULTATIVES DE L’ETABLISSEMENT........................................ 27
A. Le recentrage du Conseil d’administration sur ses fonctions stratégiques, notamment en matière d’organisation des
soins............................................................................................................................................................................ 27
B. La mise en place et le fonctionnement du Conseil exécutif......................................................................................... 28
3.2. LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION INTERNE BASEE SUR LES POLES ........................................................................... 29
A. Le découpage du centre hospitalier en pôles.............................................................................................................. 29
B. La mise en place des instances dirigeantes des pôles et de leurs outils de pilotage et de gestion.............................. 33
C. Bilan et perspectives de l’institution des pôles au centre hospitalier de Pau............................................................. 35
4. L’ADEQUATION DES RESSOURCES DE L’ETABLISSEMENT AUX BESOINS ET A LA DEMANDE EN SOINS
.................................................................................................................................................................................................. 36
4.1. L’ADEQUATION DES LOCAUX.............................................................................................................................................. 36
A. Les insuffisances des locaux ....................................................................................................................................... 36
B. Des progrès à apporter pour le respect des normes sanitaires, techniques et de sécurité ......................................... 37
4.2. L’ADEQUATION ET L’OPTIMISATION DES EQUIPEMENTS LOURDS ........................................................................................ 38
A. Les équipements lourds d’imagerie et de cardiologie ................................................................................................ 38
B. Les modalités d’utilisation et de gestion des blocs opératoires.................................................................................. 38
4.3. L’ADEQUATION ET L’OPTIMISATION DES RESSOURCES HUMAINES...................................................................................... 39
A. L’évolution et l’adéquation des effectifs médicaux et non médicaux.......................................................................... 39
B. L’optimisation des ressources humaines .................................................................................................................... 42
C. La formation des personnels....................................................................................................................................... 45
D. L’organisation de l’activité des personnels médicaux................................................................................................ 46

3
5. LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PAR L’OPTIMISATION DES PARCOURS INDIVIDUELS DE SOINS,
PAR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’ACCUEIL ET DES SOINS ET PAR LA PREVENTION ET LA
GESTION DES CONTENTIEUX......................................................................................................................................... 49
5.1. LES OUTILS D’IDENTIFICATION DES PATIENTS MIS EN PLACE PAR LE CENTRE HOSPITALIER ................................................ 49
5.2. L’ORGANISATION DES HOSPITALISATIONS D’UNE DUREE DE PLUS DE 24 HEURES ............................................................... 50
A. L’organisation des parcours de soins complexes au sein de l’hôpital........................................................................ 50
B. L’organisation spécifique pour les hospitalisations non programmées...................................................................... 51
C. L’organisation des sorties de l’hôpital....................................................................................................................... 53
5.3. LE DEVELOPPEMENT D’ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION LONGUE.............................................................................. 54
A. Les hospitalisations d’une durée inférieure à 24 heures ............................................................................................ 54
B. L’hospitalisation à domicile ....................................................................................................................................... 54
5.4. LA MESURE ET LE DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE DE L’ACCUEIL DES PATIENTS .............................................................. 54
5.5. LA DEMARCHE « QUALITE ET SECURITE » DES SOINS........................................................................................................... 56
A. L’organisation institutionnelle mise en œuvre............................................................................................................ 56
B. La stratégie et les outils d’analyse de la démarche « qualité – sécurité ».................................................................. 56
C. Les modalités d’association des personnels à la démarche « qualité - sécurité »...................................................... 57
D. Quelques aspects particuliers relatifs à la qualité et à la sécurité des soins.............................................................. 58
5.6. LA GESTION DES RECLAMATIONS ET DES CONTENTIEUX ..................................................................................................... 59
A. L’information des patients sur leurs droits et recours................................................................................................ 59
B. La prise en compte des réclamations des patients...................................................................................................... 59
C. La gestion des contentieux.......................................................................................................................................... 60

4
1. L’ACTIVITE, LA STRATEGIE D’ACTION ET LES COOPERATIONS DEVELOPPEES PAR
L’ETABLISSEMENT
1.1. LES COMPOSANTES DU CENTRE HOSPITALIER
Le Centre hospitalier (CH) de Pau est un établissement public de santé de niveau II1 au sens du
Schéma régional de l’organisation sanitaire (SROS) et de niveau III2 pour quatre disciplines (réanimation
néonatale et réanimation pédiatrique ; obstétrique ; chirurgie rétinienne ; chirurgie thoracique). Il est au
service de la population du territoire de santé de Béarn et Soule et, le cas échéant de celle de territoires
voisins des Landes et des Hautes Pyrénées.
Il disposait en 2007 de 746 lits et places installés, répartis sur trois centres d’accueil, regroupés sur un
même site géographique :
- l’hôpital François Mitterrand (ouvert en 1988), qui regroupe les services de médecine, chirurgie et
obstétrique (MCO), ainsi que deux pôles d’urgences –adultes et pédiatriques- et deux unités de réanimation
(au total 471 lits et places) ;
- le centre Hauterive (créé en 1982), qui rassemble le service de rééducation fonctionnelle ainsi que le
service de réadaptation médicale (avec au total 73 lits et places de service de suite et de rééducation), l’unité
d’alcoologie, les Soins ambulatoires des maladies infectieuses et toxicomanies (SAMIT), le Département
d'information médicale, d'évaluation et de santé publique (DIMESP) et l’unité de médecine nucléaire ;
- le Centre Jean Vignalou (créé en 1970-1972), qui rassemble des activités de médecine gériatrique, de
moyen et de long séjour, autour desquelles fonctionne un secteur médico-technique (au total 202 lits de
gériatrie, de service de suites et rééducation et de long séjour) ;
Le CH dispose aussi de trois unités complémentaires de formation (l’Institut de formation en soins
infirmiers -IFSI-, l’Institut de formation des cadres de santé (IFCS) et l’Institut de formation des aides
soignants). Font également partie du CH : l’Internat et le Centre de formation continue des professionnels de
santé.
Par ailleurs, ces implantations du CH de Pau sont voisines de différents autres établissements publics
(centre de transfusion sanguine) ou privés (deux cliniques, un établissement de soins de suite et de
réadaptation et un établissement de soins et d’éducation pour enfants et adolescents), qui se sont établis sur
le même site géographique, constituant ainsi, depuis 2003, le « Pôle de santé » de Pau.
1.2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT DE 2003 A 2007
Les constats suivants peuvent être tirés des données synthétiques d’activité produites par le CH :
- en 2007, les services de médecine représentaient 63 % des entrées et 45 % des journées réalisées ; les
services de chirurgie représentaient 19 % des entrées et 16 % des journées ; les services de gynécologie
obstétrique et sociale représentaient 7 % des entrées et 5 % des journées ; les services de soins de suite et de
réadaptation (SSSR) représentaient 11 % des entrées et 20 % des journées ; enfin, le service de soins de
longue durée (SSLD) représentait 0,1 % des entrées et 14 % des journées ;
- entre 2003 et 2007, le nombre total d’entrées a connu une augmentation globale de 6,0 % (passant de
40 426 à 42 480) ; seul les SSSR ont connu une légère diminution de leur nombre d’entrées ;
1 Etablissement proposant une offre de soins de proximité de niveau 1 ainsi qu’une offre de soins spécialisés regroupée sur un
pôle hospitalier accessible entre 1h et 1h30.
2 Offre de soins de niveau régional, hautement spécialisée

5
- entre 2003 et 2007, le nombre total de journées d’hospitalisation réalisées a augmenté de 2,6 %
(passant de 202 719 à 208 045) ; cette augmentation a surtout concerné les services de médecine et de
chirurgie ; l’unité de soins de longue durée n’a connu qu’une progression assez faible (ce qui est normal
étant donné son taux d’occupation très élevé depuis 2003, qui ne laissait guère de marge de progression) ;
les services de gynécologie et le service SSR ont connu une légère baisse du nombre de journées réalisées,
ce qui, dans le premier cas, s’explique par la diminution de la durée moyenne de séjour (passée de 3,8 jours
à 3,6 jours) ;
- la répartition des jours d'hospitalisation par catégorie majeure de diagnostic (CMD) est restée
relativement stable au cours de la période, deux CMD (d’une part, les affections et traumatismes de
l'appareil musculo - squelettique et du tissu conjonctif et, d’autre part, les affections du système nerveux)
représentant un quart des journées d’hospitalisation ;
- le taux d’occupation observé en 2007 pour ce qui concerne les services de médecine s’élevait à
79,3 %. L’établissement a estimé que le taux d’occupation qui avait été observé pour 2003 (81,28 %) n’était
pas comparable à celui de 20073. Mais, quoi qu’il en soit, en dépit des augmentations constatées du nombre
d’entrées et du nombre de jours de séjours et malgré la restructuration opérée en 2006, le taux d’occupation
des services de médecine ne semble a priori guère s’être amélioré. Par ailleurs, selon l’outil de « diagnostic
flash » établi à l’initiative du Ministère de la santé4, le taux cible en ce domaine est de 85 % ; le CH de Pau
se situe donc encore assez nettement en dessous de cet objectif ;
. le taux d’occupation des services de chirurgie s’élevait en 2007 à 70,8 %, soit une légère progression
par rapport à 2003 (70,1 %). Toutefois, selon l’outil de « diagnostic flash » précité, le taux cible en ce
domaine est de 75 % ; le CH de Pau se situe donc là aussi en-dessous de cet objectif ;
. le taux d’occupation des services de gynécologie obstétrique et sociale s’élevait en 2007 à 73,1 %.
Toutefois, si l’on exclut du calcul la gynécologie sociale, on abouti à un taux d’occupation de 78,5 %, soit
une diminution par rapport à 2003 (80,88 %). Par ailleurs, selon l’outil de « diagnostic flash » précité, le
taux cible en ce domaine est de 85 % ; le CH de Pau se situe donc là également en-dessous de cet objectif.
Ces taux d’occupation plus faibles que les taux cibles du « diagnostic flash » s’expliqueraient
notamment par le fait que la durée moyenne des séjours en MCO est globalement plus courte au centre
hospitalier de Pau qu’en moyenne. Les écarts constatés pourraient aussi en partie s’expliquer par la prise en
charge de certains patients au titre de l’hospitalisation de jour dans des lits dédiés à l’hospitalisation
classique.
Il n’en demeure pas moins que la stagnation voire la baisse de certains coefficients d’occupation
justifient une attention particulière de la part du CH. Certes, depuis le passage à un mode de financement
basé sur la tarification à l’activité (T2A), ces coefficients ne constituent plus des éléments déterminants pour
le financement des centres hospitaliers. Toutefois, un coefficient d’occupation faible peut signifier une
adéquation imparfaite de l’offre de soins à la demande, potentiellement génératrice de coûts fixes non
compensés par des recettes.
Le Directeur du CH a indiqué que les constats précités étaient effectivement de nature à inciter
l’établissement à approfondir sa réflexion, engagée dans le cadre du nouveau projet d’établissement, sur
l’adéquation de ses structures à l’activité réelle (notamment avec la recherche du développement de
l’hospitalisation de jour).
3 Car les taux d’occupation calculés de 2003 à 2005 ne répondaient pas exactement aux définitions 2007 de la Statistique
Annuelle des Etablissements de santé (SAE). Les taux d’occupation antérieurs à 2005 seraient donc supérieurs à des taux calculés
dans le respect des définitions SAE 2007.
4 Version 2007 disponible sur le site internet : http://www.atih.sante.fr/index.php?id=000240008CFF
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
1
/
61
100%