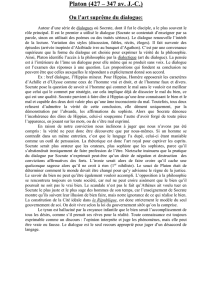cYniSme et coSmoPoLitiSme : Socrate et Son fou

CYNISME ET COSMOPOLITISME:
SOCRATE ET SON FOU
Je voudrais montrer globalement que certaines références de Montaigne
à Socrate témoignent certes d’une considération pour la pratique vivante
de la philosophie de ce dernier, mais qu’elles sont aussi l’occasion d’ouvrir
un débat sur l’idée d’une pratique vivante de la philosophie entre les
socratiques1, tels qu’ils se définissent à la lecture de Xénophon, Plutarque,
Diogène Laërce ou Cicéron, et au sein desquels il conviendrait dès
lors d’ajouter à la seule figure de Socrate, celles des sages sceptiques,
stoïciens et surtout cyniques, en considérant ces diérentes formes
de sagesse socratique comme poreuses et comme dialoguant les unes
avec les autres. Or de ce débat, le personnage de Socrate sort parfois
perdant ; il est mis en diculté précisément en tant que représentant
d’un savoir fait de « preceptes qui reelement et plus jointement servent
à la vie2 ». Non pas qu’il y aurait chez lui divorce entre les préceptes
et la vie, mais étant donné la nature même de leur rapport et la valeur
qu’il faut donner à celui-ci. Ceci m’amènera à déplacer le débat, tel que
classiquement posé au sujet de Montaigne, du terrain de la franchise
vers celui de l’alèthurgie et des manifestations de la vérité dans et par
les formes de vie3. Ce faisant, il ne s’agit nullement de substantialiser
les diérentes « écoles » socratiques, mais de faire émerger un débat au
sein du socratisme, principalement grâce à la diérence produite dans
1 Au sens où ils sont par exemple analysés dans G. Romeyer Dherbey (dir.) et J.-B. Gourinat
(éd.), Socrate et les socratiques, Vrin, 2001.
2 Essais, III, 12, p.1037.
3 Et de la sorte, je tente de développer certaines intuitions de Michel Foucault qui, dans ses
derniers cours principalement ( L’Herméneutique du sujet, Gallimard Seuil, 2001, p.240 ;
Le Courage de la vérité, Gallimard Seuil, 2009, p.217 ; Dits et écrits, IV, Gallimard, 1994,
n
o
326, p.410), armait, sans jamais justifier son propos, que Montaigne témoignait de la
reconstitution d’une éthique du soi, ou du retour à soi, propre aux traditions hellénistique
et romaine, et en rupture avec le refus du soi et la dissolution de l’identité de l’ascétisme
et du mysticisme chrétiens.

238 THOMAS BERNS
le texte de Montaigne par la figure du cynique par rapport à celle de
Socrate… au point peut-être que la première permet d’achever le pro-
cessus d’humanisation de la seconde dans ce texte: Diogène de Sinope
pourrait en eet être vu comme « le fou de Socrate », qui en montre les
limites et qui le ramène ainsi à sa plus stricte humanité.
Dans Essais, I, 26 portant sur « l’institution des enfans », Montaigne,
après avoir mis en avant le « profit » qu’on peut tirer de lafréquentation
des historiens –juger de l’histoire plutôt que l’apprendre, au point qu’on
peut lire dans une œuvre des choses que son auteur n’y a pas mises– se
questionne sur la « frequentation du monde », un monde dont il tient
immédiatement à élargir l’horizon (au même titre qu’il élargit l’horizon
des livres). Pour cela, il rapporte les propos de Socrate:
On demandoit à Socrate d’où il estoit. Il ne respondit pas: D’Athenes ; mais:
Du monde. Luy, qui avoit son imagination plus plaine et plus estandüe,
embrassoit l’univers comme sa ville, jettoit ses connoissances, sa société et
ses aections à tout le genre humain.
Les morales et les consignes véhiculées dans cet essai pédagogique
et mondain rédigé dans les années 1580 par Montaigne sont claires et
immédiates, sans doute parce qu’elles sont, pour une fois et explicitement,
adressées à quelqu’un d’autre qu’à lui-même: il s’agit d’élargir la vue de
l’enfant, de lui apprendre à analyser les événements d’un point de vue
global plutôt que local, de manière à leur donner « leur juste grandeur
1
».
Les sources de cette référence à Socrate sont tout aussi claires:
Plutarque (De l’exil, 5) et peut-être Cicéron (Tusculanes, V, xxxvii, 107),
qui, l’un comme l’autre, traitent de l’exil en se demandant s’il doit
aecter le sage. Les exemples choisis par ces deux auteurs ne permettent
pas de savoir s’ils ont exclusivement l’exil contraint à l’esprit, entendu
donc comme une sanction. En tout cas, il s’agit de se questionner sur
comment se comporter face à des événements qui surviennent, mais qui
pourraient ne pas être considérés comme étant comme tels des mal-
heurs, même si l’opinion commune leur donne ce sens aigeant ; on est
face à l’opposition habituelle entre vérité ou vraie nature et apparence.
Plutarque prend d’ailleurs immédiatement l’exemple de la peur des
enfants face aux masques: l’exil eraie, comme un masque fait peur à
1 Essais, I, 26, p.157.

CYNISME ET COSMOPOLITISME: SOCRATE ET SON FOU 239
un enfant, alors que la juste réalité est au-delà des nations. Rien de bien
surprenant dans cet appel à une imagination universelle.
Notons cependant que ce débat sur le cosmopolitisme et sur l’exil,
dans l’esprit de Montaigne et chez ses diérentes sources, est d’emblée
situé au plus loin du terrain politique sur lequel par exemple Euripide
l’avait précédemment placé quand il mettait dans la bouche de Polynice
que l’exil est un grand mal dès lors qu’il lui a fait perdre sa parrhêsia1,
sa liberté de parler: dans ce cadre, parole franche et cité s’articulent
dans un rapport de nécessité. Au contraire, le dialogue entre Socrate
et Diogène que nous allons décrire en nous appuyant sur le texte de
Montaigne, rompt et complique ce lien de nécessité, mais il n’en rend
pas moins possibles plusieurs formes de cosmopolitisme.
Notons enfin que le choix de Socrate chez Cicéron, Plutarque et
Montaigne (et d’autres à son époque) est particulièrement probléma-
tique: Socrate n’était en fait pas un exilé ; pire, il refusa même de le
devenir pour se sauver, ceci pour l’exil dans son sens contraint. Mais
Socrate n’est pas non plus un voyageur2 –sinon dans les rangs de l’armée,
dont les campagnes ne sauraient à proprement parler être considérées
comme des voyages. Dans les dialogues platoniciens qui ne sont pas
situés à Athènes ( comme les Lois, texte qui ne cesse de multiplier les
institutions, tel le Conseil Nocturne, chargées de filtrer le rapport à
l’étranger, jusqu’à élever l’autochtonie en principe), le personnage du
philosophe n’est pas Socrate mais « l’Athénien ». Socrate apparaît donc
comme le représentant d’un cosmopolitisme bizarrement sédentaire, et
donc théorique ! L’exemple d’un cosmopolitisme vécu, inscrit dans la
vie, devrait bien plutôt être cherché du côté des cyniques, Diogène de
Sinope par exemple, qui se serait eectivement défini comme kosmo-
politè, comme « citoyen du monde », et qui était bel et bien un exilé ;
Diogène, qui se moquait de l’homme théorique défini par la pensée
platonicienne
3
. Diogène enfin, que Platon lui-même aurait considéré
comme un « Socrate devenu fou4 ».
1 Euripide, Les Phéniciennes, v. 388 sq.
2 Montaigne lui-même le signale en Essais, I, 55, p.315.
3 Platon ayant défini l’homme comme un animal à deux pieds sans plume, et l’auditoire
l’ayant approuvé, Diogène apporta dans son école un coq plumé et dit: « Voilà l’homme
selon Platon » (Diogène Laërce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, Livre VI,
« Diogène », §14).
4 Ibid., VI, §54.

240 THOMAS BERNS
Y a-t-il quelque chose à penser dans le texte de Montaigne sur la base
de cet échange athénien de bons mots –avec l’espace qu’il ouvre entre deux
manières de penser la philosophie, l’une théorique et l’autre inscrite dans
la vie même–, autre chose donc qu’une simple approximation historique
bien légitime, puisque produite par un accommodement de Socrate à la
sauce stoïcienne, avec son attachement à une morale naturelle elle-même
directement influencée par les cyniques ? Pour répondre à cette question,
nous allons confronter ce premier passage déjà cité de Montaigne sur le
cosmopolitisme de Socrate à un second, plus tardif ( comme la plupart
des passages cités désormais, et en particulier ceux qui se réfèrent aux
penseurs cyniques), dans lequel il amène les mêmes arguments, mais en
les accompagnant cette fois de quelques éléments plus critiques. Montaigne
revient en eet sur ce même Socrate cosmopolite dans un chapitre bien
moins limpide, bien moins moral au sens commun du terme, bien plus
complexe et dont on pourrait croire qu’il ne cherche qu’à perdre le lecteur:
le chapitre III, 9, rédigé une petite dizaine d’années plus tard et intitulé
« De la vanité ». Deux remarques sur ce chapitre d’abord.
La première est toute générale et me permet de camper mon propos:
la vanité, objet de cet essai, c’est précisément ce dont le cynique entend
se défaire ; sa vertu, ou sa liberté se vivent et s’éprouvent comme détache-
ment ou indiérence: l’atuphia, l’absence de vanité. Montaigne poursuit
ce questionnement sur la vanité, mais sa critique de la vanité est bien
plus radicale, bien plus cynique pourrait-on dire, puisqu’elle ne suppose
nullement la possibilité de s’en libérer. C’est par contre dans la manière
de faire émerger la vérité de la vanité, de la vie comme vanité, que la
proximité de Montaigne par rapport aux cyniques, et son éloignement
de Socrate, pourront s’armer, à savoir en se référant à des exemples tirés
du quotidien, au nom du rapport au quotidien le plus simple et le plus
immédiat, bref à partir des formes de vie: la vanité et le détachement sont
appréhendés par Montaigne non pas sur le mode philosophique –« je ne
suis pas philosophe
1
»–, mais à partir par exemple d’un questionnement sur
le poids du « mesnage » et des « aaires domestiques ». C’est précisément
dans cette mise en avant des formes de vie comme expression de la vérité
que se manifeste sa familiarité avec Diogène, lequel « respondit, selon
moy, à celui qui luy demanda quelle sorte de vin il trouvait le meilleur:
1 Essais, III, 9, p.950.

CYNISME ET COSMOPOLITISME: SOCRATE ET SON FOU 241
l’estranger, feit-il1 ». Et c’est à partir de la question concrète du voyage
et du rapport à l’étranger, comme réelle et « continuelle exercitation »
de « l’âme2 », que la vérité de la vanité, la vérité de la vie comme vanité,
parvient à se dire. On peut dire que cet exercice de l’âme qu’est le voyage
remplace confortablement celui de la pauvreté3 et de la provocation véhi-
culés par exemple4 dans les quelques textes de Laërce sur les cyniques.
La seconde remarque est extrêmement précise: dans ce chapitre III,
9, Montaigne dit craindre la « redicte » à cause de sa mauvaise mémoire ;
et pourtant, précise-t-il plus loin, il veut continuer à ajouter, sans corri-
ger. Fidèle à son habitude de la digression, il signale que l’ennuie tout
particulièrement une forme de « redicte » qui n’a pourtant rien à voir
avec la mémoire: celle de « l’inculcation », la redite qui vise à incul-
quer, telle celle du stoïcien qui ne cesse de répéter les mêmes principes,
absolument communs et universels, à propos de « chaque matiere »:
La redicte est par tout ennuyeuse […]. Je me desplais de l’inculcation, voire
aux choses utiles, comme en Seneque, et l’usage de son escole stoïque me
desplait, de redire sur chaque matière tout au long et au large les principes
et presuppositions qui servent en general, et realleguer tousjours de nouveau
les argumens et raisons communes et universelles5.
Or Montaigne se répète précisément à propos du cosmopolitisme de
Socrate. Mais il ne s’agit de sa part nullement de redire la même leçon,
ni même de donner la moindre leçon, bien plutôt de poursuivre le
procès de « l’inculcation » de la philosophie dans sa forme académique
(au sens strict) et livresque. Cette fois, il reprend donc directement ce
cosmopolitisme à son compte:
Non parce que Socrates l’a dict, mais parce qu’en verité c’est mon humeur, et à
l’avanture non sans quelque excez, j’estime tous les hommes mes compatriotes,
et embrasse un Polonois comme un François, post-posant cette lyaison natio-
nale à l’universelle et commune…
1 Ibid., p.951.
2 Ibid.,p.973.
3 Repoussée explicitement par Montaigne, dans un passage portant sur Crates (Ibid.,p.954),
en ce qu’elle serait contraire à sa complexion.
4 Foucault, dans ses derniers cours, a bien montré combien les textes sur le cynisme véhi-
culent toujours aussi une critique du cynisme et n’en font l’éloge qu’à partir de cette
critique.
5 Essais, III, 9, p.962.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%
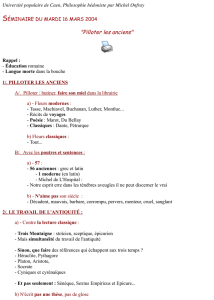
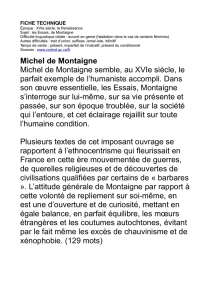


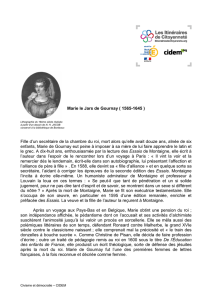

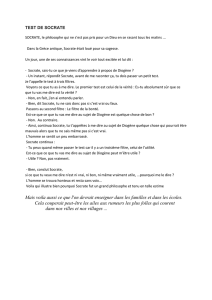
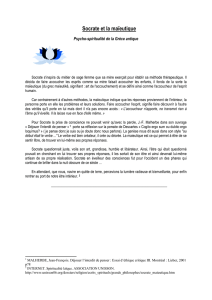


!["Les auteurs" [ / 33.06 Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002766794_1-066a78493fb2577980249b334dcf04ce-300x300.png)