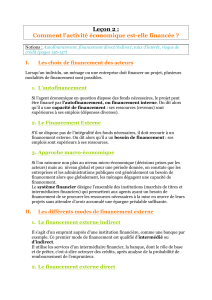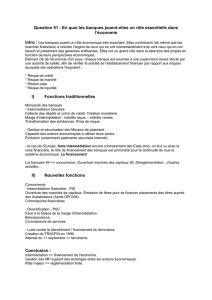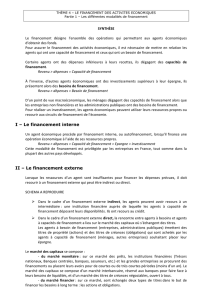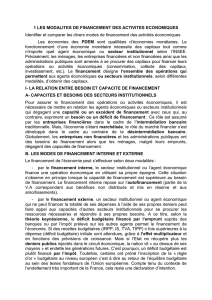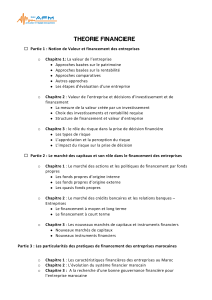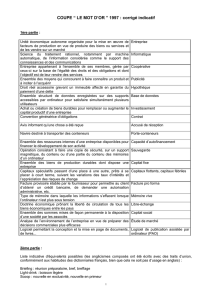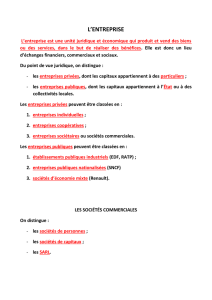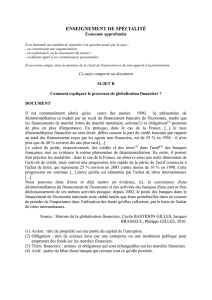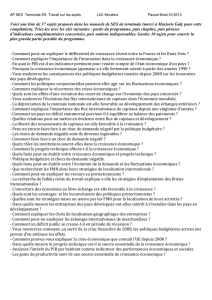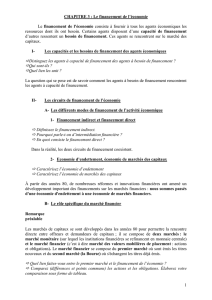Ce qu`une économie de marché de capitaux n`est pas

TFD 74/Mars 2004 33
TFD 74/Mars 2004
32
donc en rien assimilable à un système « tout marché »,
d’autant qu’au fur et à mesure que les financements
de marchés s’étendent, ils n’excluent nullement les
banques et les autres intermédiaires financiers, qui
bien au contraire, participent au développement et à
l’approfondissement des marchés de capitaux.
Le développement des marchés n’exclut pas davantage
l’intervention des pouvoirs publics, en raison de la
fragilité intrinsèque de la sphère bancaire et finan-
cière. Les réglementations évoluent, changent de
nature mais la supervision prudentielle de la sphère
bancaire et financière, impliquant nécessairement les
pouvoirs publics, demeure indispensable au bon
fonctionnement de la sphère bancaire et financière.
D’autant plus que si la libéralisation financière est
porteuse d’efficacité, elle engendre aussi une instabilité
accrue qui renforce le besoin de régulation.
En bref, rien au sein des pays industrialisés ne vient
prouver l’existence d’un modèle d’économie de marché
de capitaux uniforme, libéralisé, déréglementé vers
lequel les systèmes financiers auraient progressivement
convergé après avoir été dominés par des systèmes
orientés banques. La thèse de la convergence finan-
cière apparaît ainsi peu fondée. Or à la thèse de la
convergence est étroitement liée celle de la libérali-
sation financière selon laquelle, il conviendrait, pour
favoriser la croissance et le développement des pays
pauvres, d’opérer une mutation financière (libéralisation
des mouvements de capitaux, déréglementation ban-
caire, ouverture de marchés boursiers,…) destinée à
y transposer une économie de marché de capitaux.
C’est autour de cette thèse que s’est formé le
« consensus de Washington ». Ce dernier désigne l’idéo-
logie qui a conduit les grandes institutions internatio-
nales (FMI et Banque mondiale) à faire pression sur
les pays en développement pour qu’ils libéralisent
rapidement leur système bancaire et financier. L’éco-
nomie de marché de capitaux dont il s’agissait de
promouvoir le développement dans ces pays a dès
lors été assimilée à une libéralisation financière
importée clé en main, sans emprise sur le terrain,
c’est-à-dire sans prise en considération des besoins
de financement particuliers de l’économie locale
selon les caractéristiques de son tissu économique.
Cela a conduit à des contorsions douloureuses de la
part des pouvoirs publics locaux entre les exigences
d’une telle mutation conforme aux préceptes du
consensus de Washington et les pratiques locales. Un
véritable chemin de croix pour la plupart de ces pays
vécu dans le plus grand désarroi social, avec au final
pour certains d’entre eux (pays d’Asie du sud-est et
d’Amérique Latine) les graves crises financières que
l’on sait. Les stratégies de réduction de la pauvreté
mises en place par ces institutions sont loin d’être
arrivées à bout des problèmes posés par la libérali-
sation financière1.
L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invec-
tives déjà lancées contre les institutions financières
internationales, mais plutôt de défaire un certain
nombre d’idées reçues à propos de la nature des
systèmes financiers et de leur évolution. Le propos
que nous entendons défendre est le suivant : la thèse
de la libéralisation financière est infondée parce
qu’elle s’appuie sur une vision profondément erronée
de ce qu’est une économie de marché de capitaux.
Aussi nous appliquerons-nous à présenter ici ce
qu’une économie de marché de capitaux n’est pas !
Une économie de marchés de capitaux
n’est pas un modèle uniforme
Le modèle anglo-saxon correspond-il à un mythe ou
à une réalité ? S’agit-il d’un stéréotype ou d’un véri-
table archétype ? Ce modèle de finance de marché
caractérise-t-il plus le Royaume-Uni et les Etats-
Unis que le reste des pays de l’OCDE ? Constitue-t-
il un modèle vers lequel seraient censés converger
les systèmes orientés banques ?
Le modèle anglo-saxon :
mythe ou réalité?
Le modèle anglo-saxon réunirait des pays, en
particulier le Royaume-Uni et les Etats-Unis, dont le
système financier serait « basé sur le marché
financier » (Market-based system), c’est-à-dire carac-
térisé par un marché financier fortement développé
1. Voir le numéro spécial « Les stratégies de réduction de
la pauvreté en débat », Techniques financières et dévelop-
pement, n° 69, décembre 2002.
Introduction
L’analyse de la mutation financière est restée très
empreinte d’une vision dichotomique des systèmes
financiers (orientés banques / orientés marchés),
l’idée étant que le développement des marchés
devrait nécessairement produire un basculement
d’une économie d’endettement à une économie de
marchés de capitaux caractérisée par une désintermé-
diation des financements. Il est courant d’entendre,
par exemple à propos du cas de la France, que la
modernisation du secteur bancaire et financier français,
opérée au cours des années 1980, aurait permis le
passage d’une économie d’endettement, censée
caractériser la situation du financement de l’économie
française au cours de la période 1960-1980, durant
laquelle la bancarisation se développe, à une économie
de marché de capitaux où le financement intermédié
n’occuperait plus qu’une position résiduelle par rap-
port au financement direct. Cette vision souvent
étendue à l’ensemble des systèmes financiers débou-
che sur une vision déterministe et linéaire du déve-
loppement des systèmes financiers : en se dévelop-
pant, les systèmes financiers passeraient de systèmes
orientés banques à des systèmes orientés marchés.
L’idée de convergence financière vers un modèle
uniforme orienté marchés, généralement associé à la
situation des pays anglo-saxons, s’appuie sur cette
vision déterministe.
Pourtant, à bien observer les systèmes financiers des
pays industrialisés et, en particulier, ceux des pays
anglo-saxons (notamment, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni), s’il est une caractéristique qui res-
sort, c’est bien l’absence d’uniformité ou tout au
moins la mixité de ces systèmes financiers, caractérisés
par la coexistence des différents modes de financements
(autofinancement, crédit bancaire, financements de
marché). La maturité des systèmes financiers n’est
Ce qu'une économie de marché
de capitaux n'est pas
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN • Université de Paris I – TEAM
Dhafer SAIDANE * • Université de Lille 3 – GREMARS & Épargne Sans Frontière
* Les auteurs remercient Bernard PARANQUE ainsi que
les participants au colloque « Le financement d’une éco-
nomie émergente », Nabeul (Tunisie) les 22-23 mai 2003
pour leurs remarques sur une version antérieure de ce
papier.
Résumé
L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invectives déjà lancées contre les institutions financières
internationales, mais plutôt de défaire un certain nombre d’idées reçues à propos de la nature des systèmes
financiers et de leur évolution. Le propos que nous entendons défendre est le suivant : la thèse de la libérali-
sation financière, ou tout au moins l’interprétation qui en est souvent restituée, est infondée parce qu’elle
s’appuie sur une vision profondément erronée de ce qu’est une économie de marché de capitaux. Pour ce
faire, nous nous appliquons ici à présenter ce qu’une économie de marché de capitaux n’est pas. Une défini-
tion par la négative déclinée en quatre points :
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas un modèle uniforme.
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas le résultat d’un «évolutionnisme financier ».
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement désintermédiée.
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement déréglementée.

TFD 74/Mars 2004 33
TFD 74/Mars 2004
32
donc en rien assimilable à un système « tout marché »,
d’autant qu’au fur et à mesure que les financements
de marchés s’étendent, ils n’excluent nullement les
banques et les autres intermédiaires financiers, qui
bien au contraire, participent au développement et à
l’approfondissement des marchés de capitaux.
Le développement des marchés n’exclut pas davantage
l’intervention des pouvoirs publics, en raison de la
fragilité intrinsèque de la sphère bancaire et finan-
cière. Les réglementations évoluent, changent de
nature mais la supervision prudentielle de la sphère
bancaire et financière, impliquant nécessairement les
pouvoirs publics, demeure indispensable au bon
fonctionnement de la sphère bancaire et financière.
D’autant plus que si la libéralisation financière est
porteuse d’efficacité, elle engendre aussi une instabilité
accrue qui renforce le besoin de régulation.
En bref, rien au sein des pays industrialisés ne vient
prouver l’existence d’un modèle d’économie de marché
de capitaux uniforme, libéralisé, déréglementé vers
lequel les systèmes financiers auraient progressivement
convergé après avoir été dominés par des systèmes
orientés banques. La thèse de la convergence finan-
cière apparaît ainsi peu fondée. Or à la thèse de la
convergence est étroitement liée celle de la libérali-
sation financière selon laquelle, il conviendrait, pour
favoriser la croissance et le développement des pays
pauvres, d’opérer une mutation financière (libéralisation
des mouvements de capitaux, déréglementation ban-
caire, ouverture de marchés boursiers,…) destinée à
y transposer une économie de marché de capitaux.
C’est autour de cette thèse que s’est formé le
« consensus de Washington ». Ce dernier désigne l’idéo-
logie qui a conduit les grandes institutions internatio-
nales (FMI et Banque mondiale) à faire pression sur
les pays en développement pour qu’ils libéralisent
rapidement leur système bancaire et financier. L’éco-
nomie de marché de capitaux dont il s’agissait de
promouvoir le développement dans ces pays a dès
lors été assimilée à une libéralisation financière
importée clé en main, sans emprise sur le terrain,
c’est-à-dire sans prise en considération des besoins
de financement particuliers de l’économie locale
selon les caractéristiques de son tissu économique.
Cela a conduit à des contorsions douloureuses de la
part des pouvoirs publics locaux entre les exigences
d’une telle mutation conforme aux préceptes du
consensus de Washington et les pratiques locales. Un
véritable chemin de croix pour la plupart de ces pays
vécu dans le plus grand désarroi social, avec au final
pour certains d’entre eux (pays d’Asie du sud-est et
d’Amérique Latine) les graves crises financières que
l’on sait. Les stratégies de réduction de la pauvreté
mises en place par ces institutions sont loin d’être
arrivées à bout des problèmes posés par la libérali-
sation financière1.
L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invec-
tives déjà lancées contre les institutions financières
internationales, mais plutôt de défaire un certain
nombre d’idées reçues à propos de la nature des
systèmes financiers et de leur évolution. Le propos
que nous entendons défendre est le suivant : la thèse
de la libéralisation financière est infondée parce
qu’elle s’appuie sur une vision profondément erronée
de ce qu’est une économie de marché de capitaux.
Aussi nous appliquerons-nous à présenter ici ce
qu’une économie de marché de capitaux n’est pas !
Une économie de marchés de capitaux
n’est pas un modèle uniforme
Le modèle anglo-saxon correspond-il à un mythe ou
à une réalité ? S’agit-il d’un stéréotype ou d’un véri-
table archétype ? Ce modèle de finance de marché
caractérise-t-il plus le Royaume-Uni et les Etats-
Unis que le reste des pays de l’OCDE ? Constitue-t-
il un modèle vers lequel seraient censés converger
les systèmes orientés banques ?
Le modèle anglo-saxon :
mythe ou réalité?
Le modèle anglo-saxon réunirait des pays, en
particulier le Royaume-Uni et les Etats-Unis, dont le
système financier serait « basé sur le marché
financier » (Market-based system), c’est-à-dire carac-
térisé par un marché financier fortement développé
1. Voir le numéro spécial « Les stratégies de réduction de
la pauvreté en débat », Techniques financières et dévelop-
pement, n° 69, décembre 2002.
Introduction
L’analyse de la mutation financière est restée très
empreinte d’une vision dichotomique des systèmes
financiers (orientés banques / orientés marchés),
l’idée étant que le développement des marchés
devrait nécessairement produire un basculement
d’une économie d’endettement à une économie de
marchés de capitaux caractérisée par une désintermé-
diation des financements. Il est courant d’entendre,
par exemple à propos du cas de la France, que la
modernisation du secteur bancaire et financier français,
opérée au cours des années 1980, aurait permis le
passage d’une économie d’endettement, censée
caractériser la situation du financement de l’économie
française au cours de la période 1960-1980, durant
laquelle la bancarisation se développe, à une économie
de marché de capitaux où le financement intermédié
n’occuperait plus qu’une position résiduelle par rap-
port au financement direct. Cette vision souvent
étendue à l’ensemble des systèmes financiers débou-
che sur une vision déterministe et linéaire du déve-
loppement des systèmes financiers : en se dévelop-
pant, les systèmes financiers passeraient de systèmes
orientés banques à des systèmes orientés marchés.
L’idée de convergence financière vers un modèle
uniforme orienté marchés, généralement associé à la
situation des pays anglo-saxons, s’appuie sur cette
vision déterministe.
Pourtant, à bien observer les systèmes financiers des
pays industrialisés et, en particulier, ceux des pays
anglo-saxons (notamment, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni), s’il est une caractéristique qui res-
sort, c’est bien l’absence d’uniformité ou tout au
moins la mixité de ces systèmes financiers, caractérisés
par la coexistence des différents modes de financements
(autofinancement, crédit bancaire, financements de
marché). La maturité des systèmes financiers n’est
Ce qu'une économie de marché
de capitaux n'est pas
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN • Université de Paris I – TEAM
Dhafer SAIDANE * • Université de Lille 3 – GREMARS & Épargne Sans Frontière
* Les auteurs remercient Bernard PARANQUE ainsi que
les participants au colloque « Le financement d’une éco-
nomie émergente », Nabeul (Tunisie) les 22-23 mai 2003
pour leurs remarques sur une version antérieure de ce
papier.
Résumé
L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invectives déjà lancées contre les institutions financières
internationales, mais plutôt de défaire un certain nombre d’idées reçues à propos de la nature des systèmes
financiers et de leur évolution. Le propos que nous entendons défendre est le suivant : la thèse de la libérali-
sation financière, ou tout au moins l’interprétation qui en est souvent restituée, est infondée parce qu’elle
s’appuie sur une vision profondément erronée de ce qu’est une économie de marché de capitaux. Pour ce
faire, nous nous appliquons ici à présenter ce qu’une économie de marché de capitaux n’est pas. Une défini-
tion par la négative déclinée en quatre points :
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas un modèle uniforme.
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas le résultat d’un «évolutionnisme financier ».
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement désintermédiée.
- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement déréglementée.

TFD 74/Mars 2004 35
TFD 74/Mars 2004
34
L’étude de Amable et Paillard (2002) aboutit à plu-
sieurs résultats intéressants. L’autofinancement est
prépondérant dans tous les pays et en particulier dans
ceux traditionnellement classés dans les systèmes
fondés sur le marché (96 % aux Etats-Unis, 93 % au
Royaume-Uni). Le recours aux crédits bancaires est
partout plus important que les financements de marché
(actions, obligations et titres courts). En Allemagne,
censée être l’archétype du système fondé sur la
banque, la part du crédit figure parmi les plus faibles
et équivaut à celle qui prévaut aux Etats-Unis (envi-
ron 11 %). Le niveau relativement faible de recours
aux crédits bancaires en Allemagne et le niveau rela-
tivement élevé du financement interne (environ
80 %) rapprocheraient ce pays des Etats-Unis et du
Royaume-Uni. Une précision s’impose toutefois
dans la mesure où, en Allemagne, seules les PME
sont caractérisées par un faible niveau d’autofinance-
ment et un fort endettement auprès des banques
(Sauvé et Scheuer (1999)). En revanche, les grandes
ENF allemandes financent leurs investissements
grâce à leurs fonds propres. Ainsi le « modèle alle-
mand » d’un financement fondé sur la banque cor-
respond essentiellement à celui des PME du pays,
distinctes à cet égard des grandes entreprises dont le
mode de financement est plus proche du modèle
anglo-saxon.
En ce qui concerne les appels au marché, ils se révè-
lent plus faibles que le recours au crédit et sont d’une
ampleur équivalente aux Etats-Unis (7,8 %), au
Japon (7,5 %), en France (7,6 %) et en Italie (8.1 %).
Ils sont négatifs dans tous les autres pays notamment
au Royaume-Uni (-0,4 %) : les ENF rachètent leurs
propres actions afin d’augmenter la valeur actionna-
riale et de se protéger des OPA. Lorsqu’il n’est pas
négatif, le flux net des émissions d’actions contribue
faiblement au financement des ENF, excepté en Italie.
Dans leur ensemble, ces résultats ne soutiennent
guère la classification académique habituellement
retenue dans la littérature : « Bank based » vs
« Market Based ». Cette distinction apparaît en outre
d’autant moins bien fondée que la baisse du recours
au crédit bancaire traduit bien davantage un ralentis-
sement de l’investissement en capital physique
qu’une évolution de la structure des financements.
L’examen de la structure de la dette des ENF
(Augory et Pansard, 2003) ne remet pas moins en
question la validité d’un modèle uniforme de finan-
cement anglo-saxon (Cf. Tableau 2) :
États-Unis Japon Allemagne R. U Italie France1Pays-Bas 2Suède 3
Autofinancement 96,1 69,9 78,9 93,3 59,5 72,8 106,9 77
Actions -7,6 3,5 0,1 -4,6 11,5 5,4 -6,2 -3
Crédits bancaires411,1 26,7 11,9 14,6 30,1 25,7 17,5 50,4
Obligations 15,4 4 -1 4,2 -3,4 3,2 0,7 -12,8
Autres titres de dette -15 -4,1 10,1 -7,5 2,3 -7,1 -18,9 -11,6
Tableau 1 : Structure du financement net des ENF 1970-1994 (en % du total)
Sources : Amable et Paillard (2002)
1. 1970-1996
2. 1985-1996
3. 1980-1996
4. Pour la France, les Pays-Bas et la Suède, total des emprunts à court et à long terme.
Titres du marché
Obligations Crédits
monétaire
1995 2001 1995 2001 1995 2001
Italie 0,4 0,4 3,5 4,0 96,2 95,6
Allemagne 0,3 1,4 6,1 3,1 93,6 95,5
Espagne 2,9 0,9 7,8 3,9 89,3 95,2
France 3,3 5,0 13,7 14,6 83,0 80,4
Royaume-Uni
3,0 2,6 17,5 22,4 79,5 75,0
Etats-Unis 6,0 4,3 51,4 57,6 42,5 38,1
Source : Augory et Pansard (2003)
Tableau 2 - Composition de la dette des ENF
(en % hors crédits commerciaux)
et un système bancaire participant faiblement à l’al-
location des ressources et à l’acquisition d’actifs
financiers. L’essentiel des fonds de long terme serait
mobilisé par le marché financier, ce qui favoriserait
les fusions et les prises de contrôle. La propriété
des firmes serait composée d’un nombre important
d’actionnaires (Shareholders) détenant chacun un
petit nombre d’actions, d’où une forte dilution du
capital. Le contrôle de la firme se ferait de l’extérieur,
c’est-à-dire principalement par des investisseurs
institutionnels comme les fonds de pension et les
compagnies d’assurance.
A l’opposé se situeraient des pays comme le Japon
ou l’Allemagne, où le système financier serait « basé
sur la banque » (Bank-based system), avec une forte
participation des banques dans l’industrie se traduisant
par leur présence marquée dans l’équipe de gestion
et dans la surveillance. Un petit nombre de grandes
banques financerait des investissements de long
terme et jouerait donc un rôle clé dans le processus
de croissance. Les firmes seraient ainsi très liées aux
banques par les crédits qu’elles contractent plus que
par les titres qu’elles émettent sur le marché. Il y
aurait très peu de fusions et de prises de contrôle. Le
contrôle de la firme se ferait de l’intérieur (stakeholders),
c’est-à-dire par les propriétaires représentés par un
petit nombre d’actionnaires détenant un nombre
important d’actions.
A l’échelle macroéconomique, le clivage «market
based system »versus «bank based system »se rap-
porte à celui entre « économie de marché de
capitaux » et « économie d’endettement ». Cette dis-
tinction qui constitue la base de la taxinomie tradi-
tionnelle des systèmes financiers est attribuée à John
Hicks. Dans The Crisis in Keynesian economics (La
crise de l’économie keynésienne), en 1974, Hicks est
en effet amené à distinguer entre deux types d’entre-
prises dont les besoins de liquidités diffèrent et ne
sont pas satisfaits de la même manière : les entrepri-
ses du secteur à fonds propres («auto-sector »)et
celles du secteur à découvert («overdraft sector »).
Il établit que les entreprises du secteur à fonds propres
assurent leur liquidité «principalement grâce à la
possession en propre d’actifs liquides »tandis que
dans le second, les entreprises pourvoient à leurs
besoins de liquidité grâce à l’assurance – au moins
apparente – d’une capacité d’emprunt. Son but n’est
alors pas d’étudier l’importance relative de chacun
de ces deux secteurs mais de saisir les implications
de cette distinction en matière de politique
monétaire2. Il mentionne simplement à cet égard que
«dans certains pays – dont [il] présume, les Etats-
Unis- le secteur à fonds propres est important et le
secteur à découvert, réduit ; dans d’autres, tels que
le Royaume-Uni, le secteur à découvert est plus
important ». Autrement dit, il note la présence simul-
tanée de ces deux types de secteurs dans «presque
toutes les économies »de son époque.
La taxinomie traditionnelle des systèmes financiers
repose néanmoins sur les deux cas purs évoqués par
Hicks, celui d’une économie à fonds propres – sans
secteur à découvert – et celui d’une économie à
découvert où les entreprises ne détiendraient pas de
réserves liquides, et seraient «totalement dépendan-
tes des banques pour leur liquidité». Cette taxino-
mie binaire oppose « économie d’endettement » où
prédominerait le crédit bancaire (financement indi-
rect) et « économie de marchés de capitaux » où pré-
dominerait l’émission de titre (financement indirect).
L’hétérogénéité manifeste des structures
de financements
Lorsqu’on examine la structure du financement des
entreprises non financières (ENF), on s’éloigne
considérablement de l’idée même d’un tel modèle
uniforme et a fortiori d’une convergence financière.
L’évolution de cette structure, au cours d’une ving-
taine d’années (1970-1994), révèle clairement la
coexistence des différents modes de financements,
financement interne (autofinancement) et finance-
ment externe, et au sein de ce dernier la coexistence
du crédit et des financements de marché. L’analyse
des flux nets de financements (Amable et Paillard
(2002)) reportée dans le tableau 1 confirme la diversité
des configurations :
2. Cette distinction lui permet de motiver son rejet d’une
conclusion alors largement répandue et hâtive à son sens,
selon laquelle, à la lecture de la théorie keynésienne, « on
ne peut rien faire d’important avec la politique monétaire ».
Hicks s’applique à montrer que « l’impotence relative de la
politique monétaire (…) n’a pas un caractère universel » et
qu’elle ne vaut que pour une « économie à fonds propres ».

TFD 74/Mars 2004 35
TFD 74/Mars 2004
34
L’étude de Amable et Paillard (2002) aboutit à plu-
sieurs résultats intéressants. L’autofinancement est
prépondérant dans tous les pays et en particulier dans
ceux traditionnellement classés dans les systèmes
fondés sur le marché (96 % aux Etats-Unis, 93 % au
Royaume-Uni). Le recours aux crédits bancaires est
partout plus important que les financements de marché
(actions, obligations et titres courts). En Allemagne,
censée être l’archétype du système fondé sur la
banque, la part du crédit figure parmi les plus faibles
et équivaut à celle qui prévaut aux Etats-Unis (envi-
ron 11 %). Le niveau relativement faible de recours
aux crédits bancaires en Allemagne et le niveau rela-
tivement élevé du financement interne (environ
80 %) rapprocheraient ce pays des Etats-Unis et du
Royaume-Uni. Une précision s’impose toutefois
dans la mesure où, en Allemagne, seules les PME
sont caractérisées par un faible niveau d’autofinance-
ment et un fort endettement auprès des banques
(Sauvé et Scheuer (1999)). En revanche, les grandes
ENF allemandes financent leurs investissements
grâce à leurs fonds propres. Ainsi le « modèle alle-
mand » d’un financement fondé sur la banque cor-
respond essentiellement à celui des PME du pays,
distinctes à cet égard des grandes entreprises dont le
mode de financement est plus proche du modèle
anglo-saxon.
En ce qui concerne les appels au marché, ils se révè-
lent plus faibles que le recours au crédit et sont d’une
ampleur équivalente aux Etats-Unis (7,8 %), au
Japon (7,5 %), en France (7,6 %) et en Italie (8.1 %).
Ils sont négatifs dans tous les autres pays notamment
au Royaume-Uni (-0,4 %) : les ENF rachètent leurs
propres actions afin d’augmenter la valeur actionna-
riale et de se protéger des OPA. Lorsqu’il n’est pas
négatif, le flux net des émissions d’actions contribue
faiblement au financement des ENF, excepté en Italie.
Dans leur ensemble, ces résultats ne soutiennent
guère la classification académique habituellement
retenue dans la littérature : « Bank based » vs
« Market Based ». Cette distinction apparaît en outre
d’autant moins bien fondée que la baisse du recours
au crédit bancaire traduit bien davantage un ralentis-
sement de l’investissement en capital physique
qu’une évolution de la structure des financements.
L’examen de la structure de la dette des ENF
(Augory et Pansard, 2003) ne remet pas moins en
question la validité d’un modèle uniforme de finan-
cement anglo-saxon (Cf. Tableau 2) :
États-Unis Japon Allemagne R. U Italie France1Pays-Bas 2Suède 3
Autofinancement 96,1 69,9 78,9 93,3 59,5 72,8 106,9 77
Actions -7,6 3,5 0,1 -4,6 11,5 5,4 -6,2 -3
Crédits bancaires411,1 26,7 11,9 14,6 30,1 25,7 17,5 50,4
Obligations 15,4 4 -1 4,2 -3,4 3,2 0,7 -12,8
Autres titres de dette -15 -4,1 10,1 -7,5 2,3 -7,1 -18,9 -11,6
Tableau 1 : Structure du financement net des ENF 1970-1994 (en % du total)
Sources : Amable et Paillard (2002)
1. 1970-1996
2. 1985-1996
3. 1980-1996
4. Pour la France, les Pays-Bas et la Suède, total des emprunts à court et à long terme.
Titres du marché
Obligations Crédits
monétaire
1995 2001 1995 2001 1995 2001
Italie 0,4 0,4 3,5 4,0 96,2 95,6
Allemagne 0,3 1,4 6,1 3,1 93,6 95,5
Espagne 2,9 0,9 7,8 3,9 89,3 95,2
France 3,3 5,0 13,7 14,6 83,0 80,4
Royaume-Uni
3,0 2,6 17,5 22,4 79,5 75,0
Etats-Unis 6,0 4,3 51,4 57,6 42,5 38,1
Source : Augory et Pansard (2003)
Tableau 2 - Composition de la dette des ENF
(en % hors crédits commerciaux)
et un système bancaire participant faiblement à l’al-
location des ressources et à l’acquisition d’actifs
financiers. L’essentiel des fonds de long terme serait
mobilisé par le marché financier, ce qui favoriserait
les fusions et les prises de contrôle. La propriété
des firmes serait composée d’un nombre important
d’actionnaires (Shareholders) détenant chacun un
petit nombre d’actions, d’où une forte dilution du
capital. Le contrôle de la firme se ferait de l’extérieur,
c’est-à-dire principalement par des investisseurs
institutionnels comme les fonds de pension et les
compagnies d’assurance.
A l’opposé se situeraient des pays comme le Japon
ou l’Allemagne, où le système financier serait « basé
sur la banque » (Bank-based system), avec une forte
participation des banques dans l’industrie se traduisant
par leur présence marquée dans l’équipe de gestion
et dans la surveillance. Un petit nombre de grandes
banques financerait des investissements de long
terme et jouerait donc un rôle clé dans le processus
de croissance. Les firmes seraient ainsi très liées aux
banques par les crédits qu’elles contractent plus que
par les titres qu’elles émettent sur le marché. Il y
aurait très peu de fusions et de prises de contrôle. Le
contrôle de la firme se ferait de l’intérieur (stakeholders),
c’est-à-dire par les propriétaires représentés par un
petit nombre d’actionnaires détenant un nombre
important d’actions.
A l’échelle macroéconomique, le clivage «market
based system »versus «bank based system »se rap-
porte à celui entre « économie de marché de
capitaux » et « économie d’endettement ». Cette dis-
tinction qui constitue la base de la taxinomie tradi-
tionnelle des systèmes financiers est attribuée à John
Hicks. Dans The Crisis in Keynesian economics (La
crise de l’économie keynésienne), en 1974, Hicks est
en effet amené à distinguer entre deux types d’entre-
prises dont les besoins de liquidités diffèrent et ne
sont pas satisfaits de la même manière : les entrepri-
ses du secteur à fonds propres («auto-sector »)et
celles du secteur à découvert («overdraft sector »).
Il établit que les entreprises du secteur à fonds propres
assurent leur liquidité «principalement grâce à la
possession en propre d’actifs liquides »tandis que
dans le second, les entreprises pourvoient à leurs
besoins de liquidité grâce à l’assurance – au moins
apparente – d’une capacité d’emprunt. Son but n’est
alors pas d’étudier l’importance relative de chacun
de ces deux secteurs mais de saisir les implications
de cette distinction en matière de politique
monétaire2. Il mentionne simplement à cet égard que
«dans certains pays – dont [il] présume, les Etats-
Unis- le secteur à fonds propres est important et le
secteur à découvert, réduit ; dans d’autres, tels que
le Royaume-Uni, le secteur à découvert est plus
important ». Autrement dit, il note la présence simul-
tanée de ces deux types de secteurs dans «presque
toutes les économies »de son époque.
La taxinomie traditionnelle des systèmes financiers
repose néanmoins sur les deux cas purs évoqués par
Hicks, celui d’une économie à fonds propres – sans
secteur à découvert – et celui d’une économie à
découvert où les entreprises ne détiendraient pas de
réserves liquides, et seraient «totalement dépendan-
tes des banques pour leur liquidité». Cette taxino-
mie binaire oppose « économie d’endettement » où
prédominerait le crédit bancaire (financement indi-
rect) et « économie de marchés de capitaux » où pré-
dominerait l’émission de titre (financement indirect).
L’hétérogénéité manifeste des structures
de financements
Lorsqu’on examine la structure du financement des
entreprises non financières (ENF), on s’éloigne
considérablement de l’idée même d’un tel modèle
uniforme et a fortiori d’une convergence financière.
L’évolution de cette structure, au cours d’une ving-
taine d’années (1970-1994), révèle clairement la
coexistence des différents modes de financements,
financement interne (autofinancement) et finance-
ment externe, et au sein de ce dernier la coexistence
du crédit et des financements de marché. L’analyse
des flux nets de financements (Amable et Paillard
(2002)) reportée dans le tableau 1 confirme la diversité
des configurations :
2. Cette distinction lui permet de motiver son rejet d’une
conclusion alors largement répandue et hâtive à son sens,
selon laquelle, à la lecture de la théorie keynésienne, « on
ne peut rien faire d’important avec la politique monétaire ».
Hicks s’applique à montrer que « l’impotence relative de la
politique monétaire (…) n’a pas un caractère universel » et
qu’elle ne vaut que pour une « économie à fonds propres ».

TFD 74/Mars 2004 37
TFD 74/Mars 2004
36
des marchés de capitaux sur le reste du monde ainsi
que durant la libéralisation du secteur de la finance »
(Stiglitz, 1998 a).
Le temps est l’un des obstacles majeurs à la libérali-
sation financière et à l’instauration d’une économie
de marché de capitaux. En effet, l’innovation finan-
cière de produits et de processus une fois établie
n’est pas adoptée instantanément par les acteurs. Il
faut un temps d’apprentissage suivi d’un temps
d’évaluation des changements. Le temps nécessaire à
l’adaptation, à la formation et à l’adhésion des
acteurs locaux aux nouvelles institutions peut être
plus long que prévu. Il est en tout cas plus long que
le temps exigé par la mise en place des réformes et
des textes. En outre, les coûts induits par ce double
effort d’apprentissage et d’adaptation sont à évaluer
à l’aune des rentes existantes résultant des pratiques
locales courantes.
Ainsi, même à supposer que les systèmes orientés
marchés puissent constituer un standard transposable
des pays riches vers les pays pauvres, la prise en
compte de ce temps réduit à bien peu la pertinence
des scénarios de basculement des systèmes orientés
banques vers les systèmes orientés marchés.
La libéralisation financière doit s’adapter
au tissu économique
On s’est attaché à montrer le peu d’emprise empi-
rique d’une vision polaire des systèmes financiers
opposant le système orienté banque à celui orienté
marché et dont l’évolution se réduirait à une trajectoire
linéaire qui irait du premier vers le second. L’hétéro-
généité des systèmes financiers est, au contraire,
manifeste. Empiriquement, il n’existe aucun modèle
standard car chaque système financier présente des
spécificités, liées en grande partie à l’apprentissage
mutuel de l’industrie et de la finance. Rien n’assure
en conséquence qu’une industrie croisse plus rapidement
dans un système financier basé sur le marché que
dans un système basé sur la banque (Beck et Levine,
2000). L’accent doit être mis sur les besoins de
financement des entreprises locales. La configuration
des systèmes financiers dépend fondamentalement
de la qualité de la réponse financière apportée au
tissu économique. Le problème n’est donc pas de
savoir comment orienter les pays pauvres vers des
systèmes financiers orientés marché, mais plutôt de
quels systèmes financiers ont besoin les entreprises
d’un pays pauvre afin d’entraîner la croissance et de
faire baisser le chômage. Or, si l’on part du principe
qu’il s’agit essentiellement de répondre aux besoins
de financement d’entreprises jeunes et de petite taille
qui, en raison de ces caractéristiques, présentent un
risque de signature élevé et parviennent difficilement
à se signaler aux marchés, le financement à réaliser
est à assimiler à un actif hautement « spécifique » 4
qui confère aux banques (et à d’autres intermédiaires
financiers) un avantage comparatif très net sur le
marché. C’est dire à nouveau combien il peut être
dommageable, dans le cadre d’une politique de déve-
loppement financier, de concentrer les efforts de
modernisation sur les marchés financiers sans
l’accompagner d’un effort de même ampleur au
niveau du secteur des intermédiaires bancaires et
financiers.
Une économie de marchés de capitaux
n’est pas nécessairement désintermédiée
Au cours de l’évolution des systèmes bancaires et
financiers, l’intermédiation bancaire et financière
peut connaître des phases de repli, mais il n’y a pas
lieu de penser, contrairement à l’idée reçue, que cela
coïncide avec une période de développement des
marchés. L’essor des marchés de capitaux nécessite
tout autant les apports massifs de liquidité des inter-
médiaires financiers, qu’il assure à ces derniers les
débouchés de nouvelles activités. La désintermédia-
tion n’est donc pas une conséquence naturelle du
développement des marchés, encore moins une
condition souhaitable qui faciliterait leur essor. Quel
que soit leur degré de maturité, « tous les pays [sys-
tèmes financiers] sont orientés vers la banque d’une
manière plus ou moins importante »5.
4. C’est-à-dire un actif difficilement « redéployable » au
sens de la théorie des coûts de transaction (Williamson,
1994).
5. Christensen (1992), cité par Goux (1993).
Seuls les Etats-Unis constituent une véritable excep-
tion par rapport au reste des pays. Le Royaume-Uni
qu’il est courant d’y associer pour désigner le
modèle de financement anglo-saxon ne présente
guère de similitudes en réalité. Le rôle des titres dans
le financement des ENF est sans commune mesure.
Il atteint aux Etats-Unis 62 % alors que pour les ENF
britanniques et françaises, il est respectivement de
25 % et 20 %.
Dans tous les pays, hormis les Etats-Unis, les prêts
bancaires constituent le mode d’endettement privilé-
gié des ENF, traduisant la robustesse sinon la néces-
sité de la relation de long terme banque-entreprise,
notamment pour des ENF n’ayant pas un bon rating
sur le marché.
Une économie de marchés de capitaux
n’est pas le résultat
d’un «évolutionnisme financier »
La taxinomie traditionnelle des systèmes financiers a
malheureusement inspiré le « consensus de
Washington ». Or, elle néglige la nécessaire mixité
des systèmes financiers fondée sur la complémenta-
rité entre les deux modes de financements externes
que sont le marché et l’intermédiation financière. De
plus, elle n’intègre pas le fait que la libéralisation
financière nécessite du temps et de la tempérance et
qu’elle doit s’adapter au tissu économique.
La taxinomie traditionnelle
a malheureusement inspiré
le «consensus de Washington »
La taxinomie traditionnelle telle qu’on l’a présentée
met en évidence deux catégories de systèmes
financiers : celui basé sur la banque (Bank-based) et
celui basé sur le marché (Market-based). Dans les
catégorisations les plus dichotomiques, le système
financier orienté vers la banque est un système admi-
nistré, c’est-à-dire assisté par l’Etat (State-assisted)
ou engendré par l’Etat (State-engendred) (Rybc-
zynski (1984)). Inversement, le système financier
orienté vers le marché financier est un système libé-
ralisé. Autrement dit, le financement bancaire est, à
l’extrême, assimilé à un financement réglementé ou
administré à l’opposé du financement de marché qui
serait déréglementé ou libéralisé. Dans cette logique
binaire, la banque signifie nécessairement l’adminis-
tration, la répression 3et la réglementation et à l’op-
posé, le marché financier la libéralisation, la dérégle-
mentation. Cette vision des choses sous-tend les thè-
ses évolutionnistes du « gradualisme » (Sequencing
financier) selon lesquelles, le système financier
devrait évoluer par une succession d’étapes, en par-
tant des banques pour finir par le marché, se défai-
sant ainsi de la mainmise des Etats (McKinnon,
1991).
Ces thèses ont forgé le consensus des grandes insti-
tutions financières internationales (FMI et Banque
mondiale) autour de la nécessité de libéraliser les
systèmes financiers des pays en développement pour
les ouvrir aux capitaux extérieurs. Conformément
aux vues présentées plus haut, cette politique de libé-
ralisation financière s’est malheureusement focalisée
sur le développement du marché financier, sans se
préoccuper dans la même mesure du secteur bancaire
qu’il aurait pourtant fallu au préalable consolider au
moyen de règles et d’exigences prudentielles adéquates.
Cette situation n’a fait qu’encourager le marché à
évoluer vers des activités spéculatives (Clément-
Pitiot, 2001).
La libéralisation financière nécessite
du temps et de la tempérance
« [...] dans les pays en développement, l’étendue des
réformes ne doit pas nous induire en erreur en pen-
sant que celles-ci peuvent avoir lieu du jour au len-
demain. Le processus d’élaboration d’un système
financier robuste est une action longue et difficile.
De ce fait, nous avons besoin d’être réalistes. Les
économies en développement sont moins prédispo-
sées à une régulation financière et plus vulnérables
aux chocs financiers. Nous avons besoin de tenir
compte de cette vulnérabilité dans nos recommanda-
tions en particulier durant le processus d’ouverture
3. La répression financière fait référence aux restrictions
gouvernementales se manifestant par la réglementation des
taux d’intérêt, la fixation du taux de réserves obligatoires à
un niveau élevé, l’orientation administrative de l’offre du
crédit et la limitation de la concurrence bancaire.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%