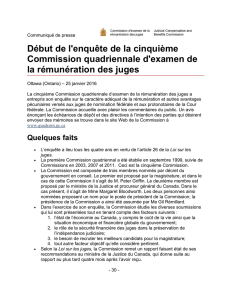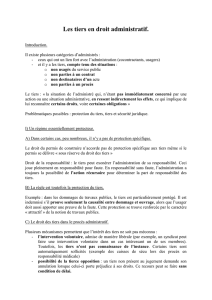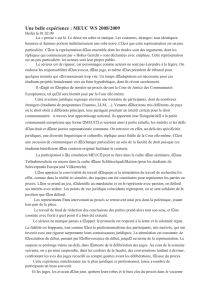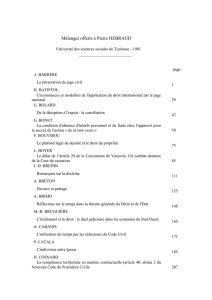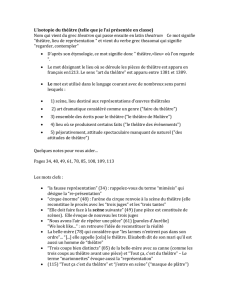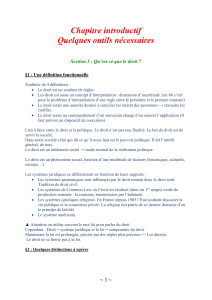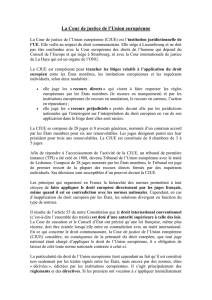Paul MARTENS

Les juges ne gouvernent pas : ils gèrent tant bien que mal une démocratie
du ressentiment, de la controverse, et de la défiance
____________________________________________
Parler de gouverner à propos du juge est une expression impropre car il manque au juge
un attribut essentiel du pouvoir : il ne peut jamais se saisir d’office et ne tranche que les litiges
que des citoyens décident de lui soumettre. Le véritable phénomène qui bouleverse les
rapports entre pouvoirs, c’est que le citoyen ne se satisfait plus du truchement de ses
représentants pour faire entendre sa voix : il s’adresse de plus en plus au juge pour sommer le
pouvoir de tenir les promesses qu’il lui avait faites. Il trouve, au prétoire, la possibilité
d’interpeller directement les décideurs politiques, ce qu’il ne peut faire au Parlement que par
la technique filtrée des questions parlementaires, il y goûte au contradictoire, avec cette
prodigieuse invention procédurale de l’égalité des armes, et il y apprécie une dramaturgie qui,
même s’il perd son procès, lui procure à tout le moins un retentissement médiatique.
Sans doute le juge pourrait-il décliner sa juridiction. Il fut un temps où les juges usaient et
abusaient des nullités de forme, des irrecevabilités, des exceptions d’incompétence et des
innombrables stratagèmes d’évitement qu’offrait l’ancien Code de procédure civile. La
procédure apparaissait alors comme un dispositif de barbelés placés autour des prétoires pour
éviter aux juges d’être trop souvent dérangés.
Mais le droit d’accès à un juge est devenu un droit fondamental : le droit à un procès
équitable, qui n’était à l’origine qu’un droit procédural, est devenu un droit substantiel depuis
que la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que ce que garantit l’article 6 de la
Convention européenne, ce n’est pas seulement que le justiciable soit traité équitablement
quand il est devant son juge mais c’est aussi qu’aucune entrave excessive ne doit l’empêcher
d’y arriver.
Cette montée en majesté de l’individu devait nécessairement avoir pour corollaire une
désublimation du pouvoir. L’individualisme triomphant a sa traduction juridique : les droits
subjectifs. Le citoyen a acquis un droit subjectif à la légalité dans l’exercice du pouvoir par
ceux qui le détiennent. Sous l’impulsion de la Cour de cassation, le juge est désormais non

2
seulement l’arbitre des litiges privés, mais le censeur des pouvoirs déficients, qu’il s’agisse de
l’exécutif (1920), du judiciaire (1991) ou du législatif (2006).
Et comme la légalité comporte notamment la norme omnivore inscrite à l’article 1382 du
Code civil, les détenteurs du pouvoir doivent eux aussi se comporter comme des bons pères
de famille. Quelle disgrâce pour ceux qui jusqu’en 1920 étaient à l’abri du regard des juges,
ayant hérité de la majesté qu’on avait enlevée aux princes !
Le Constituant avait cru canaliser le phénomène en chargeant des juges spécialisés – qu’à
tort il espérait plus dociles – de traiter les contentieux administratif et constitutionnel. Mais il
n’a pu combler la brèche créée par l’arrêt La Flandria dans laquelle sont ensuite tombés un à
un tous les « fauteurs publics », si majestueux fussent-ils.
Le point d’orgue à cette hypertrophie du judiciaire vient d’être écrit par la Cour de
cassation qui reconnaît aux juges judiciaires la compétence, non seulement, dans les
conditions qu’elle détermine, de censurer l’omission du législateur, mais même de punir son
abstention de libérer les budgets utiles aux services qu’il doit rendre.
On est encore en démocratie, mais celle-ci est de moins en moins représentative et de
plus en plus juridictionnelle. Si l’évolution ne paraît pas susceptible d’être arrêtée, encore
faudra-t-il que, soit le législateur, soit la jurisprudence, fournissent les limites qui permettent
de ne pas déséquilibrer les pouvoirs.
Concernant la responsabilité de l’Etat, engagée par le pouvoir judiciaire, l’arrêt ANCA II
a fixé des limites à ce point exigeantes que le contentieux est quasiment inexistant. On aurait
aimé trouver des réserves identiques dans l’arrêt FERRERA. Peut-être viendront-elles
ultérieurement pour éviter que ne se banalise un contrôle des choix discrétionnaires de
l’autorité budgétaire, le risque étant réel dans une démocratie du ressentiment de voir se
multiplier les procès faits par des groupes dont l’égoïsme est indifférent à la chose publique.
Quant à la question lancinante de la légitimité des juges pour exercer des contrôles que la
Constitution réserve, en principe, aux politiques, on redira que la légitimité n’est pas innée,
statutaire, d’origine. C’est par la qualité de ses appréciations, la mesure de ses censures,
l’acceptabilité de ses motifs que le pouvoir juridictionnel établira la légitimité de son contrôle.

3
Et c’est par la réceptivité de celui-ci, les enseignements qu’il en tirera, les corrections qu’au
besoin il écrira dans la loi ou la Constitution que le pouvoir parlementaire contribuera lui
aussi à l’équilibre des pouvoirs.
Les valeurs sont si dispersées, les citoyens sont si exigeants, tant de choses échappent au
pouvoir des Etats : ce n’est pas du retour à des normes étatiques claires que viendra le salut.
Quant aux normes supranationales, contaminées par le virus de la Common law, elles sont si
flexibles, si ouvertes, si indécises qu’elles ne prennent de sens que celui que les juges leurs
donnent. C’est dans le dialogue des juges, entre eux et avec les pouvoirs, la prise en compte
par les premiers de la dimension politique de leur fonction et l’acceptation par les seconds de
la nécessité d’un contrôle que s’établira une nouvelle forme de démocratie qui, à défaut de cet
équilibre, deviendrait une démocratie reposant sur d’autres formes de pouvoirs, infiniment
plus sournois, donc plus incontrôlables, qu’il s’agisse de celui de la rue, de l’argent, de
l’émotion ou des médias.
C’est donc moins l’élévation du pouvoir du juge que l’abaissement de celui du politique
qui explique l’interrogation formulée dans le titre. Dans une démocratie représentative fondée
sur la confiance, où le représentant était élu non pour porter la pensée du mandataire mais
pour penser à sa place, le citoyen n’éprouvait pas le besoin de le contrôler. La confiance était
un « économiseur institutionnel », qui permettait « de s’épargner tout un ensemble de
mécanismes de vérification et d’épreuve ». Mais dès lors que confiance et légitimité se
dissocient, qu’on entre dans une démocratie de défiance, que s’élèvent des pouvoirs indirects
qui concurrencent le pouvoir légitime
1
, il s’agit d’organiser cette défiance et de lui permettre
de s’exprimer, autrement que dans les vociférations populistes : dans un débat ouvert à
chacun, où peut même être entendue la voix de ceux qui ne l’ont pas assez forte pour qu’elle
soit entendue au Parlement.
Paul MARTENS
1
Pierre ROSANVALLON, « La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance », Seuil, 2006.
1
/
3
100%