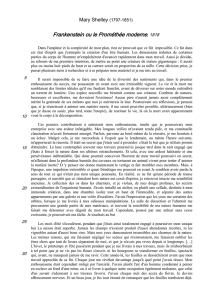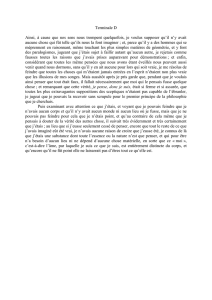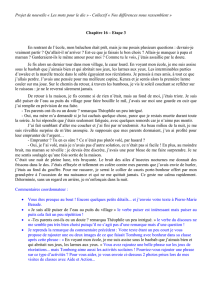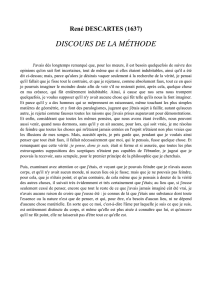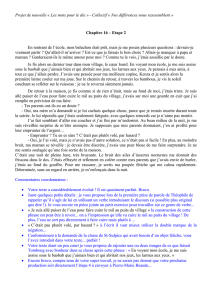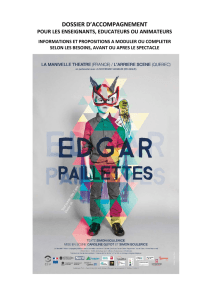Edgar Fruitier

Extrait de la publication


Collection dirigée par
Anne-Marie Villeneuve
Biographie
Extrait de la publication

Du même auteur chez Québec Amérique
Normand Chouinard, coll. Entretiens, 2007.
Gilles Renaud, coll. Entretiens, 2006.
Rémy Girard, coll. Entretiens, 2005.
Albert Millaire, coll. Entretiens, 2004.
Gérard Poirier, coll. Entretiens, 2003.
Françoise Faucher, coll. Biographie, avec la collaboration
d’Anne-Marie Villeneuve, 2000.

Extrait de la publication
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%