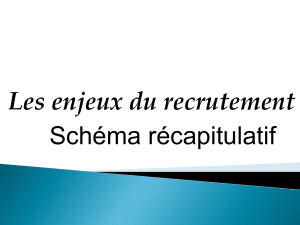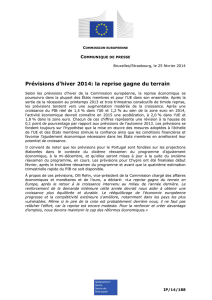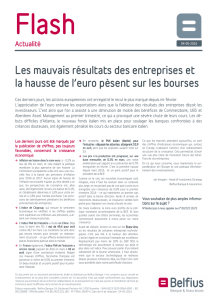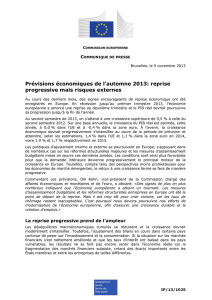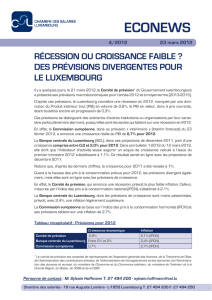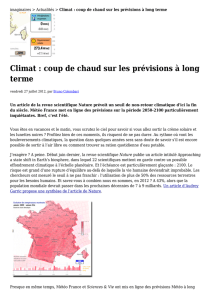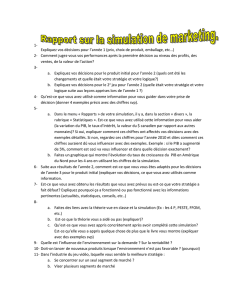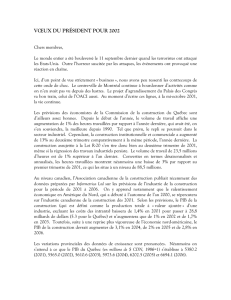Retour sur les prévisions de croissance de l`année 2003

Analyses Économiques
DP N° 41 – Juin 2004
Retour sur les prévisions de croissance de l’année 20031
La croissance française en 2003, estimée à 0,5% dans les comptes nationaux annuels, a été très infé-
rieure à la prévision de 2,5% sous-tendant le projet de Loi de Finances pour 2003. Cette erreur de pré-
vision a été partagée parmi les prévisionnistes et a été observée également pour la zone euro dans son
ensemble. En revanche, les prévisions réalisées à l'été ou à l'automne 2002 pour les États-Unis ont fina-
lement été atteintes voire dépassées, et la reprise au Japon a surpris par sa vigueur.
Pourquoi une telle erreur ? La réponse apportée ici en examinant le détail des révisions par rapport aux
prévisions officielles du PLF 2003 est triple :
• tout d'abord, les indicateurs conjoncturels n'ont commencé à signaler un possible retournement–
plutôt inhabituel en phase de reprise– qu'à l'été voire l'automne 2002 ;
• de plus, la dépréciation du dollar –non prise en compte dans les prévisions, qui sont traditionnelle-
ment réalisées à taux de change constants– a fortement pesé sur la croissance de la zone euro et de
la France ; par ailleurs, les prévisions avaient retenu, par convention, un scénario de résolution de la
crise irakienne sans conflit militaire ; néanmoins, la phase d’attente qui a précédé le conflit début
2003 a fortement pesé sur les comportements des agents économiques et a sans doute retardé le
rebond de l’activité qui n’est finalement intervenu qu’à l’automne 2003.
• enfin, la capacité de rebond autonome de la demande en France s'est révélée moins forte qu'attendu.
Dans un contexte de reprise vigoureuse en France et dans le monde, les prévisions intégraient un
certain rattrapage après l’absence de dynamisme de la demande des entreprises (investissement et
stocks) et des exportations observé au cours des années précédentes. Ce constat est d’ailleurs valable
aussi pour l’ensemble de la zone euro.
Un autre enseignement de ce retour sur les prévisions pour 2003 tient aux évolutions des prix. Si les
évolutions non anticipées des taux de change se sont bien traduites par une croissance plus faible que
prévu en France et dans la zone euro, les effets désinflationnistes de ces variations de change n'ont pas
été observés, du fait notamment de surprises d'inflation dans les secteurs de l'alimentation et des servi-
ces.
1. Ce document a été élaboré sous la responsabilité de la Direction de la Prévision et de l’analyse économique et ne reflète pas nécessairement la posi-
tion du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

2
1. Le ralentissement conjoncturel en France
et dans la zone euro fin 2002-début 2003 a
pris par surprise les prévisionnistes
1.1 Les prévisions de croissance pour 2003 ont
fortement varié au cours du temps, mais
c'est seulement dans la zone euro qu'elles
n'ont cessé d'être révisées à la baisse
Les prévisions de croissance pour l'année 2003,
pour la France comme pour la zone euro, ont été
continuellement révisées à la baisse de l'été 2002
à l’automne 2003 (cf. graphiques 1). C'est le cas des
prévisions du Gouvernement, comme de celles des
organisations internationales ou de la Commission
Européenne, ou encore du «Consensus Forecasts». Au
total, la croissance du PIB en 2003 pour la France aura
été de 0,5% (d'après les comptes nationaux annuels
provisoires publiés le 27 avril 2004), contre 2,5%
prévu dans le Projet de Loi de Finances pour 2003.
Pour la zone euro, la croissance aura été de 0,4% con-
tre 2,1% initialement prévu.
Aux États-Unis et en Asie, la croissance a en
revanche été plus en ligne, voire supérieure à la
plupart des prévisions de l'automne 2002. La nette
accélération de l'activité aux États-Unis au second
semestre 2003 a permis d'atteindre voire de dépasser
les prévisions initiales, alors que celles-ci avaient dans
un premier temps été révisées à la baisse à l'automne
2002. En Asie, la Chine a retrouvé des rythmes de
croissance très soutenus, et l'économie japonaise a
connu une reprise bien plus forte qu'anticipée.
L'année 2003 a ainsi été caractérisée par de forts
écarts de croissance entre les zones. Alors que la
plupart des prévisions de l'été et de l'automne 2002
décrivaient une croissance équilibrée de part et d'autre
de l'Atlantique, avec un écart de croissance entre ces
deux zones inférieur à 1 point, la croissance aux États-
Unis aura en fait été de près de 3 points supérieure à
celle de la zone euro.
Graphique 1a : évolution des prévisions
de croissance pour 2003
(Ministère de l'Économie et des Finances)
Graphique 1b : évolution des prévisions
de croissance pour 2003
(OCDE)
Graphique 1c : évolution des prévisions
de croissance pour 2003
(Commission Européenne)
Graphique 1d : évolution des prévisions
de croissance pour 2003
(Consensus Forecasts)
1.2 Une erreur de prévision concentrée sur la fin
2002 et le début de l'année 2003
En termes de profil trimestriel, c'est surtout à la fin de
l'année 2002 et au cours de la première moitié de
l'année 2003 que la croissance en France a été plus fai-
ble que prévu, comme l'illustre le graphique 2, à partir
des prévisions de la Commission européenne2. En
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Mars 2002 Sept 2002 Mars 2003 Sept 2003 Réalisé
Monde Etats-Unis Zone euro France
Minéfi : prévisions de croissance pour 2003
(Taux de croissance annuel du PIB en 2003, en %)
2. Les prévisions accompagnant le PLF sont réalisées en moyenne
annuelle.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Avril 2002 Octobre 2002 Avril 2003 Octobre 2003 Réalisé
OCDE Etats-Unis Zone euro France
OCDE : prévisions de croissance pour 2003
(Taux de croissance annuel du PIB en 2003, en %)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Avril 2002 Octobre 2002 Avril 2003 Octobre 2003 Réalisé
Monde Etats-Unis Zone euro France
Commission Européenne : prévisions de croissance pour 2003
(Taux de croissance annuel du PIB en 2003, en %)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
mars-02 sept-02 mars-03 sept-03 Réalisé
Monde Etats-Unis Zone euro France

3
particulier, le recul du PIB observé au 4ème trimestre
2002 que font désormais apparaître les comptes tri-
mestriels n'avait pas été anticipé.
Graphique 2 : croissance trimestrielle du PIB
français (Commission Européenne)
1.3 Les exportations et la demande des entrepri-
ses ont été très fortement révisées
Pour la France, toutes les composantes de la demande
ont été affectées par des révisions importantes3
(tableau 1). Les variations de stocks et les exportations
contribuent particulièrement fortement à l'écart de
croissance : la contribution des stocks à la croissance
a été de –0,2 point contre +0,8 point prévu en sep-
tembre 2002 dans les prévisions du Ministère de
l'Économie et des Finances, et les exportations ont
reculé de 2,5% alors qu'une augmentation de 6,0%
était prévue. L'investissement des entreprises a reculé
de près de 2%, contre une hausse prévue de 3,0%. La
consommation des ménages s'est un peu mieux main-
tenue, mais a crû à un rythme de 1,4% au lieu des 2,4%
prévus. Au total, la reprise tirée par les exportations et
la demande des entreprises décrite par les prévisions
ne s'est pas enclenchée.
Tableau 1 : prévisions (PLF 2003) et réalisations
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2000 T1 2000 T3 2001 T1 2001 T3 2002 T1 2002 T3 2003 T1 2003 T3
(taux de croissance trimestriels, en %)
Réalisé Prévisions CE automne 2002 Prévisions CE printemps 2002
Prévision automne 2002
3. Les écarts constatés sur la demande intérieure et les importations
sont évidemment en partie endogènes (une croissance plus faible se
traduit par moins de revenu donc moins de consommation, et par
un moindre effet accélérateur sur l'investissement et moins d'impor-
tations).
PLF 2003 Réalisé Ecart
(taux de croissance annuel en %)
PIB 2,5 0,5 -2,0
Demande intérieure hors stocks 2,1 1,4 -0,7
Consommation des ménages 2,4 1,4 -1,0
Formation brute de capital fixe 2,1 -0,2 -2,3
Sociétés et entreprises individuelles 3,0 -1,9 -4,9
Variations de stocks 1/ 0,8 -0,2 -1,0
Exportations nettes 1/ -0,4 -0,7 -0,3
Exportations 6,0 -2,5 -8,5
Importations 8,1 -0,1 -8,2
Emploi salarié, secteur marchand 1,1 0,0 -1,1
Indice des prix à la consommation 1,6 2,1 0,5
Indice des prix à la consommation, hors tabac 1,5 1,9 0,4
Inflation sous-jacente 1,6 1,6 0,0
Pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages 2,3 0,3 -2,0
Variation du taux d'épargne des ménages (en points) -0,1 -0,9 -0,8
PIB dans le monde 3,3 3,5 0,2
Etats-Unis 2,7 3,1 0,4
Zone euro 2,1 0,4 -1,7
Demande mondiale de biens adressée à la France 6,8 4,1 -2,7
Prix du baril de pétrole Brent (en US dollars) 2/ 25,0 28,8 15%
Taux de change euro / US dollar 2/ 0,98 1,13 15%
1/ Contribution à la croissance du PIB.
2/ Ecarts relatifs

4
1.4 L'inflation a en revanche été plus élevée que
prévu
Malgré une croissance beaucoup plus faible que
prévu, l'inflation a été plus élevée, à 2,1% en moyenne
annuelle 2003 contre une prévision initiale de 1,6%
(soit 1,9% hors tabac contre une prévision initiale de
1,5%). Les plus fortes contributions sectorielles à cet
écart sont localisées dans l'alimentation et les services
et sont en partie compensées par une inflation plus
faible que prévu pour les produits manufacturés.
L'inflation sous-jacente a été en ligne avec la prévi-
sion, à 1,6% en moyenne annuelle, malgré une activité
plus faible et une désinflation importée liée aux évolu-
tions des taux de change.
2. Trois éléments d'explication
2.1 Un retournement conjoncturel inattendu en
phase de reprise
Les prévisions économiques se fondent d'abord, pour
le trimestre en cours ou passé et le suivant4, sur les
informations conjoncturelles disponibles à la date de
la prévision (enquêtes de conjoncture, chiffres men-
suels de production et de consommation de produits
manufacturés, données des douanes…). Une des
explications de l'erreur de prévision générale pour
2003 est que jusqu'à la fin juillet 2002, ces informa-
tions étaient plutôt bonnes : les enquêtes faisaient
apparaître une stabilisation, qui ne semblait qu'une
simple pause après une forte accélération. La reprise
enclenchée début 2002 semblait donc devoir se pour-
suivre, d'autant que le retard de demande accumulé
dans la zone euro et le bas niveau des taux d’intérêt
plaidaient pour un rebond marqué. Dans l'industrie, si
l'enquête de juin 2002 semblait marquer une pause,
c'est seulement à partir de septembre-octobre que le
risque d’un ralentissement marqué est apparu (cf. DP-
AE n°27). Le Rapport Économique, Social et Finan-
cier annexé au PLF 2003 soulignait d'ailleurs les ris-
ques à la baisse, liés aux «incertitudes géopolitiques», à
la faiblesse de la demande intérieure en Allemagne et
en Italie, et aux turbulences boursières (pages 7-8).
2.2 Une évolution défavorable des taux de
change et de l'environnement extérieur5
Un des faits marquants de l'année 2003 a été l'évolu-
tion des taux de change : l'euro s'est apprécié d'envi-
ron 10% par rapport au dollar dans la seconde moitié
de l'année 2002, et d'encore environ 20% en 2003.
Graphique 3 : perspectives personnelles de
production des industriels
source : enquête de conjoncture de l’INSEE
La fin de 2002 et le premier semestre 2003 ont égale-
ment été marqués par un contexte international défa-
vorable. Les incertitudes géopolitiques liées à la guerre
en Irak ont pesé sur les échanges et sur la visibilité des
entreprises –peut-être aussi sur la confiance des
ménages– tout en tirant vers le haut le prix du baril de
pétrole (près de 29 USD en moyenne en 2003 contre
25 USD prévu). En Asie, le SRAS a bridé la reprise.
Ces facteurs externes se sont traduits par un ralentis-
sement du commerce mondial, et des contributions
très négatives du commerce extérieur à la croissance
en France au premier semestre 2003. Au-delà, la dété-
rioration des bilans des entreprises et le surinvestisse-
ment de la décennie 1990, notamment aux États-Unis,
ont probablement retardé la reprise de l'investisse-
ment et de l'emploi.
Au total, vus de France, ces facteurs «externes» se sont
traduits par une croissance de la demande mondiale
adressée à la France d'environ 4% en 2003 contre près
de 7% prévus à l'automne 2002. Les effets combinés
de ce choc de demande mondiale, du choc de taux de
change et du choc de prix du pétrole peuvent être esti-
més, à l'aide du modèle macro-économétrique
Mésange, à un peu plus de 1 point de croissance en
2003, après prise en compte des effets de bouclage
habituels (effets multiplicateurs et accélérateurs) :
½ point lié à la demande mondiale, ½ point lié au taux
de change6, et 0,1 point au prix du pétrole en dollars
(cf. tableau 2).
Ces chocs auraient dû avoir également un impact glo-
balement désinflationniste (d'environ ½ point), l'effet
des variations du taux de change l'emportant sur celui
du prix du baril de pétrole. Les craintes de déflation
dans la zone euro –entretenues au printemps 2003 par
la hausse du chômage, la persistance d'output gap
4. Les premiers résultats des comptes trimestriels sont disponibles
environ 50 jours après la fin du trimestre, une estimation précoce
du PIB étant depuis peu disponible une semaine avant.
5. Le chiffrage des effets sur la croissance des différents chocs non
anticipés est réalisé à l'aide du modèle macro-économétrique
Mésange.
6. Ceci ne représente pas l'effet total des variations du taux de change
sur la croissance en 2003, mais seulement la contribution des pertes
de compétitivité liées à l'appréciation de l'euro postérieure à la date
de la prévision : les effets retardés de l'appréciation de l'euro en
2002 étaient en effet pris en compte dans la prévision, et une partie
des effets défavorables des mouvements de change en 2003 est
intégrée dans l'effet «demande mondiale».
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Dernier point : septembre 2002
moyenne de long terme

5
creusés, et la concurrence de pays à faibles coûts– ne
se sont toutefois pas matérialisées.
2.3 Une capacité de rebond de la demande moins
forte qu'escompté
Les évolutions des taux de change et de l'environne-
ment extérieur ne suffisent pas à expliquer entière-
ment l'écart de 2 points entre la prévision et la
croissance observée en 2003. Les comportements de
demande des ménages et des entreprises ont égale-
ment été moins dynamiques qu'escompté, ce qui con-
tribue pour environ 1 point à l'erreur de prévision ( cf.
tableau 2 ci-dessous). En particulier, le fort rebond
technique des stocks inscrit en prévision (en partie lié
à la reprise de la demande intérieure et en partie à une
hypothèse de rattrapage) ne s'est pas produit. Au total,
le comportement plus prudent de stockage et d'inves-
tissement des entreprises a contribué pour environ
0,3 point à la révision de croissance, au delà de l'effet
accélérateur habituel.
La performance des exportations françaises a égale-
ment été beaucoup moins bonne qu'anticipé. La pré-
vision de l'automne 2002 tablait d'abord sur une
demande mondiale adressée à la France plus dynami-
que. Mais elle intégrait également un rebond auto-
nome des exportations, lié à un rattrapage après le fort
ralentissement antérieur : «la progression des exporta-
tions de produits manufacturés observée au cours des
dernières années a été un peu inférieure à ce que lais-
saient attendre ses déterminants usuels (demande
mondiale et compétitivité). En 2002 et 2003, ce retard
serait partiellement compensé, avec une croissance
des exportations allant légèrement au-delà de ce que
suggèrent les évolutions de leurs déterminants habi-
tuels» (Rapport Economique Social et Financier,
page 44). Ce rattrapage ne s'est pas produit, ce qui a
contribué à hauteur de ½ point à l'erreur de prévision.
L’analyse de ce phénomène a fait l’objet du DP-AE
n°32 : «Comment expliquer les pertes récentes de
parts de marché de la France à l’exportation de pro-
duits manufacturés».
La faiblesse de la consommation des ménages est éga-
lement allée au delà de ce que peut expliquer la moin-
dre progression du revenu ou les évolutions des prix.
La prévision tablait sur le fait qu'«après trois années de
comportement prudent, les ménages devraient quel-
que peu réduire leur épargne l'an prochain (RESF,
page 33)». La persistance d'une prudence de la part des
ménages plus forte qu'anticipé explique ainsi environ
0,3 point de révision du PIB.
Au total, alors que les prévisions de l'automne 2002
retraçaient un scénario cohérent de reprise forte, en
France et dans le monde, cette dynamique s'est grip-
pée fin 2002, du fait d'une conjonction de nombreux
facteurs défavorables : évolutions des taux de change,
incertitudes et manque de visibilité sur la situation
géopolitique mais aussi sur l'état des bilans des entre-
prises et les conséquences des chutes des bourses, dif-
ficultés liées au SRAS en Asie, etc… En particulier,
l’hypothèse d’un conflit militaire en Irak n’avait pas
été retenue dans le scénario central. Les prévisions
avaient retenu, par convention, un scénario de résolu-
tion pacifique de la crise irakienne ; or la phase de
forte incertitude précédent le début du conflit au prin-
temps de 2003 a fortement pesé sur les comporte-
ments des agents économiques et a sans doute retardé
le rebond de l’activité qui n’est finalement intervenu
qu’à l’automne 2003.
Tableau 2 : contributions à la révision de croissance 2003
Croissance du PIB, prévision de l’autome 2002 (RESF) 2,5
Contributions à la révision
Environnement international et financier –1,1
Demande mondiale –0,5
Euro et pétrole –0,6
Comportements modélisés –1,0
Consommation des ménages –0,3
Demande des entreprises (investissement et stocks) –0,3
Exportations –0,5
Importations 0,1
Finances publiques et autres facteurs 0,1
Croissance du PIB, comptes nationaux annuels 0,5
 6
6
1
/
6
100%