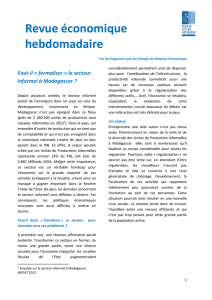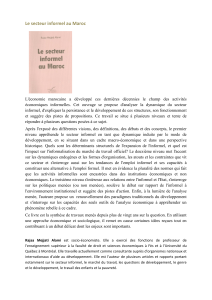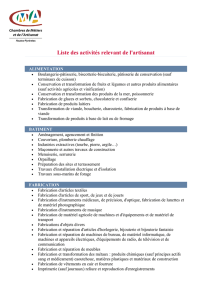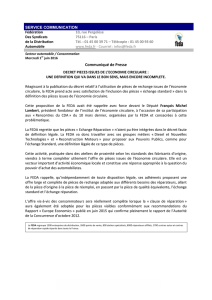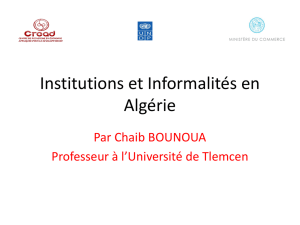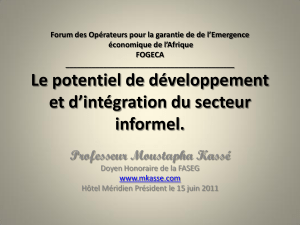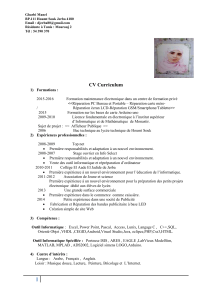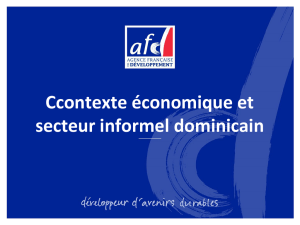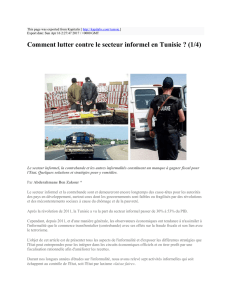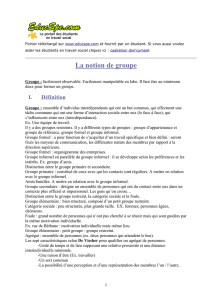Tunisia - Le développement par les petits métiers en Tunisie

Les nouvelles orientations des stratégies de développement :
le développement par les petits métiers en Tunisie
Hamadi SIDHOM
Université de la Manouba, Ecole Supérieure de Commerce de Tunis
Résumé
Ce papier s’intéresse aux stratégies de développement initiées en Tunisie qui préconisent le
développement par les petits métiers (micro-entreprise et petite entreprise).
Nous partons d’une enquête élaborée par le Ministère de développement sur les petits métiers dans les
quartiers urbains pauvres de l’intérieur du pays (Programme de Développement Urbain Intégré).
Nous avons essayé d’identifier les activités formelles involutives et les activités informelles évolutives. Le
niveau de revenu, la productivité, l’investissement, les modalités de commercialisation…, sont autant de
critères de différenciation entre le secteur intermédiaire évolutif caractérisé par une productivité marginale
de travail positive, une offre de travail illimité, une faible intensité capitalistique. Ce secteur peut assurer
la transition vers le secteur moderne et déclencher une dynamique de développement du secteur de
subsistance caractérisé par l’absence de barrières à l’entrée, un niveau d’emploi déterminé par la demande
domestique de biens inférieurs, utilisation de l’outil dans le processus de production…
Abstract
This paper deals with the strategies of development introduced in Tunisia which recommand the
development of small businesses (microenterprises) and relies and an inquiry on the small businesses in
the very poor urban districts inside the country elaborated by the Ministry of Development.
We tried to identify the formal involutive activities and the evolutionary informal activities. Level of
income, productivity, investment, modalities of trade are the criteria of differentiation between the
evolutionary intermediate sector characterized by positive marginal labour productivity, unlimited labour
supply, a capital-intensive intensity, … This sector can insure the transition towards the modern sector and
can activate a development process of the subsistence sector characterized by the absence of barriers of
entry, a level of employment determined by the domestic demand of lower goods, the use of tools in the
production process…
1

Introduction générale
Les petits métiers appelés communément ainsi, trouvent leurs sources théoriques dans
l’analyse dualistes (Lewis) ; plus précisément les études pionnières sous-jacentes à l’informal
sector remontent aux premiers travaux de Hart en 1972 (B.I.T). L’auteur dans une
communication présentée à la conférence sur le chômage urbain en Afrique à l’Université de
Sessex, établit la première distinction entre les activités économiques formelles impliquant
l’emploi salarié et celles informelles caractérisant l’auto-emploi.
Par conséquent, à la dichotomie désormais ancienne : secteur moderne secteur
traditionnel. Boecke (1953), Lewis (1954), Fei (1961), Singer (1970), Ranis (1988), a été
substituée l’opposition secteur informel et formel (Hart), secteur structuré et non structuré
(Weeks, Adair), circuits supérieurs et inférieurs (Santos), économie de Bazar et d’entreprise
(Geertz), secteur organisé et non organisé (BIT); activité de transition et activité moderne
(Penouil, Lachaud), petite production marchande, secteur capitaliste (Hugon) économie de
dedans (Balandier) économie populaire urbaine (Bugnicourt)…
Comme il est aisé de le constater, ces concepts se référent à des négations dans la
terminologie; ce qui prouve qu’il ne s’agit pas de définir un objet ou un concept mais de délimiter
des frontières à l’intérieur desquelles certaines notions et analyses ne sont plus opératoires
(Charmes).
Il importe de noter que la démarche poursuivie est à la fois empirique et intuitive, on
procède par élimination pour délimiter les frontières floues de l’informel; celui-ci se présente
comme un fourre-tout, font partie du secteur non structuré toutes les activités agricoles,
industrielles et commerciales qui ne sont pas saisies dans le cadre classique de la statistique et de
la comptabilité nationale. Force est de constater qu’en adoptant cette définition, on se trouve en
présence d’une très grande hétérogénéité des activités concernées (Charmes).
Quoiqu’il en soit, un débat théorique s’est instauré concernant la délimitation et la
définition du secteur non structuré, l’objet de ce travail s’intéresse plutôt aux modalités
d’utilisation des petits métiers informels en tant que facteurs de développement.
Le secteur non structuré a vu son importance croître au fil de l’application progressive des plans
d’ajustement et de stabilisation structurels. Ces programmes d’inspiration néoclassique libérale
veulent faire émerger des acteurs innovants du secteur non structuré et principalement la petite
activité productive évolutive.
2

Cette approche qui relève des théories libérales apporte une conception assez nuancée du
dualisme et admet l’existence de liens et d’échange entre les sphères formelle et informelle.
L’analyse en terme d’absolus opposés doit laisser la place à une vision selon laquelle il existerait
un continuum de situations possibles entre le formel et l’informel. La transition par graduation
pour arriver au développement, semble répondre à un schéma du modèle de croissance par étape
(Rostow). Partant de ce constat certains auteurs (Lachaud) ont pu distinguer parmi les micro-
entreprises des activités de subsistances et de survie appelées involutives et des activités
porteuses d’accumulations nommées évolutives. Dans ces conditions il ne s’agit plus de
supprimer le secteur informel mais d’identifier les micro-entreprises porteuses d’accumulation et
génératrices de productivité et de revenu.
L’émergence de ces activités est de nature à compenser le manque de dynamisme du
secteur moderne dans la création d’emplois, la distribution de revenus et l’accroissement de la
valeur ajoutée des PED.
Là aussi, une polémique s’est instaurée concernant l’intervention (ou la non intervention)
dans la promotion des activités informelles .Certains auteurs admettent que les équilibres dans le
secteur informel sont très fragiles et que toute intervention ne fait que fragiliser davantage ces
équilibres (Penouil). Certains auteurs prônent pour une déréglementation et l'arbitrage du marché
(Desoto…); le recours excessif à la réglementation entraîne des coûts exorbitants de
formalisation, l'application de la loi de l'offre et de la demande est de nature à mieux stimuler la
micro-entreprise. Par conséquent le seul obstacle au développement de ces micro-entreprises
serait la mauvaise intervention de l’Etat (bureaucratie, législation contraignante…)
D’autres auteurs font du secteur informel un levier du développement socio-économique
(B.I.T). Ils sont favorables à une meilleure intervention de l'Etat. La récession des années quatre
vingt a stimulé l’intérêt porté pour les petits métiers qui apparaissent progressivement comme
une solution alternative pour une population active jeune et dynamique à la recherche souvent
d’un premier emploi. La vision négative de ces activités informelles, signe de sous-
développement, a été remplacée par une optique volontariste de développement. Il importe
d’analyser les modalités de cette intervention et les conditions de son succès à travers l’exemple
tunisien.
3

1/ La dynamique de développement par les petits métiers informels.
1-1/ Le développement par le bas
Depuis une décennie, la Tunisie a adopté une nouvelle conception de développement et
une nouvelle vision de l’expansion régionale, de l’aménagement du territoire et une refonte de la
politique sociale.
Les stratégies de développement qui étaient basées jusque là sur le modèle de
développement de l’import-substitution et la valorisation des ressources locales ont laissé la place
à une nouvelle politique de promotion des exportations et l’encouragement de l’initiative privée
ayant pour toile de fond les petits métiers informels
Ce faisant, la Tunisie a favorisé une économie tournée vers l’extérieur renforcée par
l'adoption d’une politique de développement volontariste appropriée de nature à replacer le pays
dans sa tradition commerciale historique et à le concilier à sa géographie et à la nature même de
son économie, dont les liens avec le reste du monde sont très forts. La mise en application des
accords d’association, Tunisie – Union Européenne et les accords avec l’OMC, la réorientation
de la politique touristique… sont autant d’indicateurs de cette ouverture irréversible sur
l’extérieur. Ainsi, pour atteindre l’ensemble de ces objectifs l’Etat tunisien s’est attelé à
encourager non seulement la petite et la moyenne entreprise mais surtout la micro entreprise; il a
mis en œuvre un ensemble d'instrument qui est de nature à favoriser le développement par le bas.
Plusieurs raisons expliquent ces mutations et ces évolutions dans la conception et la stratégie de
développement tunisien.
Tout d’abord, l’on a pu observer qu’en Tunisie la quasi-totalité du tissu des entreprises est
constituée par des micro-entreprises, sur 358216 entreprises recensées (au 31-12 1996) selon
l’Institut National de la Statistique, l’on a pu constater que 350797 ont moins de dix employés.
Cette atomisation prononcée du tissu des activités économiques est encore plus manifeste quand
on observe que prés de 82% de l’ensemble des unités est constitué par des indépendants, environ
13% par des entreprises de moins de trois salariés, prés de 2% d’entre elles emploient de trois à
cinq salariés.
De surcroît, les micro entreprises en Tunisie sont en général créatrices d’emplois et de
valeurs ajoutées; à cet égard il importe de noter qu’une évaluation approximative de la part de
l’emploi réalisée à partir d’un recoupement des différentes sources statistiques et notamment le
dernier Recensement Général de la Population de 1994 et l’enquête population emploi de 1997
4

montrent que la part de l’emploi des micro entreprises se situent autour de 25% de l’emploi
global en Tunisie. Selon Charmes l’emploi dans le secteur informel représente plus de 50% de
l’emploi non agricole (emploi urbain). D’autre part, les indicateurs globaux d’activité tirés des
comptes de la nation présentés pour la période 1983-1995 confirment cette importance
économique de la micro entreprise.
Elles réalisent plus de 30% de la production du pays environ 37% de la valeur ajoutée,
prés du tiers du PNB, sont à l’origine de prés de 50% des revenus de l’ensemble des ménages et
distribuent plus de 15% des rémunérations salariales. L’ensemble des indicateurs signalent une
évolution régulièrement croissante depuis le début des années quatre-vingt, ainsi l’investissement
des micro-entreprises a continuellement progressé, il est passé de 140 MD en 1983 à 361 MD
Tunisien en 1995, il a constitué au cours de cette période une proportion de 8 à 10% de la FBCF
réalisé par l’ensemble des agents économiques.
D’autres enseignements peuvent être mis en exergue à partir de ces statistiques. Tout
d’abord la régularité de l’investissement dans les micro entreprises alors que le reste des
entreprises non financières ont plutôt un comportement irrégulier avec une baisse durant la
période 1985-1988 puis une forte reprise au cours de la période 1992-1994 ….Ensuite, une
utilisation rationnelle et plus économe en capital et probablement plus efficace dans l’usage des
autres inputs.
La micro entreprise tunisienne constitue un élément déterminant de la croissance
économique. Elle est une grande utilisatrice de la main d’œuvre. Enfin, la comparaison des
indicateurs de productivité moyenne de travail (valeur ajoutée rapportée à l’emploi montre des
performances meilleurs de la micro entreprise par rapport à l’ensemble de l’économie).
Celle-ci s’adapte parfaitement au nouveau contexte de mondialisation et de globalisation.
Ensuite, le libéralisme économique et le développement socio-économique ne peuvent triompher
sans la promotion de la micro-entreprise. Celle-ci prolifère et se multiplie dans ce qu’on a nommé
communément «secteur non structuré». Celui-ci a émergé suite aux difficultés rencontrées par le
secteur moderne dans l’absorption de l’excèdent de la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée
dans les PED. De surcroît, le secteur moderne utilise des techniques intensives en capital souvent
importées, ce qui est de nature à aggraver le déséquilibre macro-économique au niveau de la
balance des paiements, au niveau du marché de l’emploi, au niveau de marché de change etc. La
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%