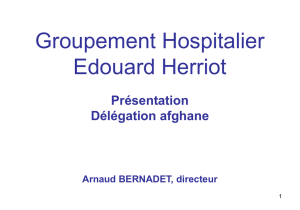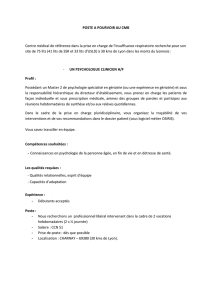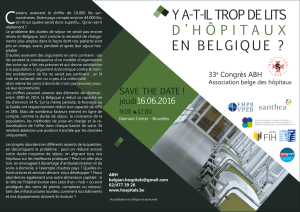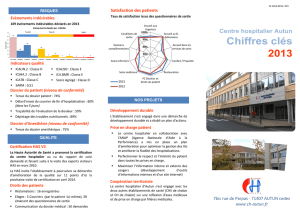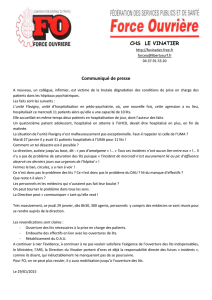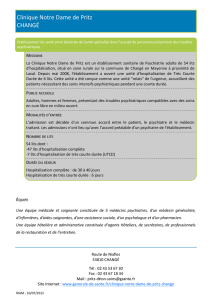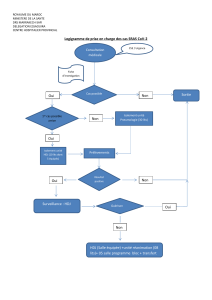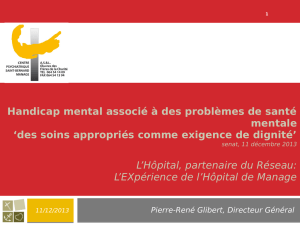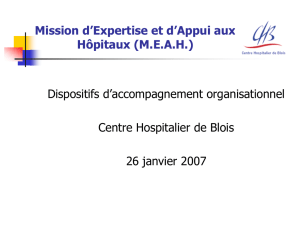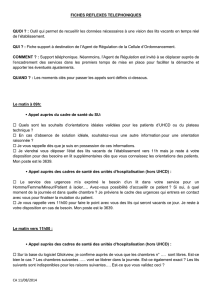59cb0a883dc2ed958c67..

6 >
Sham Repères n°07 - OCT/NOV. 13
raisonnables ? L’hôpital doit s’organiser pour
leur apporter des soins de qualité le plus ra-
pidement possible.
Certains de nos sociétaires ont déjà réussi à
mettre en place un système de gestion des
lits centralisée. Le Centre Hospitalier Régio-
nal de Metz-Thionville et le Groupe Hospi-
talier Paris St-Joseph ont, par exemple, dé-
ployé deux dispositifs très différents : l’un axé
sur la gestion de l’aval et l’autre sur la ges-
tion globale des flux de patients, Urgences
incluses. Ils témoignent pour Sham Repères.
FRANCIS VENCHIARUTTI, CADRE SUPÉRIEUR
DE SANTÉ EN CHARGE DU PÔLE URGENCES
ET MAGALIE SCHERER, CADRE DE SANTÉ
AFFECTÉE À LA GESTION DES LITS
AU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
DE METZ-THIONVILLE, NOUS FONT
PARTAGER LEUR RETOUR D’EXPÉRIENCE
SIX MOIS APRÈS LA MISE EN PLACE
D’UNE STRUCTURE DE COORDINATION ET
DE GESTION DES LITS.
La naissance du projet
de gestion des lits
Au cours de l’hiver 2012-2013, l’hôpital a
été confronté à une véritable situation de
crise due à une saturation permanente des
UN VÉRITABLE ENJEU POUR
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
20 min
pour trouver un lit
pour un malade
4 h 30
LA GESTION
DES LITS
EN HÔPITAL
En 2010, plus de 17 millions de per-
sonnes franchissaient la porte
d’une structure d’urgence en France
(source : ladepeche.fr). L’encombrement des
Urgences est aujourd’hui devenu une préoc-
cupation nationale. Un rapport a d’ailleurs
été remis au ministère de la santé par le Pro-
fesseur Pierre Carli, Président du Conseil
National de l’Urgence Hospitalière (CNUH),
en septembre dernier, pour proposer des
recommandations de bonnes pratiques faci-
litant l’hospitalisation des patients en prove-
nance des services d’Urgences.
En effet, dans la plupart des 600 hôpitaux
français, la problématique des Urgences est
une question quotidienne pour les équipes :
comment gérer « l’après-Urgences » pour
les personnes qui doivent être hospitali-
sées ? Aujourd’hui, les hôpitaux sont satu-
rés et il est très difficile de trouver un lit
pour les nouveaux patients. Les urgentistes
passent jus
qu’à 20 minutes pour trouver
un lit pour un malade, et les patients peuvent
attendre en moyenne jusqu’à 4 h 30 (source :
AFP) avant d’être pris en charge aux Ur-
gences. Ce constat est un facteur de risque
important à la fois pour les patients - une
attente importante provoque l’augmentation
de la morbi-mortalité, ainsi que l’allonge-
ment de la durée des séjours à l’hôpital - et
pour les urgentistes qui travaillent sous ten-
sions permanentes - la moitié de leur temps
est consacrée à des tâches administratives,
prises sur le temps à passer auprès des
patients.
Comment hospitaliser si nécessaire les
consultants des Urgences, dans un secteur
adapté à leur pathologie et dans des délais
DOSSIER
SPÉCIAL
En 2010, plus de 17 millions
de personnes franchissaient
la porte d’une structure
d’urgence en France
Les patients peuvent
attendre en moyenne
jusqu’à 4 h 30 avant d’être
pris en charge aux Urgences
+ 17 M

Sham Repères n°07 - JAN./FÉV. 14
< 7
CARTE D’IDENTITÉ
DU CENTRE
HOSPITALIER
RÉGIONAL DE
METZ-THIONVILLE
CHIFFRES 2013
8 SITES (Hôpitaux de Mercy,
Hayange, Bel-Air, Beauregard,
Félix Maréchal, EHPAD
Le Parc, EHPAD St Jean
et HAD polyvalente)
2031 LITS ET PLACES
ACTIVITÉS : Médecine,
EHPAD, Chirurgie, SSR,
Gynécologie-Obstétrique,
Psychiatrie, USLD et HAD
LES URGENCES :
550 000 affaires/an traitées
par le Centre 15
115 000 passages/an
(Urgences adultes,
pédiatriques et gynéco-
obstétriques), soit en
moyenne 150 passages/jour
sur les sites de Bel-Air
et Mercy
Temps moyen d’attente par
passage : 3 h 30 sur le site
de Mercy et 4 h 40 sur le site
de Bel-Air
Taux d’hospitalisation après
passage aux Urgences : entre
25 et 27 %
Ce taux monte à 40 % pour la
tranche d’âge des 75 ans et +
L’ÉQUIPE
Infirmier en plein travail
de recherche de lit.
Urgences. L’engorgement du service a gé-
néré des temps de prise en charge extrê-
mement longs, « un patient pouvait attendre
jusqu’à 20 h sur un brancard ». L’ensemble
de la communauté hospitalière était dépassé
par les événements. Tous les hôpitaux de
la région ont été confrontés à cette problé-
matique sur la même période. Cette situa-
tion inacceptable a fait l’objet de mesures
d’Urgences - mise en place d’une cellule de
crise « déclaration de l’hôpital en tension » -
et a été le facteur déclenchant de la mise en
place d’un système de gestion des lits au sein
de l’établissement.
La mise en œuvre de la démarche
L’analyse de la gravité de la situation a
montré que ce n’était plus uniquement
« l’affaire » des urgentistes, des cadres de
permanence et du directeur d’astreinte. Il
y a eu une prise de conscience collective :
des médecins et des soignants de tous les
secteurs, du Président de la Commission
Médicale d’Établissement (CME) et de la
Direction. Un projet s’est donc construit, pi-
loté par la coordination générale des soins,
soutenu par la Direction générale du CHR, le
Pôle des Urgences, le président de CME et les
chefs de service, afin d’améliorer le flux des
patients aux Urgences. Ce projet a démarré
en mars 2013, les actions ont été consolidées
jusqu’en juin et, depuis novembre, l’établis-
sement est dans la phase de fonctionnement.
Le plan d’action a été déployé
autour de 7 axes :
1. La mise en place d’une cellule d’ordon-
nancement avec une feuille de route
2. La mise en place d’une structure centrali-
sée de coordination et de gestion des lits
3. Le développement d’outils de pilotage
4. La réflexion sur la programmation des
hospitalisations et révision du règlement
des admissions programmées et non
programmées
5. La réduction des temps d’accès aux pla-
teaux techniques (essentiellement en ima-
gerie non conventionnelle dans l’objectif
de réduire la durée moyenne de séjour)
6. L’organisation et l’anticipation de la sortie
des patients (dont l’organisation de la sor-
tie avant midi)
7. Le développement et le renfort de la
coordination médico-soignante au sein
des services avec notamment la mise
en place de réunions hebdomadaires
pluridisciplinaires

Sham Repères n°07 - OCT/NOV. 13
8 >
Création et fonctionnement
de la structure de coordination
de gestion des lits
Objectif de cette structure : avoir une vision
d’ensemble des lits sur les différents sites
et en optimiser la gestion.
« Un lit ne doit pas rester vacant s’il y a des
besoins . »
Le premier travail a permis d’identifier des
personnes ressources pour intégrer cette
nouvelle structure. Des fiches de postes ont
été définies. En parallèle, une charte de fonc-
tionnement interne a été établie pour décrire
l’unité et les missions des différents acteurs.
De nombreuses communications internes
sur le projet ont été réalisées, dont le règle-
ment intérieur des admissions programmées
et non programmées, présenté notamment
en CME.
La structure de coordination et de gestion
des lits fonctionne aujourd’hui 7j/7 : de 8 h
à 21 h 30 du lundi au vendredi et de 11 h à
18 h 30 le week-end. Les cadres ou infirmiers
référents de nuit poursuivent la mission de
coordination pour permettre une perma-
nence la nuit.
L’équipe dédiée est composée de trois infir-
mières issues des différents sites du CHR
et de spécialités différentes, ce qui permet
d’avoir une bonne connaissance de l’en-
semble du fonctionnement interne, ainsi que
de Magalie Scherer, cadre de santé à temps
plein.
Dès 8 h, l’infirmière du matin prend connais-
sance de l’activité, en consultant les rapports
de nuit quotidiens, et des patients toujours
présents aux services d’Urgences. Elle fait
un point sur les lits qui vont être disponibles
dans la journée afin d’établir vers midi un état
des lieux précis. Le système informatique
n’étant pas encore complètement opération-
nel, la vision transversale des lits disponibles
est basée sur le déclaratif des services des
sites de l’hôpital, ainsi que sur différentes
requêtes et extractions de plusieurs logiciels
(données croisées quotidiennement). « Nous
pouvons passer plus de 100 appels télépho-
niques dans la matinée pour arriver à dres-
ser l’état des lieux ».
L’infirmière de l’après-midi prend ensuite le
relais de 14 h à 21 h 30 et fait le lien avec le
cadre de nuit. Elle dresse un second état des
lieux entre 16 h et 18 h. « Au fil de la journée,
nous recherchons des lits pour les demandes
arrivant en temps réel du service des Ur-
gences ». L’enjeu est d’arriver à trouver la
place la plus appropriée au patient en fonc-
tion de sa pathologie. Un suivi des patients
en hébergement dans des services hôtes est
effectué par la cellule de coordination et de
gestion des lits afin d’organiser la fluidité du
parcours des patients. Objectif : « trouver
le bon lit pour le bon patient dans les meil-
leurs délais ».
Retour d’expérience à 6 mois
Cela fait maintenant un peu plus de six mois
que la cellule de coordination et de gestion
des lits est en place. Même s’il semble dif-
ficile de dresser un bilan précis, Francis
Venchiarutti et Magalie Scherer constatent
des changements positifs et des points
d’amélioration.
Les plus
Une prise de conscience de l’ensemble
des unités de soins
De nouveaux réflexes facilement adoptés
par les équipes et aujourd’hui devenus
quotidiens
Une meilleure coopération et mobilisation
des services
La réduction significative du temps de
passage aux Urgences
Un meilleur suivi des motifs de transfert
QUELQUES INDICATEURS DE SUIVI
LE TAUX DE SORTIE AVANT MIDI
Cet indicateur est très important pour les gestionnaires de lits dans
le cadre de leur activité au quotidien. Début 2013, ce taux était aux
alentours de 2 à 3 %. Aujourd’hui, il se stabilise à 60 %. « Notre
objectif pour l’année 2014 est de tendre vers 80 % .»
LE NOMBRE DE TRANSFERT
Avant la mise en place de la structure de coordination, nous
enregistrions plus de 4000 transferts de patients vers d’autres
établissements de la région. Nous avons affiné le suivi et les motifs
de transfert. Aujourd’hui, les patients restent pour la plupart au CHR.
LES INDICATEURS D’ALERTE
Des seuils d’alerte ont été mis en place : le nombre de personnes
en attente d’hospitalisation à 8 h et le nombre de personnes devant
entrer en hospitalisation à 16 h.
100
« Nous pouvons passer plus de
100 appels téléphoniques dans la
matinée pour arriver à dresser
l’état des lieux »

Sham Repères n°07 - JAN./FÉV. 14
< 9
Les axes de progrès
La mise en place d’un système
informatique centralisé de gestion des lits
pour faciliter la visibilité en temps réel
du statut des lits
L’articulation entre les lits programmés
et non programmés
La fluidification des parcours en MCO
L’amélioration de la traçabilité et du suivi
de tous les patients de leur entrée
à leur sortie
« Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans une
bonne dynamique du changement et parmi
nos projets 2014, nous envisageons la refonte
de l’organisation des Urgences sur le site
de Bel-Air à Thionville. D’autre part, nous
intervenons activement dans le développe-
ment du plan d’actions "Hôpital en tension"
mené avec l’ARS Lorraine » conclu Francis
Venchiarutti.
ATIKA ALAMI, DIRECTRICE DU PARCOURS
PATIENT ET CHEF DE PROJET GESTION
DES LITS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS
ST-JOSEPH, UN ÉTABLISSEMENT PILOTE
EN FRANCE, NOUS EXPLIQUE COMMENT
S’EST DÉROULÉE LA MISE EN PLACE D’UNE
GESTION CENTRALISÉE DE L’ENSEMBLE
DES LITS DE L’ÉTABLISSEMENT.
La mise en place de la gestion des lits a été
initiée en avril 2011. « Nous avons été accom-
pagnés par l’ANAP (Agence Nationale d’Appui
à la Performance des établissements de
santé et médico-sociaux) dans le cadre des
Projets Performance. »
Objectif : « remettre la gestion des lits
au cœur de l’activité de l’hôpital »
Pour :
améliorer la qualité et la satisfaction
du patient (accueil, délai de prise
en charge, flux de patients)
améliorer la satisfaction
des professionnels de santé (réduire
le temps passé à la gestion des lits
et diminuer les tensions dans les équipes)
améliorer l’efficience et la maîtrise
de l’activité en optimisant les ressources
Le projet a été porté par la Direction qui l’a
présenté comme un projet institutionnel
impliquant l’ensemble de la communauté
hospitalière pour conduire un véritable chan-
gement organisationnel. « En tant que chef
de projet, j’ai piloté sa mise en œuvre en
lien avec des équipes projets composées de
tous les acteurs du parcours patient (res-
ponsables de flux, chefs de pôle, cadres de
santé, infirmières, urgentistes, DSI…) et d’un
consultant en organisation. Nous avons ainsi
pu analyser chaque étape du circuit : admis-
sion programmée ou en provenance des
Urgences, occupation des lits, gestions des
entrées et préparation des sorties, etc. ».
CARTE D’IDENTITÉ
DU GROUPE
HOSPITALIER
PARIS ST-JOSEPH
CHIFFRES 2012
Établissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif issu
en 2006, du rapprochement
de trois hôpitaux du sud
parisien : Saint-Joseph,
Notre-Dame de Bon Secours
et Saint-Michel, ainsi que de
l’Institut de formation en soins
infirmiers (IFSI).
613 LITS ET PLACES
36 507 passages aux
Urgences
100 à 130 passages/jour
Temps de passage moyen
(de l’entrée à l’hospitalisation
du patient) : 5 à 6 h
Temps réduit à 3 ou 4 h
lorsque le patient repart chez
lui après son passage aux
Urgences
Taux d’hospitalisation après
passage aux Urgences : entre
25 et 27 %
L’ÉQUIPE
Atika ALAMI, Directrice parcours patient,
chef de projet gestion des lits entourée
des 4 gestionnaires de lits du groupe
hospitalier Paris Saint-Joseph.

Sham Repères n°07 - OCT/NOV. 13
10 >
Au démarrage, un audit interne a été effectué
sur une période de 6 mois. Il a permis de faire
un diagnostic complet sur les processus et
les flux de patients, soulevant par exemple :
un temps d’attente aux Urgences
allant jusqu’à 6 h avant d’être admis
dans un service
de nombreux transferts de patients
faute de visibilité sur les places encore
disponibles
une gestion des lits par unité de soins très
hétérogène, provoquant un coût et une
perte de temps notable pour les cadres
de santé
113 heures/jour utilisées pour la gestion
des lits, soit l’équivalence de treize
personnes à temps plein
plus de 10 interventions déprogrammées/
mois altérant la qualité du service
L’analyse a également montré que :
les pics d’activités étaient dus au flux
de patients programmés
le flux des Urgences était relativement
stable avec en moyenne un besoin
de 30 lits chaque jour
chaque soir, 20 à 40 lits étaient vides
À partir de ce constat, il est apparu néces-
saire de centraliser la gestion des lits de
l’hôpital en y dédiant une équipe, chargée
de coordonner l’ensemble des mouvements
de patients, veiller à la prévision de l’activité
et arbitrer des décisions d’affectation des
patients en faisant le lien avec les chefs de
services et les cadres de santé. Le métier de
gestionnaire de lits est né de cette réflexion.
« Nous avons donc imaginé un dispositif de
gestion prévisionnelle des entrées et des
sorties (GPES) sur l’ensemble de l’hôpital ».
Le chantier a démarré par le Pôle chirurgie.
Ont ensuite suivi : le Pôle maternité/gynéco-
logie en juillet 2011, le Pôle cardiovasculaire
en novembre 2011 et le Pôle médical en mars
2012.
Chaque Pôle a ainsi travaillé sur ses spé-
cificités et ses règles d’hospitalisation.
Ainsi, la planification d’une hospitalisation
en dehors du service concerné ne peut être
réalisée sans respecter ces règles strictes.
Par exemple, un patient dont l’opération est
programmée pour une laryngectomie totale
sera admis exclusivement dans le service
d’ORL afin de lui garantir toute la prise en
charge spécifique : éducation, soins de tra-
chéotomie, etc. En revanche, un patient pro-
grammé pour une thyroïdectomie et dont
l’hospitalisation est prévue en ORL, pourra
être finalement admis en chirurgie digestive
en cas d’indisponibilité de lit en ORL. « Grâce
à ce système plus souple d’allocation des lits
par secteurs, nous pouvons ainsi hospitaliser
plus vite les patients provenant des Urgences
(25 % du flux) tout en ne déprogrammant
plus les autres hospitalisations prévues (75 %
du flux). »
Aujourd’hui, quatre gestionnaires de lits
à temps plein s’occupent de cette tâche.
Ces personnes sont des secrétaires mé-
dicales ou des agents d’administration,
issues des différents Pôles de l’hôpital. Elles
connaissent donc déjà très bien le parcours
patient et les circuits de prise en charge dans
l’établissement.
Focus sur le quotidien
d’un gestionnaire de lits
Dès 8 h 30, le gestionnaire de lits commence
la journée en faisant un point avec le staff
médical des Urgences pour recueillir les be-
soins d’aval et évaluer les flux de la journée.
Tout au long de la journée, il s’occupe de
mettre à jour en temps réel tous les mou-
vements - entrées, sorties, mutations des
unités de soins continus ou réanimations,
transferts des hôpitaux de jour en cas de
complications - en fonction des différentes
données obtenues par fax ou téléphone.
Dès le début d’après-midi, il affecte les pa-
tients prévus pour les deux jours à venir dans
un lit identifié, selon les règles d’héberge-
ment, afin d’anticiper l’activité des services.
Il envoie si besoin des alertes aux cadres de
santé, chefs de service, coordonnateurs de
Pôle ainsi qu’à la responsable de la gestion
des flux, en cas de saturation ou de sous-
occupation des lits dans les différents Pôles
et Spécialités.
En parallèle, les équipes médicales font un
point quotidien sur l’activité, les effectifs
et les lits. A l’issue de cette visite médicale
un plan de travail est transmis aux gestion-
naires de lits.
En fin de journée, le gestionnaire de lits
adresse un mail aux cadres de nuit, signalant
les lits vacants disponibles et ceux vacants
mais réservés pour les entrées de 8 h le
lendemain.
Vers 6 h 30, les agents d’admission de nuit
signalent en retour la liste des patients hos-
pitalisés pendant la nuit avec leur numéro de
chambre et le motif d’hospitalisation.
Quelques exemples de difficultés
rencontrées
La résistance au changement :
« Lors du lancement du Pôle pilote, nous
avons été confrontés à une résistance forte
de la part de certains cadres qui se sont
vu retirer la gestion des lits ». Un travail a
donc été réalisé avec les équipes pour leur
permettre de se recentrer sur leur cœur de
métier. De plus, une conduite du changement
a été menée tout au long du projet et pendant
sa mise en place, au cœur des services pour
expliquer et mobiliser.
 6
6
1
/
6
100%