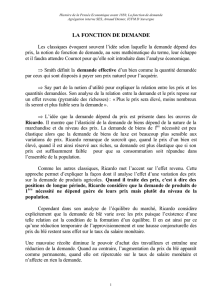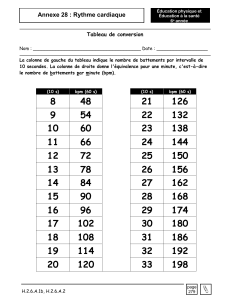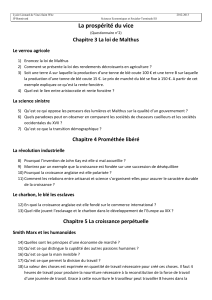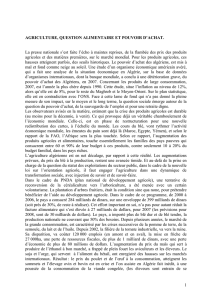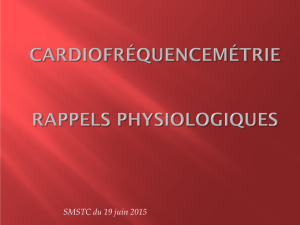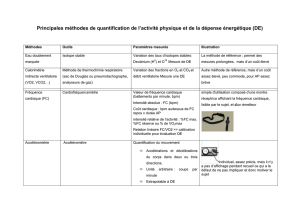Les lois économiques doivent-elles s`appliquer aux

Cahiers d’économie et sociologie rurales,n° 79, 2006
Les lois économiques
doivent-elles s’appliquer
aux biens de subsistance?
Alain CLÉMENT

10
Alain CLÉMENT *
Should economiclaws apply to subsistencegoods?
Summary –While many very generallaws exist in economics (Malthus’s law, the law of supply and demand,
Engel’s law,etc.) attesting that the scientificcharacter of the discipline,‘vital resources’fall intoacategory of
their ownand are recognised as such. This has led to the creation of knowledge and specificlaws that arenot
applicable and not transposable toother areas of economics (e.g. the King-Davenant law). Some economists have
even proposed to transfer ‘vital resources’becauseof their specificcharacter from the domain of economics toanother
disciplinary,moraland politicaldomain,morein relation withour way to think the role of subsistencegoods in
the history of humanity.Thereby they opened the way and provided justification for other types of (normative)
‘man-made’ laws and for rules and norms.It is then easier to understand why,even in today economicdebates, we
talk of the ‘agriculturalexception’.
Key-words :economiclaws,norms, rules,agriculturalexception
Les lois économiques doivent-elles s’appliquer aux biens de subsistance?
Résumé –S’il existedenombreuses lois très générales en économie (loi de Malthus,loi de l’offreet de la
demande,loi d’Engel,…) qui témoignent du caractère scientifiquedeladiscipline,«les vivres »
constituent unchamp spécifique, reconnu comme tel,quidébouche sur laformation d’un savoir et de
lois particulières,non applicables,non transposables àd’autres champs de l’économie (loi de
King-Davenant,par exemple). Dans le passé, uncertain nombred’économistes ont même proposéque
«les vivres » sortent du champ de l’économie,en raison de cette spécificité,et rejoignent unautre
champ disciplinaire,moralet politique,plus conforme àl’idée quenous nous faisons du rôle des
subsistances dans l’histoiredel’humanité. Ils ont ainsiouvert la voie et lajustification àd’autres types
de lois (normatives)àdes règles et des normes édictées par les hommes.Oncomprend mieux pourquoi,
aujourd’huiencore,on parle «d’exception agricole »dans les débats économiques.
Mots-clés :lois économiques,normes, règles,exception agricole
*
UniversitéFrançois Rabelais,UFR de droit,d’économie et des sciences sociales,50 avenueJeanPortalis,
BP 0607, 37206 Tours cedex 03 et UMR 5206 Triangle CNRS-Lyon 2-ENS
e-mail :clement@univ-tours.fr

11
ARCE QU’ ELLE touche à unbesoin vitaldel’homme,laquestion des vivres a
occupé une placeprivilégiéedansla théorie économique, tout du moins jusqu’au
milieu du XIXe siècle,période àpartir de laquelle lacontraintepopulation/ressources
alimentaires sedesserra très progressivement.Ledéfi auquel la théorie économique
naissanteétaitconfrontée étaitceluidel’élaborationde solutions quidevaient
satisfairel’objectif premier du peuple,«manger à safaim », sans pour autant
négliger les intérêts économiques des producteurs de ces mêmes biens de subsistance.
Le traitement de laquestion des vivres ouvrait ainsila voie àl’émergenceet à
l’élaborationd’un savoiréconomiqueet de lois économiques 1 .Cependant,la
singularitéet la spécificitédu fait alimentaire, très souvent reconnuescomme telles,
ne risquaient-elles pas de conduireàlaformation d’un savoiret de lois spécifiques
non applicables et non transposables àd’autres champs de l’économie ?Pouvait-on
alors parler de véritables lois économiques quand celles-cine relevaient qued’un
champ particulier ?Nefallait-il pas plutôt remettreencausecette spécificitépour
fairedes vivres unbien économiquecomme unautre,auquel cas des lois
économiques plus générales pouvaient s’appliquer ?Ou,comme le proposaient
certains auteurs,fallait-il maintenirles subsistances hors du champ de l’économie en
raison de cette spécificité?Car,derrièrecetteinterrogation,dès lafin du XVII e siècle
et au fur et àmesurequele savoiréconomiquedevenait autonome, seposait la
question du véritable champ d’appartenancedu fait alimentaire. Pouvait-il ou devait-
il relever du champ autonomedel’économie en formation ?Ou devait-il relever et
rester,en raison de sa spécificité,dans unautrechamp disciplinaire,plus conforme à
l’idéequel’on sefaisait du rôle (moralet politique,en particulier)des subsistances
dansl’histoiredel’humanité2et ouvrir ainsila voie et lajustification àd’autres types
de lois (plus normatives,par exemple),c’est-à-direàdes règles et àdes normes
édictées par les hommes ?Dans cecas,une absencepartielle ou totale d’application
des lois économiques généralesau domaine des subsistances pouvait alors être
justifiée. En relatant une histoiredelapensée économique sur laquestion des
subsistances depuis lapériode mercantiliste(XVI e siècle)jusqu’auXIXe siècle en
Franceet en Grande-Bretagne,on assistebien àlaformulationdecedouble discours :
undiscours,progressivement dominant, sur l’émancipation de l’économie en
1La loi telle qu’elle est définie chez les économistes possède généralement deux significations :
laloi normativequiest souvent une prescription,uncommandement,et laloi positivequi
établit des relations universelles entredes événements,déduites de conditions initiales.Plus
précisément,en économie,cequedoit décrirelaloi positiveest l’enchaînement d’une série
d’actions d’individus au sein d’ungroupe quiamène certaines conséquences prévisibles,car la
scienceéconomiqueest avant tout une sciencedel’action humaine et de sacoordination,
cf. Postel (2003). Comme le noteBlaug(1980),par ailleurs,l’histoiredel’économie abonde en
lois économiques positives :loi de Gresham,loi de Say,loi de l’offreet lademande,loi des
rendements décroissants,pour n’en citer quequelques-unes.
2Ainsi,Max Weber (1923 [1991])expliquequelacouverturedes besoins alimentaires par le
biais du marché capitalisteest très récentedans l’histoiredel’humanité. Polanyi(1957 [1976])
fait également remarquer que,dans toutes les sociétés dites primitivesetantiques,les
transactions lucratives concernant les produits alimentaires sont totalement bannies.Même s’il
notel’existencedemarchés céréaliers plus nombreux dès le XVIe siècle en Europe,leur
réglementationest particulièrement sévèrejusqu’au XIXe siècle (Polanyi,1944 [1983]).
P

A.CLÉMENT
12
général3et de l’économie des subsistances en particulier,avecélaboration de lois
économiques générales,mais aussidelois spécifiques,et undiscours récurrent de
résistanceenvers l’intégration des vivres dans le champ de l’économie pure. Ce
dernier courant,qualifié de courant d’économie morale 4 , s’attache àmaintenir les
vivres dans le champ plus normatif de lamorale et de lapolitique.
Les mercantilistes établirent progressivement des règles et des principes,présentés
le plus souvent comme des conseils aux responsables politiques en charge de ces
questions,afin de répondreaux problèmes induits par l’existencedepénuries
agricoles et alimentaires récurrentes.Cen’est qu’au cours du XVIIIe siècle quel’on
tentad’introduirel’existencede«contraintes »économiques,puis d’élaborer de
véritables lois économiques universelles dont l’intérêt était de donner des indications
plus générales quant aux politiques àmettreenplacepour répondreaux besoins
premiers du peuple. Mais cette volontéde vouloir émanciper la scienceéconomique
d’uncertain nombredenormes et de règles morales,plus particulièrement dans ce
domaine-là, fut vivement critiquée par unpuissant courant d’économie morale. Le
débat seprolongeaen Angleterreavecl’opposition Smith/Steuart et confirmala tenue
d’undouble discours quiallait connaître son apothéose,puis une retombée,dans la
premièremoitié du XIXe siècle,aveclaquestion des cornlaws.
Des règles plus quedeslois,ou l’administrationdel’abondance
chez les mercantilistes
Avecles mercantilistes de lapériode XVIe-XVIIe siècles,avant quel’on puisse
parler de lois économiques,des règles ont étéforgées,largement défendues par les
grands auteurs de l’époque,dont laplus importantedans cedomaine était lanécessité
du pain àbon marché. Ilne s’agissait pas de loi,mais d’une obligation impérieusequi
s’imposait à tous.Leblé était unbien quidevait intégrer une contraintemajeure,celle
du prix,àpartir de laquelle découlaient des contraintes connexes (contraintes de
déplacement,contraintes de stockage,contraintes sur les transactions). Cette règle
allait induire uncertain nombredemesures,de politiques et de lois,au sens juridique
du terme. EnAngleterre,en particulier,les cornlaws furent conçues pour limiter les
exportations et éviter les pénuries et les spéculations àlahausse sur les prix.S’il existait
une loi,c’était avant tout laloi de lanécessité,laloi du besoin. Les vivres avaient
d’emblée un statut àpart et relevaient du champ politique.
Delaloi du besoin aux règles normatives :abondanceet «bon marché »
Bodin soulignale premier les méfaits de lachertédes produits,et
particulièrement des céréales :«Ilfaut quelepeuple viveàbon marché »(1568-
1578[1986], tome 6,p. 432). Cet objectif était partagé par Richelieu et par
Louis XIII car,comme le rapporteleCardinal,«le Roy désirequel’assemblée luidonne
advis des moyens qu’il y ad’établir unordrepour queles grains soient toujours à unprix si
3Sur cepoint,cf. Vidonne,1986.
4Pour reprendrel’expression de Thompson,1971[1989].

13
LES LOIS ÉCONOMIQUES DOIVENT-ELLES S’APPLIQUER AUX BIENS DE SUBSISTANCE ?
raisonnable quelepauvrepeuple puisse vivre sans les grandes incommodités qu’il aquelquefois
souffertes»(Richelieu,1624-1626 [1975], tome 1,p. 587). Les céréales étaient
considérées comme des «biens communs » sur lesquels la sociétéavait des droits et,
en saqualitédegardienne des biens de lacommunauté,lapolice se tenait prêteà
faire respecter ces droits,plus d’ailleurs en fonction de lapaix sociale quedelajustice
sociale. Leprix, sans pour autant être unprix administré, unprix politique,devait
rester soumis àdes impératifs autres que strictement marchands.L’objectif était
d’encadrer le marché et de ne pas laisser fluctuer les prix de façon incontrôlée.
Enplus de cettecontraintequipesait sur les prix,il existait unprincipe de secours.Le
Roi avait pour devoir d’assurer l’existencedes citoyens et de pourvoir àleur subsistance.
Bodin (1576-1593 [1986], tome 6,p. 42)évoquaet défendit le premier cetteobligation
morale des rois qui«doivent,laRépubliqueet leur maison entretenues,garder le surplus pour la
nécessitépublique». Montchrestien (1615 [1889], p. 18),autremercantilistedecette
période, rendait le Roi «responsable de l’entretien et du bon fonctionnement de son pays ». En
Angleterre,Mun,commerçant de profession,adoptades positions identiques.Ilparla
aussidu rôle nourricier du Princequiest «l’estomac de l’homme et, s’il cessed’alimenter les
autres parties du corps,non seulement il les altère,mais il sedétruit aussilui-même »(Mun,1664
[1965], p. 68). Cependant,l’État ne pouvait qu’êtrefournisseur en dernier ressort et
n’intervenait qu’en cas d’urgenceou de danger imminent.
Des règlesaux politiques
Compte tenu de ces obligations,des règles sont apparues d’autant plus nécessaires
queles observateurs et le peuple avaient laforteconviction quelaformation des prix
agricoles était largement tributairedecomportements humains cupides,d’ententes
frauduleuses de lapart des intervenants principaux qu’étaient les marchands nationaux
et étrangers.
La production et ladistribution des vivres étaient donc soumises à une loi
générale :celle du besoin. Cette règle du «bon marché dans l’abondance» était
d’autant plus impérieusequ’elle s’inscrivait en accordavec une opinion publique
imprégnée par l’idée d’uncomplot des marchands contrelepeuple. Ilexistait une
hostilitégénérale àl’égarddes marchands qui,par leurs ententes et leurs mouvements
spéculatifs,orientaient les prix àlahausse. Eneffet, selon Bodin,l’action concertée des
marchands et des monopoles,en contribuant àleur enrichissement personnel au
détriment des consommateurs,était causedelachertédes blés et du préjudiceportéau
peuple. Dans cecontexte,le droit des pouvoirs publics de taxer les denrées,
notamment en cas de disettes,en imposant unprix plafond n’est pas mis en doute.
Sans remettreenquestion le droit de propriété,on admettait quelecommercedes blés
était une sortede servicepublicet que salibertédevait êtrelimitée par l’exigenced’un
prix àlaportée des pauvres.L’analysedéveloppée aux XVIeet XVIIe siècles soumettait
le droit de propriétéau droit d’acheter le blé à unbon prix 5 .
5Cf .Hont I.and Ignatieff M.(1983). Needs and justicein the wealthofnations:An
introductory essay,in:Wealthand Virtue:The Shaping of PoliticalEconomy in the ScottishEnlightenment,
Hont I.and Ignatieff M.(editors),Cambridge,Cambridge University Press,pp. 29et s.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%