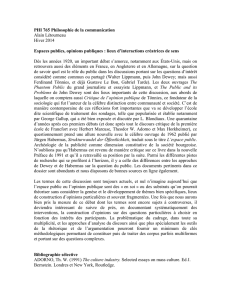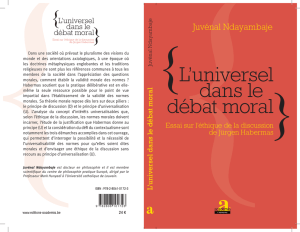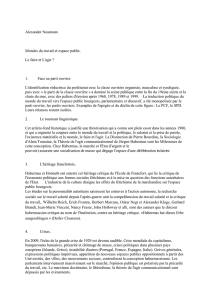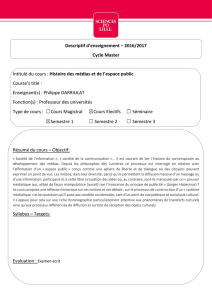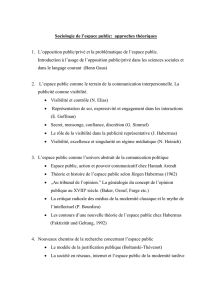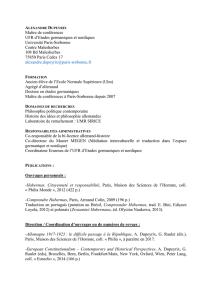semiologie de l`image mediatique chez habermas

1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique
MEMOIRE
Présenté pour l’obtention du diplôme du
MAGISTER EN PHILOSOPHIE
Spécialité : Philosophie du langage
Présenté par : Sous la direction du
Professeur. Dr :
Leïla TENNCI Mohamed MOULFI
Membres du jury :
Président : M. Pr. ZAOUI El Hocine, Professeur, Université d’Oran.
Rapporteur : M. Pr. MOULFI Mohamed, Professeur, Université d’Oran.
Examinateur : M. Dr. SOUARIT Ben Ameur, Maître de conférence-A-,
Université d’Oran.
Examinateur : M.Dr.ABDELLAOUI Abdallah, Maître de conférence-A-,
Université d’Oran.
Année universitaire 2011-2012
UNIVERSITE D’ORAN
Faculté des Sciences Sociales
Département de Philosophie
SEMIOLOGIE DE L'IMAGE
MEDIATIQUE
CHEZ HABERMAS

2
A la mémoire de ma mère
20 ans déjà !

3
REMERCIEMENTS
En réalité, beaucoup ont contribué de prés ou de loin, à l’élaboration
de ce travail. L’énumération de tous est chose impossible, tant la liste
serait longue.
- Tout d’abord, je ne remercierai jamais assez mon directeur de
recherche, le professeur Moulfi Mohamed, pour ses
encouragements, ses conseils, sa compréhension et sa patience face
à mes énormes faiblesses durant toutes ces années. D’avoir été
même avant le magister mon guide intellectuel et de rester mon
maître et mon premier modèle.
- Je n’oublierai pas Mr. Zaoui Hocine, chef du projet de philosophie
du langage dans lequel j’effectue ce magister ainsi que Mr. Saïm
Abdelhakim pour son amitié.
- Sans oublier le département de philosophie et tout son personnel.
- Mr. Mebtoul Mohamed directeur du G.R.A.S. d’avoir ouvert ses
portes sociologiques à une étudiante en philosophie.
- Le CDES d’être mon refuge, Bernard Janicot mon compagnon de
route.
- Jeanne et Claire de m'offrir sans cesse un espace de travail.
- Je remercie messieurs les membres de jury d’avoir accepter
d’examiner ce mémoire.
- Enfin, ma famille d’avoir tout supporté.
L.T

4
TABLE DE MATIERES
Introduction 1
PREMIERE PARTIE
SEMIOLOGIE DE L’IMAGE MEDIATIQUE
Chapitre I
L’image médiatique
1. Genèse de l’image 8
2. L’image dans l’histoire de la philosophie 14
3. Qu’est ce qu’une image médiatique ? 33
4. Roland Barthes et l’image médiatique 34
Chapitre II
Sémiologie de l’image médiatique
1. Qu’est ce que la sémiologie ? 37
2. Qu’est ce que le signe ? 39
3. Histoire de la sémiologie 40
4. Les fonctions de l’image 54
SECONDE PARTIE
LA COMMUNICATION CHEZ JURGEN HABERMAS
Chapitre III
Habermas, un classique vivant.
1. La communication chez Habermas 60
2. Communication et coopération 64
3. L’espace public chez Habermas 67

5
Chapitre IV
La sphère publique chez Habermas
1. Définition de la sphère publique 72
2. Sphère publique et représentation 74
3. La sphère du pouvoir public 76
Chapitre V
La presse chez Habermas
1. Naissance de la presse 78
2. Opinion publique 80
Chapitre VI
La publicité chez Habermas
1. Le principe de publicité chez Habermas 83
2. De la culture discutée à la culture consommée 88
3. D’une culture consommée à une consommation
médiatique 90
Chapitre VII
L’image médiatique chez Habermas
1. D’une presse littéraire aux mass media 96
2. La naissance de l’image médiatique 98
Conclusion. 100
Bibliographie. 103
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
1
/
116
100%