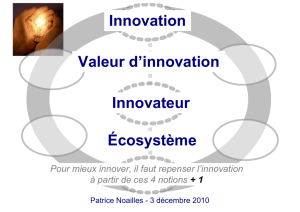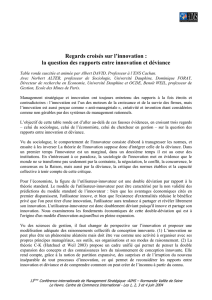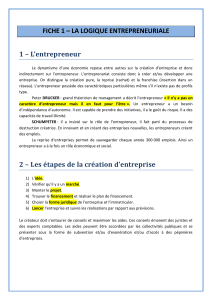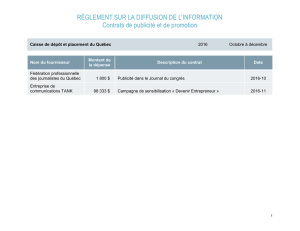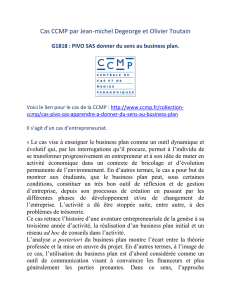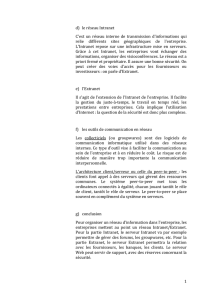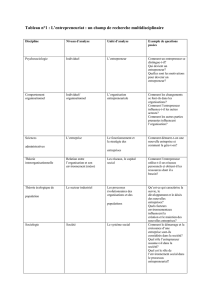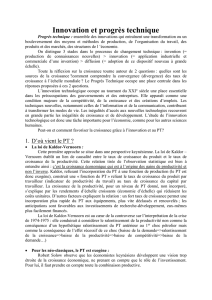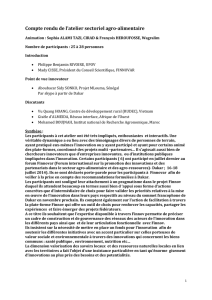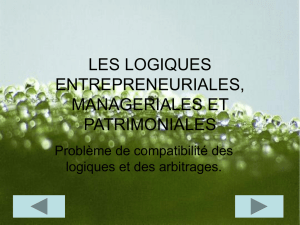Table des matières - Forum Européen des Politiques d`Innovation

De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
1
De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
2
7
Table des matières
Remerciements.....................................................................................11
Préface ..................................................................................................13
Jean-Hervé Lorenzi
Présentation Générale .........................................................................17
Sophie Boutillier, Faridah Djellal, Dimitri Uzunidis
PREMIÈRE PARTIE
STRATÉGIES ENTREPRENEURIALES D’INNOVATION
Le système 1 « Parva sed apta » : l’innovativité de la TPE..............29
Michel Marchesnay
Innovation et entrepreneur : points de repère théoriques ...............63
Sophie Boutillier
De l’entrepreneur à l’innovateur
dans une économie dynamique...........................................................85
Patrice Noailles-Siméon
Entrepreneuriat social et l’innovation sociale comme
facteurs fédérateurs du système national d’innovation..................111
Laurice Alexandre-Leclair
Le management de l’innovation
dans les modèles de gouvernance de l’entreprise............................129
Yvon Pesqueux
Origine, fonctionnement et gouvernance de l’innovation
multi-partenariale : une lecture néo-institutionnaliste...................143
Blandine Laperche, Fabienne Picard, Nejla Yacoub
L’innovation par les outils d’hybridation
des approches
Technology Push
et
Market Pull
.............................175
Florin Paun, Hugues-Arnaud Mayer

De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
3
8
DEUXIÈME PARTIE
POLITIQUES D’INNOVATION ET RÔLE DES INSTITUTIONS
Le système national d’innovation et la policy mix
de l’innovation en France : une revue historique ...........................195
Zeting Liu
Garantie, financement, innovation :
le rôle d’OSEO auprès des PME......................................................219
Annie Geay
L’intervention de CDC Entreprises
dans les PME innovantes : la place du capital investissement ......227
Frédérique Savel
Un petit retour sur l’innovation et sur la place
que doit/peut avoir le CNRS dans son développement...................233
Jean-Claude André
De l’invention technique à l’innovation sociale :
quel rôle et responsabilité de la recherche
dans l’accompagnement du changement ? ......................................251
Sophia Alami, Danièle Clavel,
Camille Maffezzoli, Benoît Bertrand
Les enjeux de l’innovation participative
au ministère de la Défense.................................................................271
Jean-Luc Masset, Bruno Lassalle
Systémique locale d’innovation : proximité et entrepreneuriat ....289
Dimitri Uzunidis
De la réindustrialisation des espaces aux espaces
de la réindustrialisation. Quelques enseignements
des politiques de soutien à l’industrie de la Région Picardie.........309
Slim Thabet
Les nouveaux territoires de l’innovation
et de l’économie de la connaissance :
le cas de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle...................................351
Jacques Grangé
De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
4
9
TROISIÈME PARTIE
FUTURES TRAJECTOIRES D’INNOVATION
L’innovation introuvable ..................................................................369
Laurent Lemire
Les futures ruptures scientifiques
seront-elles à l’origine d’innovations ? ............................................375
Pierre Papon
La prospective des innovations : le recours à la systémique..........395
Smaïl Aït-El-Hadj
Croissance ou développement ?
L’ambigüité de la notion de « réformes structurelles »..................411
Gabriel Colletis
Les réseaux d’innovation public-privé dans les services................419
Faridah Djellal, Faïz Gallouj
Modèles d’innovation dans l’économie de la fonctionnalité ..........439
Ingrid Vaileanu, Johan van Niel
Mais pourquoi parle-t-on d’économie verte ?.................................459
Sylvain Allemand
Que nous réservent les innovations vertes ?
État des lieux et éléments de prospective.........................................477
Marc-Hubert Depret
TEMOIGNAGES
ENTRETIENS RÉALISÉS PAR INGRID VAILEANU-PAUN ET FLORIN PAUN
Dompter la finance pour innover : Pier Carlo Padoan ................... 503
Les atouts de la coopération : Jean-Paul Delevoye .......................... 507
Territoire entrepreneurial : Christian Pierret.................................. 511
Éloge de la complexité : Isabelle Laudier.......................................... 517
Notices biographiques .......................................................................523

De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
5
De l'entrepreneur à l'innovateur dans
une économie dynamique
Patrice Noailles-Siméon
Université d’Evry
RRI
Seillans Investissement
! pour ICEI - Innovations. Cahiers d’économie de l’innovation - 2013
RESUME / ABSTRACT
De l'entrepreneur à l'innovateur dans une économie dynamique
L’innovateur est la fonction manquante de l’économie dynamique. Elle complète la
fonction d’entrepreneur et crée le lien principal entre l’environnement et l’innovation.
De 1755 à 1921, de Cantillon à Knight en passant par JB Say, la science
économique a progressivement distingué l’entrepreneur de l’investisseur capitaliste
en soulignant ses fonctions d’organisation, de gestion de l’incertitude et du risque. Le
terme d’innovateur apparaît au XX° siècle avec une double filiation d’inventeur et
d’entrepreneur, mais sa définition n’est pas approfondie et le rapprochement effectué
par Schumpeter entre l’innovateur et l’entrepreneur entraîne une confusion qui dure
encore.
Notre objectif est de montrer la possibilité et la nécessité de distinguer les
concepts d’entrepreneur et d’innovateur pour mieux rendre compte de la réalité de
l’innovation.
Cette séparation des concepts d’entrepreneur et d’innovateur se fonde sur la
différence de nature de l’apport économique de chacun d’entre eux : l’innovateur
développe un nouveau paradigme social plus efficace que le précédent, tandis que
l’entrepreneur s’efforce de maîtriser et d’optimiser les paradigmes préexistants pour
faire face à l’aléa de la vie économique. Ce nouveau concept réorganise la vision du
processus innovant et modifie ainsi la capacité d’intervention des différents acteurs.
Cet article est divisé en quatre parties :
I - L’innovateur jusqu’à ce jour : Un rappel historique sur la lente émergence du
concept d’innovateur à partir de l’entrepreneur et de l’inventeur.
II – La fonction d’innovateur(N) : l’innovateur(N) est celui qui définit le standard
technique et le modèle économique de l’innovation.
III – L’environnement de l’innovateur(N) : Le cadre d’action de l’innovateur(N) est son
écosystème dans lequel il évolue de façon non mécanique et imprévisible. Son
habitat naturel est l’entreprise innovante.
IV – Les innovateurs(N) dans la réalité économique sont les acteurs généralement
peu connus du changement.
L’ensemble de cet article a d’abord été conçu pour des innovateurs réalisant des
innovations de rupture, c’est-à-dire avec une très forte rente technique qui se traduit
par une baisse des coûts d’un facteur 10. Mais nous verrons que l’ensemble
s’applique aussi aux innovations plus modestes, notamment incrémentales.
De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
6
From entrepreneur to innovator in dynamic economics
Innovator is the missing function or dynamic economics. It balances the
entrepreneur function and establishes relationship between environment and
innovation.
From 1755 to 1921, from Cantillon to Knight, through JB Say, economics gradually
distinguished entrepreneur and investor by pointing to organization function, risk and
uncertainty management.
Innovator emerged in the XX° century with dual origin as inventor and
entrepreneur. But it’s definition has not been completed so that the confusion
between entrepreneur and innovator is still running.
This chapter aims to show that we can and have to separate the two concepts of
innovator and entrepreneur to better understand the realty of innovation.
This partition between entrepreneur and innovator is based on the differences of
the nature of their economic contribution : innovator develops a new social and
economic paradigm with an increased efficiency as the entrepreneur try to manage
risk and uncertainty for optimizing previous paradigms. The new concept turns the
vision of innovation process and modifies the working capacity of people.
This chapter is divided in four parts :
I – Innovator until now : a short story of the slow emergence of the innovator
concept from entrepreneur and inventor.
II – Innovator function : the innovator defines the technical standards and the
business model of the innovation.
III – Innovator environment : Innovator has a tool (the innovative company) and an
ecosystem where he works.
IV – In economic life, innovators are the secret agents and drivers of change.
This chapter was written for breakthrough innovators but this is also valuable for
incremental innovators.
Codes JEL : L26, O31, O32, O33, O38
Mots clés : innovator, entrepreneur, inventor, entreprise, innovation, R&D,
diffusion

De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
7
De l'entrepreneur à l'innovateur dans une économie dynamique
L’innovateur est la fonction manquante de l’économie dynamique. Elle complète la
fonction d’entrepreneur et crée le lien principal entre l’environnement et l’innovation.
De 1755 à 1921, de Cantillon à Knight en passant par JB Say, la science
économique a progressivement distingué l’entrepreneur de l’investisseur capitaliste
en soulignant ses fonctions d’organisation, de gestion de l’incertitude et du risque. Le
terme d’innovateur apparaît au XX° siècle avec une double filiation d’inventeur et
d’entrepreneur, mais sa définition n’est pas approfondie et le rapprochement effectué
par Schumpeter entre l’innovateur et l’entrepreneur entraîne une confusion qui dure
encore.
Notre objectif est de montrer la possibilité et la nécessité de distinguer les
concepts d’entrepreneur et d’innovateur pour mieux rendre compte de la réalité de
l’innovation.
Cette séparation des concepts d’entrepreneur et d’innovateur se fonde sur la
différence de nature de l’apport économique de chacun d’entre eux : l’innovateur
développe un nouveau paradigme social plus efficace que le précédent, tandis que
l’entrepreneur s’efforce de maîtriser et d’optimiser les paradigmes préexistants pour
faire face à l’aléa de la vie économique. Ce nouveau concept réorganise la vision du
processus innovant et modifie ainsi la capacité d’intervention des différents acteurs.
Cet article1 est divisé en quatre parties :
I - L’innovateur jusqu’à ce jour
II – La fonction d’innovateur(N)
III – L’environnement de l’innovateur(N)
IV – Les innovateurs(N) dans la réalité économique
Notation pour cet article :
1 - Pour bien distinguer le terme classique d’innovateur du concept que nous
voulons définir et pour souligner la nouveauté du concept, nous avons noté ce
dernier par un N sous forme d’exposant ou avec un tiret : innovateur(N), ou
innovateur(N).
2 – L’ensemble de cet article a d’abord été conçu pour des innovateurs réalisant
des innovations de rupture, c’est-à-dire avec une très forte rente technique qui se
traduit par une baisse des coûts d’un facteur 10. Mais nous verrons que l’ensemble
s’applique aussi aux innovations plus modestes, notamment incrémentales.
I – L’innovateur jusqu’à ce jour
Les innovateurs, au sens que nous allons donner à ce terme, ont existé bien avant
que le concept ne soit utilisé. Schumpeter lui-même n’utilise pas le terme
d’innovateur et peu celui d’innovation. On doit distinguer deux périodes : avant et
après l’apparition du concept moderne d’innovation au XX° siècle qui va conduire à
confondre la fonction d’innovateur avec celle d’entrepreneur.
1 Cet article doit beaucoup à la relecture critique de Laurent Larry Guyot-Sionnest
2 En fait, les capitaines des galères commerciales.
3 Des règles similaires existaient déjà à Carthage et chez les phéniciens.
4 Dans ce chapitre, l’innovation est le développement d’un nouveau paradigme social ayant une efficacité
économique accrue et durable.
5 Thurston (1878)
6 Dans son Traité d’économie politique, il emploie le terme entrepreneur plus de 110 fois.
De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
8
1 - L’innovateur avant l’innovation
Avant le concept moderne d’innovation (XX°), le terme d’innovateur n’est pas
utilisé. Pourtant, on en trouve de nombreux exemples cachés sous le nom
d’inventeur au départ, puis d’entrepreneur.
a - Les innovateurs - inventeurs avant l’existence du concept d’entrepreneur :
Les premiers innovateurs au sens européen du terme, ont une activité brillante. Ils
apparaissent comme étant simultanément inventeurs et entrepreneurs comme.
Gutenberg et Watt établissent le modèle d’innovation européen.
! Baumol, Landes et Mokyr (2010) ont donné une perspective multimillénaire à
l’entrepreneuriat occidental puisqu’ils font remonter le phénomène à la naissance de
notre civilisation, en Mésopotamie. Il apparaît d’ailleurs que ce concept n’est pas
propre à l’Occident. Plus proches de nous, les entrepreneurs vénitiens2 ont
développé un corpus juridique et économique étonnant, allant jusqu’à utiliser des
règles de partage de bénéfices3 proches du capital-risque. C’est ainsi que la part du
capitaine dans les bénéfices d’une navigation commerciale était de l’ordre de 25% du
seul fait de sa fonction. La première définition de l’entrepreneur est donnée dans la
2° moitié du XVIII° siècle par Cantillon et Turgot.
En trois siècles, de 1450 à 1770, et deux grandes étapes, l’Europe invente un
modèle d’innovation sans précédent dans l’histoire et sans équivalent dans le monde
: un innovateur, un partenaire financier et une entreprise innovante utilisant au mieux
les connaissances scientifiques de l’époque. Ce modèle global est visible dans deux
innovations de rupture : l’imprimerie qui établit le modèle global et la machine à
vapeur qui complète le modèle par une proximité de la R&D.
! En 1450, Gutenberg crée la première entreprise innovante. On connaît mal
l’activité inventive de Gutenberg, mais on connaît mieux son innovation : il a défini un
standard d’impression qui durera jusqu’à la fin du XVIII° siècle (impression recto-
verso avec une presse manuelle et des caractères mobiles réutilisables) et aussi un
modèle économique d’édition qui a duré jusqu’à la fin du XX° siècle avec l’apparition
combinée du Web et des systèmes d’imprimante personnelle. On ignore
généralement qu’il est l’initiateur du modèle du processus d’innovation4 occidentale :
une entreprise innovante, animée par un innovateur–entrepreneur et financée par un
investisseur de type capital-risque. Pour compléter le modèle, les délais seront
dépassés, le prix multiplié par 2 ou 3 et les associés se sépareront, provoquant ainsi
leurs ruines mutuelles.
! En 1770, Black, Watt et Boulton utilisent la R&D5. Watt était un assistant
(manipulateur) à l’Université de Glasgow. Il eut à réparer une machine à vapeur de
démonstration de Newcomen (1710) et confronta ses remarques sur la forte
consommation énergétique avec les réflexions de son associé, Joseph Black,
Universitaire, découvreur et spécialiste de la chaleur latente de condensation. On
peut penser que le dialogue entre le scientifique, l’inventeur et leur associé
entrepreneur n’a rien à envier aux processus modernes d’innovation associant des
2 En fait, les capitaines des galères commerciales.
3 Des règles similaires existaient déjà à Carthage et chez les phéniciens.
4 Dans ce chapitre, l’innovation est le développement d’un nouveau paradigme social ayant une efficacité
économique accrue et durable.
5 Thurston (1878)

De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
9
scientifiques, des techniciens et des hommes de marketing. Boulton est celui qui
s’occupait de la fabrication (avec Watt) et de la commercialisation. A ce titre, il fut
l’inventeur d’un modèle économique étonnamment moderne puisqu’il s’agissait de
vendre un service et non la machine. A bien des égards, l’histoire de Black, Watt et
Boulton est un exemple d’innovation incrémentale de quasi-rupture dans une
économie de marché. C’est aussi un bon exemple du modèle linéaire : « science !
invention ! innovation ».
b - Les innovateurs cachés par l’entrepreneur
Dans le langage courant de l’époque, les innovateurs dont nous venons de parler
sont des inventeurs et parfois ) à partir du XVIII°, des entrepreneurs comme c’est le
cas de Boulton. Ces deux termes, notamment celui d’entrepreneur vont durablement
cacher la fonction d’innovateur.
La définition des fonctions de l’entrepreneur est réalisée progressivement par la
séparation des concepts de capitaliste et d’entrepreneur au XVIII° puis le
développement des notions de maîtrise du risque et d’organisation.
JB Say (1803) accorde une large place6 à « l’entrepreneur d'industrie, celui qui
entreprend de créer pour son compte, à son profit et à ses risques, un produit
quelconque.” Il est le premier à mettre l’accent sur la fonction d’organisation de
l’entrepreneur, en des termes plus modernes que ne le faisait Turgot. Il établit ainsi
clairement la distinction des fonctions d’entrepreneur et de capitaliste.
Dans le même temps, Cantillon (1755) met en lumière la notion de risque pris et
maîtrisé par l’entrepreneur, mais elle n’a reçu sa pleine mesure qu’avec Knight en
1921. L’entrepreneur décide en univers incertain et réagit à des problèmes
imprévisibles et parfois inconnus.
2 - L’émergence de l’innovateur au XX° siècle
Les grands entrepreneurs -et pour certains, innovateurs- de la fin du XIX° et du
début du XX°, jusqu’à la première guerre mondiale ont servi de référence à la
réflexion de Schumpeter, de Knight et de Coase. Ils ont pour nom : Daimler ou
Peugeot, Kuhlmann ou Bayer, les frères Wright ou Blériot, Ford ou Panhard, Edison
ou Branly. Leurs légendes, souvent amplifiées et entretenues à dessin, en fait des
personnages incontournables de la vie économique et conduisent les économistes à
approfondir la question de l’entrepreneur et de la R&D.
Pendant la première moitié du XX° siècle, le terme d’innovation prend son sens
moderne et celui d’innovateur fait une apparition progressive.
a - L’innovateur, concept naissant du XX° siècle
Deux approches complémentaires sont développées pendant la première moitié
du XX° siècle : d’un côté les théoriciens « traditionnels » finalisent une approche
globale de la fonction d’entrepreneur comme un rouage de l’économie de marché.
De l’autre côté Schumpeter qui développe une vision révolutionnaire d’un
entrepreneur-innovateur.
! Schumpeter (1911) a une claire définition de l’entreprise qui est très proche
d’une entreprise innovante : « Nous appelons « entreprise » l'exécution de nouvelles
combinaisons et également ses réalisations dans des exploitations, etc., et
entrepreneurs, les agents économiques dont la fonction est d'exécuter de nouvelles
6 Dans son Traité d’économie politique, il emploie le terme entrepreneur plus de 110 fois.
De l’entrepreneur à l’innovateur dans une économie dynamique
10
combinaisons et qui en sont l'élément actif. » Dans son ouvrage de 1911, il distingue
(inutilement ?) cinq catégories d’innovation avant d’arriver à une définition globale de
l’innovation dans son livre Business Cycles (1939) : « une modification de la fonction
de production » ; il oublie néanmoins de préciser « dans le sens d’une meilleure
efficacité », ce qui peut sembler naturel, mais ne va pas forcément de soi. Il oublie
aussi de l’étendre au domaine non marchand.
Schumpeter tente d’établir une restriction dans la définition de l’entrepreneur et
d’en limiter l’usage aux seuls entrepreneurs-innovateurs. Mais il provoque surtout
une confusion entre les deux termes dont nous ne sommes pas encore sortis. A
certains égards, le présent chapitre est une clarification du vocabulaire employé par
Schumpeter.
! Dans le même temps, Coase (1937) synthétise l’ensemble des approches
classiques dans son article sur la « Nature de la firme » en affirmant que « dans un
système concurrentiel, l’entrepreneur est celui qui se substitue au mécanisme des
prix pour l’allocation des ressources. » Cela rassemble bien l’ensemble des fonctions
détaillées par ses prédécesseurs. La question de l’innovation est ignorée
puisqu’implicitement exogène. Cette définition parfaite permet à son auteur de mettre
en évidence les coûts de transaction et d’accès à l’information puis de justifier dans
la lignée de Knight, le double rôle de l’entrepreneur : maître de l’incertitude et
gestionnaire du risque.
b - La relation entre l’innovation et l’entrepreneur :
Dans la seconde moitié du XX° différentes tentatives sont faites pour définir une
relation entre l’entrepreneur et l’innovation. On peut distinguer deux orientations
générales : une tentative de définir une fonction d’innovateur7 et une transformation
de l’innovation en une simple opportunité pour l’entrepreneur.
! Les tentatives d’ouverture des perspectives conceptuelles sont assez diverses :
Certaines approches systémiques et fonctionnelles de l’innovation mettent en
évidence une fonction entrepreneuriale. Ainsi, Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann et
Smits (2005), considèrent que dans un système d’innovation, les activités
entrepreneuriales constituent la fonction n°1, avant le savoir et la formation. Ce texte
constitue une évolution tardive des approches systémiques qui ont souvent ignoré
l’entrepreneur et simplement fondé leur système sur des moyens matériels et des
structures.
Roberts & Fusfeld (1980) ont défini les étapes du processus d’innovation et ont
mis en évidence plusieurs « rôles » ou fonctions : la génération d’idées,
l’entrepreneuriat (détecter, développer, démontrer une idée technique ou une
approche nouvelle), la conduite de projet, le soutien.
Charles Wessner (2005) a utilisé l’expression “Local Heroes In The Global Village”
qui est très proche de notre concept, mais il n’en a pas donné une définition précise.
Quelques définitions récentes soulignent que l’innovateur est l’homme qui
transforme des idées en objets économiques. Nous sommes d’accord avec cette
définition sous réserve de préciser quelques points sur la durabilité notamment, car
la mode et un marketing à très court terme (de type PLV) ne relèvent pas de
l’innovation.
7 Ce chapitre s’inscrit dans cette tradition
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%