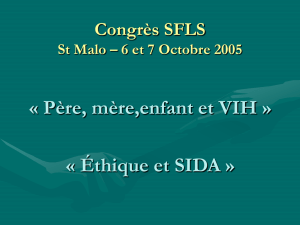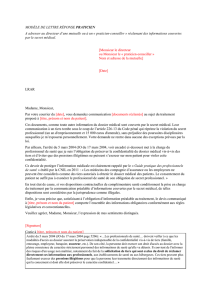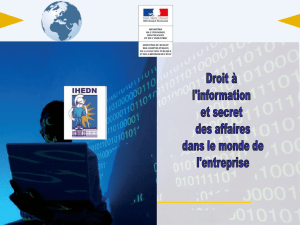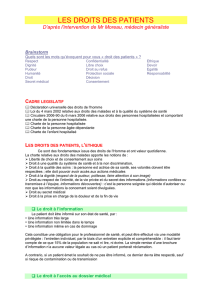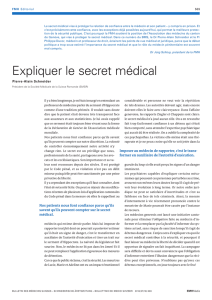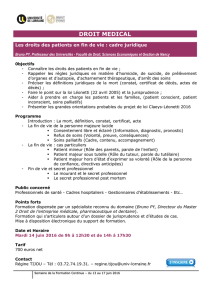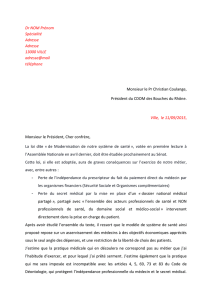Secret professionnel, secret médical et secret partagé : un sujet

Secret professionnel, secret médical
et secret partagé : un sujet sensible
Le secret médical est un sujet
toujours d’actualité. Le
texte fondamental reste la Décla-
ration Universelle des Droits de
l’Homme (1948) : «Tout individu
a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne». Le Code
civil rappelle que : «Chacun a
droit au respect de sa vie privée».
Le Code pénal énonce l’obliga-
tion de secret médical pour les
professionnels de la santé et pré-
voit les sanctions pénales en cas
de manquement à cette obliga-
tion, tandis que le non respect de
la discrétion professionnelle peut
conduire l’agent à de simples
sanctions disciplinaires.
Suivant l’article 226.13 du nou-
veau Code pénal du 1er mars
1994, la révélation d’une infor-
mation à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire,
soit par son état ou par sa pro-
fession, soit en raison d’une
fonction ou d’une mission tem-
poraire, est puni d’un an d’em-
prisonnement et de 100 000 F
d’amende.
Les obligations et les droits des
fonctionnaires ont pour origine
la loi du 13 juillet 1983. Les
obligations se déclinent en trois
grands groupes :
• obligation de servir,
• obligation de dévouement,
• obligation de réserve.
L’obligation de dévouement est
une obligation de morale profes-
sionnelle. Elle impose au fonc-
tionnaire, en particulier, une
obligation de discrétion profes-
sionnelle et de silence.
Le secret professionnel concerne
non seulement les fonctionnaires
ayant une profession soumise au
secret, principalement dans les
domaines de la santé, de la justi-
ce et du social, mais aussi les
fonctionnaires soumis au secret
en raison d’une mission spéci-
fique. Tous les renseignements
confidentiels relatifs aux per-
sonnes sont soumis au respect
du secret professionnel. Il est
ainsi imposé dans l’intérêt des
personnes alors que la discrétion
professionnelle l’est plutôt, dans
l’intérêt de l’administration.
La vigilance s’impose
A l’hôpital, le secret médical, sy-
nonyme de respect de la vie pri-
vée, pose des problèmes spéci-
fiques. L’évolution technique de
la médecine fait que le malade
n’est plus seul devant son méde-
cin. Un nombre important de
professionnels a accès aux dos-
siers médicaux. Des moyens mo-
dernes de communication, tels
l’informatique, l’usage du téléco-
pieur, l’audiovisuel, sont large-
ment utilisés. L’exercice de la mé-
decine en équipe, en réseau a
conduit à introduire en pratique
la notion de secret partagé. Le
patient qui s’adresse à l’hôpital,
est pris en charge par une équipe
de soins, y compris internes et
étudiants. Le secret se partage
avec toutes les personnes don-
nant les soins. Le secret médical
est confié à l’équipe. Mais ce
concept de “secret partagé” n’a
aucune existence juridique.
L’exercice de la médecine en
équipe, utile pour la prise en
charge globale du patient, a
conduit à prolonger cette notion
pratique de secret partagé.
Le secret partagé ne signifie tou-
tefois pas le partage complet,
sans discernement. Les éléments
à transmettre doivent rester ceux
qui sont nécessaires et pertinents
pour les soins du patient. L’auto-
risation du malade est toujours
souhaitable. De façon générale,
chaque professionnel doit se
poser la question avant tout
échange d’informations, du ca-
ractère indispensable ou non de
cette transmission et de l’utilisa-
tion qui en sera faite.
Le partage du secret avec les
proches du patient, indispen-
sable dans le cas d’enfants mi-
neurs ou de majeurs handicapés,
n’est pas obligatoire et ne doit
pas être automatique, et fait sans
discernement. Le malade peut
interdire, en effet, cette révéla-
tion. Quant au dossier médical,
c’est un document privé et confi-
dentiel. Sa transmission ou sa
consultation est utile pour éviter
de refaire des examens complé-
mentaires, par exemple, mais
l’équipe ne doit pas le communi-
quer sur simple demande.
Les risques sont réels
Les menaces auxquelles le secret
médical est exposé sont nom-
breuses. La médecine étant deve-
nue un enjeu de société, cela
pose des questions qui font l’ob-
jet de débats publics (exemples :
sida, toxicomanie, maladie de la
“vache folle”). La société, les mé-
Dans les services de soins, face aux nouveaux moyens
de communication, les professionnels doivent s’inter-
roger sur le partage des informations médicales.
L’importance du secret professionnel et, en particu-
lier le secret médical, explique les nombreux docu-
ments officiels. A méditer pour optimiser les soins.
6

7
INFIRMIER
fessions santé
pro
INFIRMIÈRE
dias, s’intéressent à la santé des
personnalités. Ce sont autant de
sources de risque de violation du
secret professionnel. L’informa-
tion des données de santé trans-
mises et accessibles sur des
cartes à puce peuvent permettre
de mettre en place des précau-
tions plus sûres que les supports
papiers. La consultation de ces
données peut être limitée à cer-
taines personnes disposant d’un
code pour y accéder.
Informatique et libertés
La loi du 6 janvier 1978 relative
“à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés” a permis la création
de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés,
(CNIL) dont la consultation et
l’autorisation sont indispen-
sables avant la constitution de fi-
chiers informatiques portant sur
les personnes. Les données ne
peuvent être enregistrées sans
l’accord de l’intéressé.
Dans un contexte nécessaire de
maîtrise des dépenses de santé,
le recensement des données mé-
dicales à la sortie du patient est
indispensable. Mais, les informa-
tions doivent être rapidement
rendues anonymes.
Le devoir d’information doit
ainsi se marier de façon harmo-
nieuse avec les obligations de se-
cret et de discrétion profession-
nelle. Le nouveau Code pénal a
fait disparaître le verbe “confier”
dans la définition du secret pro-
fessionnel pour introduire la no-
tion “d’information à caractère
confidentiel”.
L’obligation de garder le secret
est générale et absolue. En clair,
pour le secret médical, le secret
couvre tout ce qui est “venu à la
connaissance du médecin, non
seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, entendu
et compris”. Il a un caractère ab-
solu ; nul ne peut affranchir le
médecin de son obligation de se-
cret. Le refus de témoigner en
justice ne peut pas donner lieu à
condamnation.
Mais le nouveau Code pénal et
différents textes réglementaires
ont prévu des exceptions au
principe du secret, fondées sur
un intérêt supérieur à l’intérêt
privé. Le nouveau Code pénal
fait obligation au personnel cou-
vert par le secret de dénoncer,
aux autorités compétentes, toute
violence sur des personnes, ne
pouvant pas se défendre, dont
l’état psychique ou physique est
affaibli, ainsi que toute violence à
mineur de moins de 15 ans.
Par ailleurs, la révélation du se-
cret est permise dans quelques
cas particuliers :
• pour des raisons d’intérêt per-
sonnel, à savoir pour prouver
son innocence. En effet, le droit
de se défendre constitue un fait
justificatif de la violation du se-
cret professionnel, mais les révé-
lations doivent se limiter à l’in-
dispensable,
• avec l’autorisation de l’intéres-
sé, en médecine, c’est du “mala-
de seul que dépend le sort des
secrets qu’il a confié à un méde-
cin”. Mais cela ne légitime pas
pour autant une révélation in-
tempestive (le médecin doit être
prudent car le malade ne sait pas
toujours mesurer les risques de
cette révélation),
• pour dénoncer un crime ou un
délit,
• pour ne pas entraver l’action
de la justice dans le cadre d’une
action engagée devant toute
juridiction, à savoir répondre
obligatoirement aux questions
posées par le juge, délivrer les
documents saisis, témoigner en
justice.
Le principe du secret médical ne
s’applique pas dans la relation
médecin–patient mais ce partage
naturel rencontre parfois des
subtilités. La tendance actuelle
est de ne rien cacher au patient
pour lui permettre de com-
prendre les choix thérapeu-
tiques, d’être un acteur éclairé et
coopérant. Mais il peut toutefois
y avoir des données potentielle-
ment traumatisantes que le mé-
decin va choisir de taire, au
moins temporairement, vu l’état
dans lequel se trouve le patient.
Il est nécessaire que les règles de
secret médical soient inlassable-
ment rappelées aux équipes
concernées, et en particulier aux
étudiants pour le respect de nos
patients. En fait, le nouveau
Code pénal ne consacre pas la
notion de secret partagé, mais
l’autorise.
Le secret professionnel, dans le
cadre du travail en équipe, en
milieu hospitalier, est un sujet
sensible. Réfléchir ensemble sur
le secret partagé et sur le circuit
du dossier médical à l’hôpital est
une démarche améliorant aussi
la qualité de la prise en charge
des patients.
Mireille Malbernard
Cadre infirmier
© Agence Phanie
1
/
2
100%