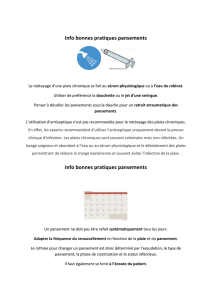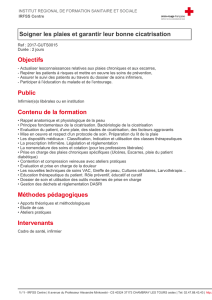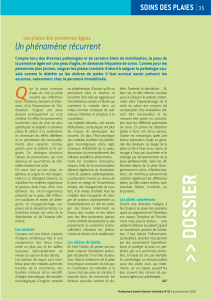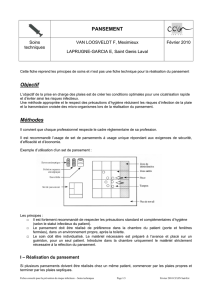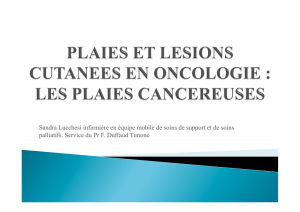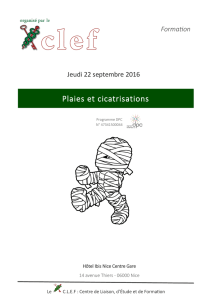Lire l`article complet

17
Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
surinfections locales, l’utilisation d’antiseptiques, le
moment où il est nécessaire de changer de stratégie
font appel à des connaissances plus élaborées. La
plaie est devenue un monde en soi ».
Le traitement des plaies commence par un respect
strict de l’hygiène. Il importe donc de différencier
une plaie propre d’une plaie infectée. Il faut savoir
que même une plaie propre est colonisée par des
germes. Tous ces germes présentent une certaine
utilité dans la réparation et la cicatrisation de la
plaie. Il est donc essentiel de respecter l’écosys-
tème bactérien, d’où l’inutilité d’une stérilisation
d’une plaie chronique propre. En revanche, une
plaie infectée qui montre des signes cliniques par-
ticuliers : abcès, pus, rougeur et chaleur autour de
la plaie, induration, douleur, œdème, etc., néces-
site d’abord la mise en œuvre rapide d’une anti-
biothérapie. Recourir aux antiseptiques dans le
nettoyage des plaies chroniques ne sert à rien si
auparavant il n’y a pas eu une détersion minu-
tieuse de la plaie. Le nettoyage s’effectue en géné-
ral avec de l’eau du robinet associé ou non au sa-
von de Marseille si la plaie est souillée de matières
organiques. Un rinçage minutieux est ensuite fait.
Dans certaines situations, il est possible d’utiliser
de l’eau stérile ou du sérum physiologique. A tous
les stades de la cicatrisation, l’important n’est pas
tant l’absence de stérilité que la contamination. La
première prévention passe donc par le lavage mi-
nutieux des mains qui, dans certains cas, sera
simple, dans d’autres antiseptiques ou encore avec
désinfection. Les techniques de préparation de la
peau pour un traitement de la plaie doivent faire
l’objet d’une coordination de tous les acteurs de
l’équipe soignante.
A.-L.P.
Sommaire
• Cicatrisation :
évaluation et surveillance
• Plaies chroniques :
prévenir l’infection
• Enquête
sur la douleur :
comment éviter
les traumatismes ?
• Ulcères de jambe :
déterminer la cause
• Oncologie :
rendre acceptable
l’insupportable
• Soins aux brûlés :
l’hôpital Cochin innove
Soins des plaies
Un monde en soi
Autrefois, le soin des plaies et des ulcères dépendait
d’une thérapeutique que l’on pourrait aujourd’hui qualifier
de sommaire. Depuis quelques années, les progrès effectués
dans le domaine médical, chirurgical et technique ont permis
de formaliser les soins en s’appuyant sur une gamme
de produits adaptés. La plaie est devenue un monde en soi
où l’on ne doit voyager qu’avec les moyens d’aujourd’hui.
Quelle que soit la plaie, son évolution est tou-
jours identique. La difficulté est de savoir
choisir un soin adapté à un stade et à un type
de plaie, car ce choix dépend des techniques
utilisées, sans cesse en évolution. Ainsi, pour ci-
ter les pansements : les hydrocolloïdes, les hy-
drocellulaires, les hydrogels, les alginates, les
pansements au charbon et les pansements
bioactifs font partie d’un arsenal moderne per-
mettant de récupérer l’intégrité de la peau lésée.
Ces évolutions rapides nécessitent en revanche
une formation et une remise
en question des anciennes
pratiques. Car chaque
soin a son avan-
tage et son incon-
vénient. «Ainsi,
rappelle le Dr
Luc Téot, chirur-
gien au CHU de
Montpellier, la né-
crose doit être détergée,
manuellement ou avec le
soutien de pansements émol-
lients comme les hydrogels,
pour permettre le bourgeonne-
ment, aidé par la plupart
des pansements hydrocol-
loïdes ou hydrocellulai-
res, afin que la plaie
puisse s’épidermiser
spontanément ou
à l’aide de tech-
niques chirurgi-
cales. La prise
en charge des
©L.D.

18
Plaie
Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
Quel que soit leur lieu d’exercice, les équipes de soins partagent le souci
de la cicatrisation des plaies. Malgré cet objectif commun, elles constatent
la rareté d’outils de suivi de l’évolution de la cicatrisation. Le manque
d’information dans ce domaine peut entraîner un défaut de coordination
des équipes, souvent source d’échecs.
Cicatrisation
Évaluation et surveillance
Depuis 1992, la Commission “Escarres” du
CHU de Montpellier mène des actions
transversales pour favoriser la prise en charge
des patients à risques et porteurs d’escarres.
Plus récemment, celle-ci, devenue Commission
“Plaies et cicatrisation”, a travaillé à l’élaboration
d’outils de suivi des plaies. Nous avons interrogé
Sylvie Palmier, IDE référente, coordinatrice du
groupe de travail.
Quelles grilles et quelles fiches utilisez-vous désormais ?
Sylvie Palmier : Dans le domaine de l’escarre, la
stratégie de prévention s’appuie dans un premier
temps sur l’identification précoce des patients à
risque. Plusieurs grilles permettant de “scorer” les
facteurs de risque existants. L’échelle sélectionnée
au CHU de Montpellier depuis 1993 est l’échelle
de Waterlow. Simple à réaliser, elle paraît la plus
adaptée à la population disparate amenée à être
soignée dans l’établissement. Cette échelle fait
partie des protocoles de prévention et traitement
des escarres diffusés dans le CHU. Par ailleurs,
dès 1999, nous avons travaillé pour élaborer une
fiche de suivi de plaie. Une fois réalisée, elle a fait
l’objet de tests et de présentations auprès des
professionnels et au sein de la Commission du
service de soins infirmiers afin d’être validée.
A qui sont destinées ces fiches de suivi des plaies ?
S.P. : Une information sur l’existence de cet ou-
til a été réalisée en avril 2000, accompagnée du
guide d’utilisation. Ainsi, ces fiches sont à dis-
position de toutes les équipes prenant en charge
des plaies à retard de cicatrisation. Cette diffu-
sion s’accompagne d’un important programme
de formation. Par ailleurs, l’évaluation sur la fa-
çon d’utiliser ces documents se poursuit et va
permettre d’apprécier les éventuelles modifica-
tions à y apporter.
Lors de la réalisation du premier pansement, la
fiche doit être remplie par l’infirmière et le mé-
decin prescripteur. Cette évaluation initiale défi-
nit le type de plaie, son ancienneté, ses dimen-
sions, sa localisation reportée sur un schéma du
corps humain, son aspect. En présence de plu-
sieurs plaies, soit elles sont numérotées, soit un
code couleur est utilisé. Ce descriptif de départ
doit être le plus complet possible. Il peut être ac-
compagné d’un calque ou d’une photo.
L’évolution des observations y figure-t-elle aussi ?
S.P. : Bien sûr. Les fiches de pansements propre-
ment dites sont consignées au recto. Ainsi, les in-
firmières transmettent les données concernant la
plaie, la présence ou pas de douleur durant le
soin, les actions réalisées. Le rythme de prise des
dimensions est défini en équipe suivant le type
de plaie. Cela permet des évaluations plus ob-
jectives de la vitesse de cicatrisation. L’ensemble
de ces données est retranscrit à l’aide d’abrévia-
tions et de croix à cocher. Cela favorise la rapi-
dité d’écriture comme la facilité de lecture du
suivi de l’évolution. Les changements de proto-
coles sont listés lors de modifications des pres-
criptions médicales.
Cette évaluation se poursuit-elle jusqu’à la sortie du
malade ?
S.P. : Oui. L’évaluation de la plaie, lors de la sor-
tie du patient, nécessite de reprendre ses dimen-
sions et d’en refaire le descriptif détaillé. Ces ob-
©L.D.

technique ou d’un nouveau produit, un défaut
d’organisation des soins sont parmi des situa-
tions à risque. Un soignant – médecin, chirur-
gien, infirmière – peut “augmenter les facteurs
de risques”, soit par “manque de compétences”,
soit par “non-respect des protocoles”. Le patient
lui-même peut influencer l’évolution de la plaie.
Le matériel
La prévention de l’infection des plaies dépend
aussi de la qualité du matériel. «Cette
servations sont alors jointes au descriptif initial.
Ainsi, un résumé de la prise en charge des soins
locaux peut être jointe à la fiche de liaison.
Dans quels services cet outil est-il utilisé ?
S.P. : Il l’est dans toutes les unités du CHU en
fonction des besoins. Mais les services l’utilisant
le plus sont ceux de dermatologie, d’endocrino-
logie et de gériatrie.
Que se passe-t-il quand le patient quitte l’hôpital ?
S. P. : Nous sommes en train de tester un carnet
de suivi de plaies. Conçu à partir de la fiche de
suivi des plaies, il doit permettre aux soignants,
en ville, de poursuivre cette évaluation et la sur-
veillance de ces plaies. Outre le suivi des soins
locaux, on retrouvera sur ce document les coor-
données des infirmiers, médecins libéraux et
hospitaliers prenant en charge le patient. En cou-
verture, un arc décisionnel du choix thérapeu-
tique peut aider à guider les prescripteurs. L’ob-
jectif final de ces outils de liaison, c’est de faciliter
les échanges entre professionnels, afin d’amélio-
rer la prise en charge des patients. Les moyens
de l’informatique pourront, dans un proche ave-
nir, faciliter cette communication. Mais ce sont
les compétences et la volonté de chacun d’entre
nous qui feront en sorte que la richesse de ces
échanges soit au profit de la qualité de vie des pa-
tients porteurs de plaies.
Propos recueillis par
Marc Blin
19
●●●
Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
Plaies chroniques
Prévenir l’infection
Le but de toute démarche de soins est d’éviter la
contamination, souligne Francine Rumeaux,
cadre infirmier supérieur expert au CHU de
Montpellier. Les facteurs de risque sont de trois
ordres : la plaie elle-même, l’environnement, le com-
portement des personnes. »
Le premier critère concerne la définition des dif-
férents types de plaies et leurs facteurs de risques :
plaie franche ou plaie avec perte de substance,
plaie propre ou plaie souillée. Lors de plaies chro-
niques, qu’il s’agisse d’ulcères ou d’escarres, la
présence d’un exsudat, de tissus nécrosés, d’un
hématome constitue un milieu de colonisation.
Le second critère est pour l’environnement ma-
tériel immédiat et les facteurs liés aux personnes.
Un pansement peut être réalisé au lit du patient,
en salle d’examen, en secteur d’imagerie médi-
cale, en consultation, en bloc opératoire. Le
risque se situe donc au niveau de l’air ambiant
(poussières véhicules de germes) et des surfaces
contaminées (contamination par la main ou par
le matériel). En milieu contrôlé, le risque est
moindre. En service de soins, l’interruption du
soin, l’insuffisance ou l’inadaptation du matériel
ou des personnels, l’introduction d’une nouvelle
Caractérisées par une absence de croûte et la formation
d’un excytotoxique, les plaies chroniques requièrent une approche
pluridisciplinaire et du temps pour cicatriser. D’autant qu’elles
concernent surtout les sujets âgés ou immobilisés.
«
©L.D.

20
qualité peut avoir une influence primordiale
sur le choix d’un pansement, explique Brigitte
Faoro, pharmacien au CHU de Montpellier.
Avant de pouvoir faire un choix raisonné, il est es-
sentiel de connaître l’histoire du produit, de sa fa-
brication à son utilisation. Un matériel “non conta-
minant” doit être utilisé, ce qui ne signifie pas qu’il
doit être systématiquement stérile. »
Aujourd’hui, les conditions de fabrication
changent. Les industries du pansement sont
conduites, par l’évolution de la législation euro-
péenne, vers la normalisation CE. Les sites de pro-
duction vont faire l’objet de contrôle des condi-
tions de fabrication et de stockage pour obtenir
l’estampille CE, valable cinq ans. «En outre, les dis-
positifs médicaux étant classés en fonction du danger
potentiel, ajoute Brigitte Faoro, les pansements
simples font partie de la classe I. »
Une longue chaîne mène le matériel du fabricant
au soignant. Certaines règles doivent être respec-
tées au cours de ce processus. Un conditionne-
ment résistant aux chocs physiques et thermiques
doit préserver les qualités du matériel, par exemple
un pansement, et sa non-contamination. Une uti-
lisation rapide est cruciale. Cela nécessite une date
de fabrication récente, autant pour le matériel sté-
rile que pour celui non stérile. Les lieux de stoc-
kage et de manutention doivent être adaptés. En
milieu industriel, la norme CE l’exige. A l’hôpital,
les normes d’accréditation remettent en question
les normes de stockage. En pharmacie comme en
service de soins, certaines règles doivent être res-
pectées : locaux aérés et tempérés, rayonnages
adaptés, déconditionnement proscrit pour main-
tenir protection et traçabilité.
M.B.
●●●
Plaie
Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
Conditions d’utilisation des matériels
La prévention des infections requiert un matériel
adapté tant au soin (set de soin stérile ou non) qu’à la
plaie (pansement spécifique : compresse, tampon, hy-
drocolloïde, hydrogel, etc.). Les règles d’hygiène doi-
vent être respectées à travers les protocoles de soins.
Pour prévenir l’infection des plaies, deux types d’atti-
tudes peuvent être adoptés suivant le type de plaie.
La plaie aiguë doit être préservée des germes exté-
rieurs par destruction in situ. Une plaie chronique non
stérile doit être préservée de la pullulation. La propa-
gation des germes doit être évitée. Un comportement
aseptique doit être adopté dans tous les cas.
Il faut effectuer un pansement :
•dans un environnement propre ;
•dans un lieu dédié à cette tâche ;
•dans une atmosphère calme, sans turbulence ;
•au sein d’une organisation permettant d’effectuer tous
les soins d’un même patient par la même personne ;
•sans parler au-dessus de la plaie ;
•en ayant revêtu une tenue propre (stérile au bloc opé-
ratoire, tablier pour une plaie fortement contaminée) ;
•en ayant des mains propres (utilisation possible de
gants) :
–plaie aiguë : principe du non-toucher, lavage hygié-
nique ou chirurgical, gants stériles ou utilisation de
pinces,
–plaie chronique : lavage hygiénique des mains, port
ou non de gants ;
•en utilisant du matériel individualisé ;
•en prévoyant une aide si nécessaire ;
• en éliminant les déchets et le matériel souillé ;
• en respectant le protocole en vigueur ;
• en notant les observations et le pansement réalisé
dans le dossier de soins.
Il importe enfin d’obtenir une collaboration du patient
et de favoriser son éducation, notamment en matière
de respect de l’hygiène et de la plaie.
Marc Blin
Source :
• D’après l’intervention de Francine Rumeaux,
cadre infirmier supérieur expert au CHU de Montpellier,
à la 1re Conférence nationale des plaies et cicatrisations
àParis.
• Travaux et réflexions sur le choix d’un pansement
sont menés depuis plusieurs années
au CHU de Montpellier. Ils ont fait l’objet de publications
de Brigitte Faoro, pharmacien, et de Francine Rumeaux,
cadre infirmier supérieur, dès 1997.
• Dans quelle circonstance le pansement doit-il être
stérile ? B. Faoro, C. Hamon-Mekki, F. Rumeaux,
1re Conférence nationale des plaies et cicatrisations,
janvier 1997, Paris.
©L.D.

22
Plaie
Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
Un questionnaire d’enquête postal a été établi
afin d’identifier les éléments influençant l’ap-
proche des infirmières face à la douleur et aux trau-
matismes, lors du retrait de pansement. «Cette en-
quête a permis d’examiner les stratégies adoptées et
d’analyser les facteurs déterminant le choix des traite-
ments », explique le Dr Sylvie Meaume, dermato-
logue et gériatre à l’hôpital Charles-Foix.
Ce questionnaire, réalisé par des spécialistes en
plaies et cicatrisations, a été diffusé aux membres
de la SFFPC (Société française et francophone des
plaies et cicatrisations), aux participants de la
Conférence des plaies et cicatrisations, en janvier
2000 à Paris, et adressé aux cadres infirmiers de
plusieurs centres hospitaliers. Au total, 6 582 ques-
tionnaires ont été diffusés.
Priorités infirmières
Parmi les 1 672 soignants répondants, 83 % exer-
cent à l’hôpital. Un quart d’entre eux (18 % de
l’échantillon) travaillent en établissements publics de
soins de longue durée. La préoccupation principale
des infirmières lors du retrait du pansement est avant
tout de prévenir la douleur du patient (49 %) ou de
prévenir toute propagation d’une infection bacté-
rienne (33 %). Les personnes qui ont répondu men-
tionnent moins le fait d’éviter les traumatismes sur la
plaie (9 %) ou les lésions sur la peau périlésionnelle
(5 % ). D’après elles, le patient ressent surtout de la
douleur au cours des procédures de nettoyage de la
plaie (63 %) ou lors du retrait de pansement (32 %)
et non lorsque le pansement est appliqué (0 %) ou
en place ( 1 %). Les ulcères de jambes (42 %) et les
brûlures superficielles (38 %) sont considérés
comme les deux types de plaies les plus doulou-
reuses. Viennent juste après les escarres et les brû-
lures profondes. «Diverses stratégies permettent de
prévenir la douleur et les traumatismes, dit le Dr Sylvie
Meaume. Les infirmières citent la non-utilisation de pan-
sements adhésifs sur peaux fragiles. Elles mentionnent
l’utilisation de pansements atraumatiques, mais aussi le
trempage et l’humidification du pansement avant le re-
trait. Elles citent bien sûr la prise d’antalgiques. »
Top 50 des pansements
Trois caractéristiques d’un pansement sont consi-
dérées comme à privilégier pour un ulcère ou un
escarre modérément exsudatif. Pour les infirmières,
ce pansement doit être avant tout atraumatique au
retrait, non adhérent à la plaie et utilisable sur peau
fragilisée. Les pansements occasionnant toujours
ou souvent une douleur au retrait sont les com-
presses de gaze (60 % ) et les pansements films
transparents (52 %). Ces mêmes types de panse-
ments sont considérés comme entraînant des trau-
matismes sur la plaie et la peau périlésionnelle. Les
hydrofibres, hydrogels et pansements siliconés ob-
tiennent les meilleurs scores. Mais leur usage reste
peu répandu. Parmi les infirmières ayant répondu,
58 % des répondantes n’ont pas connaissance de
pansements spécifiquement conçus pour prévenir
douleurs et traumatismes au changement de pan-
sement. Les facteurs principaux limitant le choix
des pansements sont “le personnel médical” ou “les
prescripteurs” (43 %), les protocoles locaux en ma-
tière de prise en charge des plaies (42 %), le manque
de connaissance des produits (41 %), les restric-
tions financières (35 %) et la difficulté à remettre en
question les pratiques établies (24 %).
En débat
Projet ambitieux, cette enquête souffre du fait qu’elle
concerne un échantillon dont la représentativité
laisse à désirer : 25,4 % de taux de réponse au lieu
des 75 % jugés souhaitables pour toute enquête sta-
tistique. Seuls 1 672 questionnaires sur 6 582 ont été
analysés. Les réponses sont dignes d’intérêt, mais
elles peuvent ne représenter l’avis que d’un certain
type de répondants, sous-estimant les réponses éven-
tuellement différentes mais homogènes des 74,6 %
de non-répondants. Cette enquête semble toutefois
confirmer l’importance que l’infirmière accorde aux
problèmes de douleur et traumatismes lors des ré-
fections de pansements. Au retrait du pansement, il
faut prévenir ou minimiser les traumatismes sur la
plaie et son pourtour, atténuer la douleur du patient.
C’est la garantie d’un soin des plaies de qualité. «Il
est essentiel de choisir le pansement le plus approprié per-
mettant d’améliorer la qualité de vie des patients »,
conclut le Dr Sylvie Meaume. Les résultats de cette
enquête démontrent plus que jamais l’importance
que l’on doit accorder à l’enseignement et à la for-
mation en matière de traitement des plaies.
M.B.
Enquête sur la douleur
Comment éviter les traumatismes?
Les recherches sur la douleur, les lésions tissulaires, les traumatismes
sur la plaie et la peau périlésionnelle soulignent la nécessité
de faire évoluer les pratiques. Point de vue des infirmières.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%