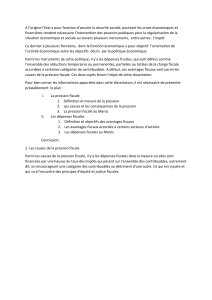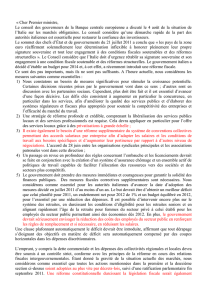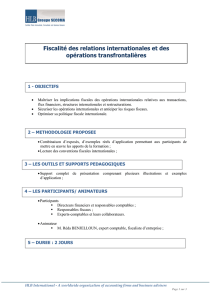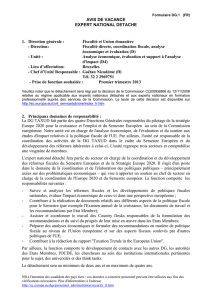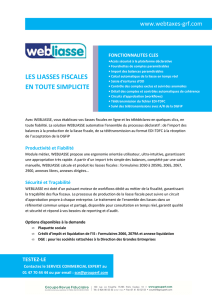Les politiques fiscales et la crise en Union Européenne

Bernard CASTAGNEDE
Professeur à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Les politiques fiscales et la crise en Union Européenne
Discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise du titre de
Docteur honoris causa de la faculté de droit de l'Université d'Athènes
(22.05.2012)
1. On a choisi d’aborder le thème de la politique fiscale, plutôt que celui du droit fiscal, ou de
l’un de ses aspects, à raison, bien entendu, de l’actualité, qui est celle d’une crise profonde,
qui n’affecte pas seulement la Grèce, mais une bonne partie de l’Europe, et qui revêt une
dimension fiscale particulièrement importante.
Le premier aspect fiscal de la crise économique et financière qui ébranle l’Europe depuis
quatre ans, c’est à l’évidence le retour en force de l’impôt, l’alourdissement du prélèvement
fiscal, sous toutes ses formes, là où il y a peu de temps encore s’exprimait assez largement le
discours de la compétitivité fiscale, de la course à l’attraction territoriale des activités par le
moins disant fiscal.
Mais les rapports entre crise et fiscalité ne se résument pas à l’augmentation des impôts. En
amont pourrait être d’abord posée la question d’une éventuelle responsabilité des politiques
fiscales dans l’apparition de la crise. Il est instructif, ensuite, d’examiner quelles ont été les
réponses de la fiscalité à l’avènement puis aux développements de la crise. De manière plus
fondamentale, il faut aussi rechercher l’impact de la crise sur les orientations de plus long
terme et la conduite des politiques fiscales. Là réside, en fait, la raison majeure du choix du
thème retenu pour cet exposé. La crise actuelle est sans doute un facteur déterminant de
changement des politiques fiscales.
2. Avant d’aborder ces différents aspects de la relation entre la crise économique et financière
et la politique fiscale, il est utile, cependant, de s’arrêter un instant sur le sens même des
termes de « politique fiscale ».
L’expression désigne, en un sens large, l’ensemble des choix qui concourent à fixer les
caractéristiques d’un système fiscal. Relèvent en ce sens de la politique fiscale, les mesures
exerçant des effets sur le niveau de la pression fiscale, ou sur la répartition du prélèvement
total en différentes catégories d’imposition, la définition des dispositifs techniques
d’imposition, les décisions relatives à l’assiette ou aux tarifs des différents impôts et taxes.
En un sens plus étroit, la politique fiscale s’entend de l’utilisation faite de l’impôt, ou plus
précisément de la législation fiscale, à des fins économiques, sociales, ou encore
environnementales. L’impôt est alors envisagé en tant qu’un instrument de politique
économique, pouvant être mis au service d’objectifs conjoncturels ou structurels.

Bernard CASTAGNEDE Les politiques fiscales et la crise en Union Européenne
2/16
La politique fiscale conjoncturelle est un élément de la politique budgétaire qui, incluant
également la politique de la dépense publique et la politique du solde budgétaire, contribue,
avec la politique monétaire, au pilotage d’ensemble des économies nationales. Politique
budgétaire et politique monétaire forment, lorsqu’elles sont conduites de façon simultanée et
cohérente, les éléments du « policy mix » qui assure la régulation conjoncturelle des espaces
d’économie libérale.
La politique fiscale est dite structurelle lorsqu’elle vise, non plus à régulariser le cycle
économique, mais à agir sur des données ou segments particuliers d’une économie nationale,
où s’observe un besoin d’action ou de correction. L’impôt est alors utilisé pour favoriser, de la
part des agents économiques, des comportements répondant aux objectifs des politiques
publiques en différents domaines, tels que l’aménagement du territoire, le développement de
la recherche, les économies d’énergie ou encore la protection de l’environnement.
La crise financière de 2008, puis les crises économiques et budgétaires qui ont suivi ont fait
sentir leurs effets, nous le verrons, tant sur la conduite globale des systèmes fiscaux que sur la
place faite à l’outil fiscal dans le pilotage de l’économie, et sur les conditions de son
utilisation. L’examen des rapports entre crise et fiscalité intéressera en conséquence la
politique fiscale entendue dans toutes ses dimensions.
3. On ne s’arrêtera pas longuement sur la question d’une éventuelle responsabilité des
politiques fiscales nationales dans la formation de la crise initiale de 2008 qui fut, on s’en
souvient, une crise financière privée, marquée par l’effondrement du secteur bancaire faisant
suite aux déboires du marché immobilier américain, imprudemment financé par d’excessifs
recours au crédit.
Certains évoquent les avantages fiscaux généreusement accordés à l’investissement
immobilier, à l’origine de la crise, ou le traitement fiscal trop favorable des produits
financiers. Ces données fiscales n’ont sans doute joué, à vrai dire, qu’un rôle marginal dans le
déclenchement de la crise. Tout au plus faut-il souligner la tardiveté, partagée par beaucoup
d’Etats, des mesures fiscales de contrôle des opérations conduites dans les « paradis fiscaux »,
où se sont abrités les fonds spéculatifs pour partie à l’origine de la crise du secteur bancaire.
Les progrès de la coopération internationale, en ce domaine, ont été manifestement plus lents
que ceux de la liberté de circulation des capitaux.
4. Mérite davantage d’attention la part prise par les politiques fiscales nationales, non pas tant
dans la genèse de la crise économique qui a suivi la crise financière privée, et qui en était un
inévitable effet, que dans la crise financière publique qui s’est par la suite développée, pour
partie à raison de l’aggravation des déficits générée par les opérations publiques de
renflouement du secteur bancaire privé, sur fond de situation financière publique dégradée,
dans beaucoup de cas, par un endettement déjà substantiel.
A vrai dire, les politiques fiscales proprement dites ont à cet égard moins de responsabilité
spécifique que n’en ont, de façon plus générale, les politiques financières publiques, politique

Bernard CASTAGNEDE Les politiques fiscales et la crise en Union Européenne
3/16
de la dépense, politique du solde budgétaire, durablement marquées par une insuffisante
attention portée à l’objectif d’équilibre.
Certes, ici ou là, ont été lancées ou poursuivies, peu avant la crise de 2008, notamment en
France, des politiques fiscales guidées par un objectif d’abaissement du niveau de la pression
fiscale, regardée comme un élément d’attractivité du territoire et d’amélioration de la
compétitivité des entreprises. Mais en fait, la compétitivité, la croissance, l’emploi, peuvent
être également satisfaits à des étiages très différents de pression fiscale, en sorte qu’il serait
inapproprié d’apprécier une politique fiscale d’abaissement de la pression fiscale au seul
regard de la crise apparue au cours des années récentes. Est en cause, non pas vraiment le
choix d’une telle politique du moins d’impôts que la priorité accordée à cette orientation sur
le rétablissement préalable de l’équilibre des comptes publics.
Beaucoup d’Etats, en Europe, se sont durablement accoutumés à un fonctionnement financier
public reposant sur l’admission du déficit budgétaire en tant que mode normal de financement
des dépenses.
Tel a été le cas, en France, depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La véritable
« culture » du déficit qui s’y est imposée trouvait explication, d’une part bien sûr dans une
tendance générale à l’augmentation des dépenses publiques notamment favorisée par un
modèle social très généreux, mais d’autre part dans la relative facilité durablement conservée
à financer par l’emprunt l’excédent des dépenses sur les recettes définitives. Tant que l’Etat a
disposé de la capacité de bénéficier d’avances de l’Institut national d’émission, la Banque de
France, d’imposer aux banques privées l’acquisition et la conservation d’un certain volume
d’effets publics, et celle d’attirer l’épargne privée interne vers l’emprunt public au moyen
d’avantages financiers ou fiscaux, l’existence d’un déficit budgétaire ne présentait guère de
risques autres que celui de générer l’inflation qu’entraîne l’accroissement de la masse
monétaire.
L’accoutumance au déficit a eu pour effet qu’en présence de « cagnottes fiscales », c’est-à-
dire de rentrées fiscales supérieures aux prévisions, l’option de politique publique était de les
affecter à de nouvelles dépenses ou à des baisses d’impôts plutôt qu’au refinancement de la
dette.
Avec la monnaie unique, l’alignement des conditions de l’emprunt public sur celles de
l’emprunt privé et la suppression des moyens de contrainte de l’Etat sur la politique de réserve
des établissements financiers, le déséquilibre budgétaire et l’endettement public en résultant
présentent des risques beaucoup plus élevés, particulièrement lorsqu’au financement des
dépenses courantes s’ajoute un besoin de financement public exceptionnel, tel que celui
représenté, en 2008, par l’exigence de sauvetage des établissements bancaires.
Sans être totalement hors de cause – affectation discutable des cagnottes fiscales, en France,
insuffisance de l’effort d’amélioration de la gouvernance fiscale, dans d’autres pays – la
politique fiscale a somme toute, par elle-même, une responsabilité seulement partielle dans
l’émergence des crises économique et financière des dernières années. Est plus directement à

Bernard CASTAGNEDE Les politiques fiscales et la crise en Union Européenne
4/16
l’origine des principales difficultés financières actuelles le défaut de priorité accordée dans les
politiques budgétaires à l’objectif de prévention d’une crise des dettes souveraines.
5. Dans les rapports entre crise et politiques fiscales, on s’intéressera principalement, dès lors,
à l’impact de la première sur les secondes. En examinant, en premier lieu, la réponse
immédiate des politiques fiscales à la crise, en recherchant, en second lieu, les changements
plus durables de politique fiscale déterminés par la crise.
I. LES POLITIQUES FISCALES DE REPONSE A LA CRISE
6. En fait, sous réserve du cas particulier des quelques pays épargnés par la crise, et compte
tenu des variations dans la nature et l’amplitude des dispositifs d’un pays à l’autre, on peut
assez nettement distinguer deux phases dans les politiques fiscales engagées en réaction à la
crise. Face à la récession économique engendrée par la crise financière privée de 2008, ont
d’abord été adoptées, le plus souvent, des mesures caractéristiques d’une politique fiscale
anticyclique, visant à relancer la croissance. Ces mesures ayant creusé les déficits publics,
accru l’endettement des Etats, et dangereusement ébranlé la confiance des prêteurs, elles ont
été suivies de dispositions tendant au simple rétablissement des comptes publics. L’objectif
financier de l’impôt a finalement prévalu sur son utilisation économique, la politique fiscale
anti-déficit l’emportant sur la politique fiscale anti-crise.
A/ Les politiques fiscales anti-crise
7. La crise financière privée débutant en 2008 a gravement affecté, quoique de façon variable
selon les Etats membres, l’ensemble de l’Union européenne. Le produit intérieur brut de
l’Europe des 27 s’est, en 2009, contracté de 4,2% (et jusqu’à 18% en Lettonie). Les moyens
fiscaux d’abord mis en œuvre pour répondre à la récession ont été empruntés au vade-mecum
classique de la politique fiscale conjoncturelle, largement inspirée des enseignements de
Keynes. Comme on sait, selon l’économiste anglais, une récession économique peut être
efficacement combattue par l’injection dans l’économie de disponibilités monétaires
supplémentaires, qui peuvent être notamment fournies au moyen d’allègements fiscaux. La
relance de la consommation peut être favorisée par une modération des charges fiscales
atteignant les catégories de populations ayant une faible propension à épargner,
essentiellement les titulaires de revenus modestes. L’assainissement de la trésorerie des
entreprises et la relance de l’investissement peuvent trouver l’appui de mesures d’allègement
des charges fiscales des entreprises. Sans doute les pertes de recettes résultant d’une telle
politique fiscale de relance peuvent-elles générer ou aggraver le déficit des comptes de l’Etat,
mais les surplus de recettes engendrés par la croissance permettent, selon la théorie
keynésienne du « multiplicateur », le retour ultérieur à l’équilibre des comptes publics.
8. Peut être rattaché à une telle approche le « plan de relance pour la croissance et l’emploi »
présenté par la Commission européenne le 26 novembre 2008. Ce plan prévoyait des mesures
de relance budgétaires rapides, ciblées et temporaires, évaluées à 200 milliards d’euros, soit
1,5% du PIB de l’Union Européenne. Le plan de relance faisait appel, pour l’essentiel, aux
budgets nationaux (pour 170 milliards d’euros, le solde provenant de l’UE). Selon la

Bernard CASTAGNEDE Les politiques fiscales et la crise en Union Européenne
5/16
Commission, il s’agissait de « tirer parti de la flexibilité offerte par le pacte de stabilité et de
croissance », une approche coordonnée de la part des Etats générant en outre des « effets
multiplicateurs ». La politique budgétaire de relance préconisée devait reposer tant sur des
dépenses nouvelles que sur des réductions d’impôt. La stimulation fiscale de la croissance
pouvait notamment, selon la Commission, passer par un allègement des charges sociales des
employeurs, une modération de l’imposition des revenus du travail, en particulier pour les
titulaires de faibles revenus, une réduction temporaire du taux normal de la TVA, la
pérennisation du taux réduit de TVA pour les services à forte intensité de main d’œuvre. Des
mesures de plus long terme étaient en outre suggérées, notamment des incitations fiscales à la
recherche et au développement.
9. En bon élève de l’Europe, la France adoptait en décembre 2008 son propre plan de relance,
comportant un allègement des charges fiscales des entreprises, notamment en matière d’impôt
sur les sociétés, un abaissement de l’impôt sur le revenu supporté par les catégories sociales
les moins favorisées, une amélioration du dispositif de crédit d’impôt-recherche. Une loi de
juillet 2009 abaissait ensuite de 19,6% à 5,5% le taux de la TVA sur les restaurants.
Le plan espagnol de stimulation de l’économie et de l’emploi présenté à la fin de l’année 2008
par le gouvernement Zapatero était pareillement inspiré d’une approche keynésienne : son
volet fiscal comportait des mesures de soutien aux particuliers comme aux entreprises, sous
forme de réductions d’impôt sur le revenu, déductions fiscales réduction de l’impôt sur les
sociétés. Il comportait également la suppression de l’impôt sur la fortune.
L’Allemagne adoptait un comportement similaire au début de 2009, par l’abaissement de 15%
à 14% du taux applicable à la plus basse tranche de revenus soumis à l’impôt personnel
progressif et l’augmentation des déductions fiscales au titre des contributions sociales.
Le Royaume-Uni, pour sa part, abaissait sont taux de TVA de 2,5 points en 2009.
Les politiques fiscales de relance, accompagnant les mesures anti-crise fondées sur la dépense
publique, à vrai dire plus substantielles, ont sans doute contribué à limiter l’ampleur et la
durée de la récession économique. Mais elles ont simultanément concouru à l’aggravation des
déficits et de l’endettement publics. Ajoutées aux effets spontanés du ralentissement
économique sur le rendement des impôts, les mesures de relance fiscale ont en effet contribué
à la forte contraction des produits fiscaux observée dans l’ensemble de l’Union Européenne,
le niveau moyen de pression fiscale dans l’Europe des 27 passant de 37,2% en 2007 à 35,8%
en 2009.
10. Peut être par ailleurs rattachée à une stratégie fiscale anti-crise le renforcement coordonné,
observé en 2009, des moyens de lutte contre l’usage abusif des paradis fiscaux, auxquels a été
attribuée une part de responsabilité dans les pratiques spéculatives ayant favorisé le
déclenchement de la crise. Les résolutions prises par le « G 20 » à l’issue des sommets de
Londres du 2 avril 2009 et de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009, conférant un nouvel
élan aux entreprises de l’OCDE en vue de limiter la concurrence fiscale dommageable, ont
conduit à l’adoption par plusieurs Etats (cf., en France, la loi de finances rectificative du 30
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%